A l’occasion de la sortie, aux Belles Lettres, de la ré-édition de la Cité libre de Walter Lippmann, nous vous invitons à relire les textes que Contrepoints a consacré à cet auteur important, tant parce qu’il a été à l’origine du courant dit “néo-libéralisme”, que par l’influence qu’il a exercé, après guerre, sur les penseurs libéraux et libertariens qui se sont rassemblés autour de la Société du Mont-Pèlerin.
La pensée de Lippmann ne saurait se concevoir en-dehors des grands débats de son temps ; son œuvre n’est pas celle d’un universitaire versé à l’abstraction, bien qu’il ait deux fois eu l’occasion de devenir professeur, à Chicago et à Harvard, mais d’un commentateur de son temps, d’un « passeur » entre la recherche pure et l’opinion publique. C’est la raison pour laquelle il est resté dans la mémoire collective américaine un journaliste – deux fois lauréat du Prix Pulitzer – d’un type certes particulier, commentateur beaucoup plus que reporter, mais un journaliste tout de même.
Walter Lippmann nait à New York le 23 septembre 1889, d’une famille juive aisée et assimilée, qui a l’habitude de faire un voyage annuel en Europe. C’est en effet sur le vieux continent, et parmi les ashkénazes allemands en particulier, que se trouvent ses racines familiales, dont il n’entend pas se départir. C’est du reste le propre de la bourgeoisie éclairée de l’époque que de ranimer, à intervalle régulier, le cordon ombilical qui lie le Vieux continent au Nouveau monde, en particulier dans les familles juives de la côte Est. Après de brillantes études, le jeune Walter Lippmann entre à Harvard à l’âge de 17 ans, en 1906, et a, notamment, comme professeur William James[1] (1842-1910), George Santayana[2] (1863-1952), ou encore Charles Townsend Copeland[3]. Lippmann est du reste, durant sa quatrième année à Harvard, l’assistant de Santayana[4].
Lippmann adhère rapidement à la Fabian Society[5] (dont les figures de proue sont les époux Webb[6], Herbert George Wells[7], George Bernard Shaw[8]). Il crée, en 1908, avec huit autres étudiants le Harvard Socialist Club[9], dont il devient rapidement le président. Il en profite pour s’essayer au journalisme étudiant, en devant le principal rédacteur de The Harvard Monthly[10].
Il devient à cette époque un ami proche de John Reed[11], qui, selon sa biographe Barbara Gelb, « fut très impressionné par la capacité de Lippmann à mobiliser ses idées et par l’influence notable que le Club commençait à exercer, grâce à Lippmann, non seulement au sein de l’université, mais dans toute la communauté (des intellectuels socialistes) ».
Sans quitter ses attaches socialistes initiales, Lippmann évolue vers une posture plus sociale-démocrate, sous l’influence de son mentor, Graham Wallas[12], dont il suite les cours de science politique à la London School of Economics (LSE), en qualité d’invité à Harvard. Celui-ci, ancien membre éminent des socialistes fabiens, a quitté cette Société en 1904, du fait de sa profonde empathie pour les principes libéraux. Empathie qui commence à contaminer son disciple.
A la fin de ses études, Lippmann devient l’assistant de Lincoln Steffens[13], un journaliste « muckraker[14] » du New York Post. Il est au cœur du reportage sur la grève de Paterson[15]. Ses recherches suscitent aussi les investigations du Comité Pujo qui pousse Wilson à faire voter le Federal Reserve Act de 1913 destiné à contrôler les banques.
Lippmann participe ensuite à la campagne présidentielle de 1912, qui a la particularité – oubliée de nos jours – d’être une triangulaire opposant le républicain William Howard Taft[16] (1857-1930), le démocrate Woodrow Wilson (1856-1924), et le « progressiste », ancien président républicain des Etats-Unis, Theodore Roosevelt[17] (1858-1919). Cette campagne marque intellectuellement et durablement Lippmann. Il y trouve en effet en toile de fond d’une part la nécessité d’adapter la démocratie à la complexité de la vie économique moderne, et d’autre part, celle de mieux prendre en compte la réalité du suffrage universel. Deux projets cohérents se font donc face en 1912 : le programme du New Nationalism de Theodore Roosevelt et d’Herbert Croly[18], le programme de New Freedom de Woodrow Wilson et de son conseiller spécial Louis Brandeis[19]. Roosevelt et Croly sont aussi favorables à un renforcement de l’Etat fédéral, qu’ils sont réservés vis-à-vis de la législation anti-trust. A rebours, Wilson et Brandeis sont favorables à un renforcement de la législation anti-trust et réservé quant à un renforcement de l’Etat. Le New Freedom incarne un courant pour le moins original pour nous Européens : celui des juristes et économistes opposés au laissez-faire sans renier leur méfiance, toute jeffersonienne, envers l’Etat.
Lippmann s’engage – assez logiquement compte tenu de son cheminement intellectuel – du côté du plus interventionniste, Theodore Roosevelt. Ses ouvrages postérieurs, A Preface to Politics (1913) et Drift and Mastery (1914) résumeront sa position. Grâce à une sorte de saint-simonisme expurgé de son enveloppe pseudo-religieuse, Lippmann croit alors possible une maîtrise de l’ordre social par l’homme. Il considère que la théorie de l’intérêt personnel et de la maximisation du profit sont anachroniques. Il croit aussi en la responsabilité d’une nouvelle classe de managers professionnels, distincts des propriétaires d’entreprise, et se montre en conséquence favorable aux grands groupes, même s’il en perçoit aussi les dangers. Cette thèse sera popularisée peu après par Veblen, dans Les Ingénieurs et le système des prix[20].
Mais c’est Wilson qui, au final, l’emporte : il est élu grâce à la division au sein du Parti républicain ; le total des votes de Taft et de Roosevelt est en effet supérieur à celui obtenu par Wilson.
Le tournant de la guerre
C’est la Première Guerre mondiale qui va définitivement brouiller ses certitudes constructivistes. Il perd progressivement sa confiance dans « l’intelligence organisée de la classe gouvernante[21] ».
En novembre 1914, il participe, avec notamment Herbert Croly et Walter Weyl[22] à la fondation du New Republic, une petite revue « assez à gauche du consensus libéral pour être stimulante », comme l’écrit dans sa biographie Ronald Steel[23]. Ce journal aura très vite une grande influence, et devient un véritable forum pour les esprits les plus libres et les plus originaux. John Dewey[24], Charles Beard[25], James Bryce[26], George Bernard Shaw, Graham Wallas notamment, y publient des articles. Lippmann se spécialise dans l’examen de la politique étrangère. Il y plaide pour que les Etats-Unis abandonnent l’isolationnisme, et s’impliquent plus fortement dans les affaires internationales. Il est déjà assez connu pour que le poids de ses écrits ait une certaine influence sur l’engagement du Président Wilson en faveur de l’entrée en guerre des Etats-Unis. En 1916, alors que les forces américaines se lancent dans la guerre, Wilson, qui a besoin des voix des intellectuels de gauche pour la prochaine élection présidentielle, se rapproche de Lippmann et de ses camarades. Il fait même de celui-ci l’assistant du ministre de la Guerre, Newton Baker[27], en 1917.
Il est nommé en septembre 1917 secrétaire général de l’Inquiry, une commission de spécialistes formée par Wilson et le colonel Edward Mandell House pour étudier les problèmes des nationalités en Europe, et pour réfléchir sur la façon dont pourrait être redessiné le paysage européen après-guerre[28]. Il participe ainsi, au sein de l’Inquiry, à l’élaboration de huit des célèbres Quatorze points de Wilson, et, de la sorte, à la définition des buts de guerre de la diplomatie américaine.
Fin 1918, membre de la délégation américaine à la Conférence de Paris (18 janvier 1919 – août 1920), il est chargé de réaliser à la hâte l’exégèse officielle de ces mêmes Quatorze points pour les premiers plénipotentiaires arrivés à Versailles, mais quittera rapidement la France, fin janvier 1919, non sans avoir auparavant rencontré et sympathisé avec John Maynard Keynes (1883-1946), dont il restera l’ami[29], et Bernard Berenson[30].
« LE » columnist américain
Revenu aux Etats-Unis, Lippmann s’oppose, et avec lui le New Republic, à la ratification du Traité de Versailles. Il saisit très vite les dangers de cette paix bâclée, et se retourne contre Wilson. Il s’oppose en particulier à la « balkanisation de l’Europe centrale[31] » et aux réparations de guerre, ainsi qu’aux concessions territoriales et à l’obligation faite aux Etats-Unis de les défendre par la force. Il obtient de Keynes l’autorisation de publier certains extraits des Conséquences économiques du Traité de Versailles dans le numéro de noël 1919 du New Republic. Le féroce portait que Keynes dresse de Wilson finit de faire de Lippmann une persona non grata à la Maison Blanche, et sert ceux qui, au Sénat, s’oppose à la ratification du Traité[32]. Lippmann aurait ultérieurement regretté son geste.
C’est alors que Lippmann devient « LE » columnist américain. Un journaliste, certes, mais dont le modèle n’existe pas en France. Un journaliste au statut si particulier qu’il dessine, plusieurs fois par semaine, en quelques milliers de signes, à côté des news, l’opinion de ses lecteurs. Comme l’écrit Bruno Latour, « contrairement aux éditoriaux qui engagent les propriétaires des journaux ou les rédacteurs en chef, aux articles des reporters, aux opinions publiées par les uns ou par les autres, la colonne du columnist est tenue régulièrement par un journaliste sans autre autorité que sa capacité à résumer les problèmes du moment et à leur donner, en toute indépendance, une analyse instantanée. Contrairement à Raymond Aron jadis, il n’occupe aucune chaire universitaire ; contrairement à Paul Krugman aujourd’hui, il ne parle pas au nom de la science économique. Quand il se risque à une interprétation des événements courants, c’est sans filet[33]. » Lippmann a sans doute été le columnist par excellence.
Le précurseur du « néo-libéralisme »
Lippmann quitte en 1922 le New Republic pour The New York World de Ralph Pulitzer. Il y rédige la première de ses trois œuvres majeures, jamais traduite en français, Public Opinion (1922). Dans ce livre, il développe la notion de stéréotype (dont il est l’inventeur), et celle, voisine, de Pictures in Our Heads. Il étudie plus précisément la manipulation de l’opinion publique. Selon Lippmann, pour « mener à bien une propagande, il doit y avoir une barrière entre le public et les événements[34]. » La démocratie, ajoute-t-il, a vu la naissance d’une nouvelle forme de propagande, basée sur les recherches en psychologie associées aux moyens de communication modernes[35]. La démocratie s’est muée en « fabrication du consentement », manufacture of consent, terme dont il est également l’inventeur. L’arrivée de personnes dotées d’une culture politique relativement faible entraîne un accroissement du risque d’une forte divergence entre les images que les citoyens ont dans la tête, et la réalité du monde extérieur. Pour résoudre ce problème, Lippmann se prononce en faveur de groupes d’experts indépendants chargés de « rendre intelligibles les faits non apparents ». Il ne devance en cela que de quelques années les projets planistes des polytechniciens français de X-Crise[36].
Dans son ouvrage suivant, récemment traduit en français, Le Public fantôme (1925), il développe l’idée que si le public ne peut pas constituer une force créatrice et directrice de la société, il peut néanmoins apporter son assistance à ceux qui défendent des idées raisonnables.
Il quitte en 1931 le World pour le non moins célèbre New York Herald Tribune, propriété des républicains. Sa chronique, « T & T » (« Today & Tomorrow »), grâce au système de la syndication, est lue par cinq à dix millions de personnes pendant près de cinq décennies, et sert toujours aujourd’hui de modèle dans les écoles de journalisme.
En tant que columnist, Lippmann va chercher à comprendre les désastres successifs de son siècle, en éclairant ses lecteurs sur un nombre immense de crises, sur les projets d’une douzaine de présidents. Il est celui qui a poussé Wilson dans la guerre, mais aussi qui s’est dressé contre la paix impossible de la Société des nations, qui a évité à son pays un conflit avec le Mexique (par une diplomatie secrète avec le Vatican !), qui a vu immédiatement les dangers du stalinisme, qui a longuement préparé son pays à la guerre contre le national-socialisme, qui a compris dès juin 1940 tout l’intérêt de de Gaulle[37], qui a exprimé son horreur du maccarthisme, et qui a tout fait pour éviter l’intervention américaine en Corée comme au Viêt-Nam. Il a inventé les termes de Communauté atlantique, de Guerre froide, et tant d’autres.
Cela ne l’a évidemment pas empêché de commettre des erreurs de jugement, parfois même grossières. Il soutient par exemple, contre toute évidence, qu’il n’y aura pas de division de l’Allemagne après la guerre. Mais l’exercice auquel Lippmann se livre chaque jour ou presque mérite bien un peu d’indulgence lorsqu’on juge a posteriori la qualité de ses analyses.
[1] Psychologue et philosophe, William James est issu d’une grande famille intellectuelle américaine. Il compte parmi ses parents Henry James Sr., le disciple de Swedenborg, et a comme frère cadet le célèbre romancier Henry James. William James est souvent présenté comme le fondateur de la psychologie en Amérique. « La première conférence de psychologie à laquelle j’ai assisté, c’est moi qui l’ai donnée», disait-il.
[2] Ecrivain et philosophe américain d’origine espagnole, George Santayana est professeur de philosophie à Harvard. Son réalisme critique, pragmatiste et naturaliste le distingue du néoréalisme qui dominait la philosophie américaine de son temps.
[3] Charles Townsend Copeland (1860 – 1952) est un critique littéraire du Boston Advertiser et du Boston Post.
[4] D’après Ronald Steel, Walter Lippmann and the American Century, 1980, Transaction Publishers, Londres, 1998., (p. 19-22), Lippmann aurait été fortement marqué par ce philosophe pour qui « la fonction de la raison est de dominer l’expérience ». Sur le rapport de Santayana avec le pragmatisme, on pourra voir Levinson (1992) Santayana, Pragmatism and the Spiritual Life, éd. UNC Press.
[5] La Société des Fabiens ou Société fabienne (Fabian Society, du nom du général romain Quintus Fabius Maximus Verrucosus, « le méticuleux ») est un groupe de réflexion britannique fondé en 1884. Son but est de promouvoir la cause socialiste par des moyens réformistes et progressifs plutôt que révolutionnaires. Il est partie prenante à la création du Parti travailliste en 1900 et aussi, plus près de nous, à la refonte de celui-ci dans les années 1990 avec le New Labour de Tony Blair.
[6] Martha Beatrice Potter Webb (1858 – 1943) et son mari Sidney sont des socialistes britanniques bien connus. Beatrice est à l’origine de la Fabian Society et de la création de la London School of Economics (LSE), co-auteur de History of Trade Unionism (1894), et co-créatrice du célèbre magazine labour The New Statesman en 1913. Dans le livre de H.G. Wells The Next Machiavel (1911), les époux Webb, sous le nom des Baileys, sont critiqués comme des bourgeois manipulateurs. La Fabian Society dont Wells fut membre pour une courte période, ne valait pas beaucoup plus à ses yeux. Par ailleurs, Friedrich A. Hayek, consacre en 1948 une critique au brûlot contre l’ouvrage de Béatrice Webb intitulé Our Partnership ; il écrit : « Chez elle, la confiance dans la « direction générale et coercitive » par un expert et dans « liberté supérieure » de la vie en corporation » était une passion, et le dégoût pour toutes les idées, mais en particulier pour le libéralisme gladstonien, qui « pense en terme d’individus », une véritable haine », Economica, août 1948, repris dans Friedrich A. Hayek, Essais de philosophie, de science politique et d’économie, Annexe II, Les Belles Lettres, Paris, 2007.
[7] Le célèbre auteur de romans de science-fiction (1866 – 1946)
[8] George Bernard Shaw (1856 – 1950) fut un critique musical et dramaturge irlandais, essayiste, scénariste, et auteur célèbre de pièces de théâtre. Irlandais acerbe et provocateur, pacifiste et anticonformiste, il obtint le prix Nobel de littérature en 1925.
[9] A l’époque de Lippmann, le Club est déjà noyauté par des éléments entristes, tels que Heywood Broun, un journaliste new-yorkais, qui ourdit un complot afin de fomenter une révolution trotskiste dans le Nouveau Monde. Comme l’écrit Zygmund Dobbs, « Broun became a red under the leadership of Walter Lippman at the Harvard Socialist Club in 1906. », in Keynes at Harvard, Economic Deception as A Political Credo, chap. IX, 1969, Probe Research, Inc., West Sayville, New York.
[10] Cette revue, qui existe encore de nos jours, expose les événements récents et ceux à venir du campus de Cambridge.
[11] John « Jack » Silas Reed, (1887 – 1920), est un journaliste et militant socialiste américain. Témoin enthousiaste de la révolution d’Octobre, il est surtout connu pour son ouvrage Dix jours qui ébranlèrent le monde. Le film de 1981 Reds avec Warren Beatty, Diane Keaton et Jack Nicholson, est basé sur sa vie et celle de sa femme, l’écrivain féministe Louise Bryant.
[12] Graham Wallas (1858-1932), professeur et théoricien en science politique et en relations internationales, a été membre de l’exécutif la Fabian Society de 1888 à 1895. Il en était l’un des trois « mousquetaires », selon l’expression de Shaw. Il quittera, en 1904, cette société car il avait une profonde empathie avec les principes libéraux et il était en faveur du libre échange. Son parcours, d’une certaine manière, préfigure celui que Lippmann empruntera quelques années plus tard.
[13] Steffens est connu pour sa déclaration de 1921, à son retour de l’Union Soviétique : « I have been over into the future, and it works. »
[14] Un muckraker (de muck : fange /ordure / boue et to rake : fouiller… donc en bon français : fouille-merde) est un journaliste ou un écrivain qui enquête et publie des rapports véridiques soulevant des questions de société, généralement en rapport avec la criminalité et la corruption, impliquant souvent des élus, des dirigeants politiques et des membres influents du monde des affaires et de l’industrie. On se souvient des enquêtes menées sur le monopole de la Standard Oil, par exemple.
[15] Paterson est à cette époque la « ville de la soie des Etats-Unis ». Suite à un conflit social, tous les ouvriers de la soie sont en grève et les 300 usines dans la ville sont contraintes de fermer. John Reed décide d’écrire un reportage sur la grève à Paterson. Il est bientôt arrêté et emprisonné à la prison du comté. Walter Lippman arrive alors sur place pour manifester sa solidarité avec Reed, et pour exiger la libération des journalistes, afin qu’ils puissent rendre compte des conflits du travail.
[16] William Howard Taft, (1857 – 1930), est le vingt-septième président des États-Unis. Il a été élu pour un mandat, de 1909 à 1913.
[17] Roosevelt, mécontent de la politique menée par Taft, venait de fonder son nouveau parti, de circonstance.
[18] Lui aussi ancien élève de George Santayana, il est connu pour son livre The Promise of American Life (1909).
[19] Louis Dembitz Brandeis (1856 – 1941), est un avocat américain, membre de Cour suprême des États-Unis ainsi qu’un important soutien au mouvement sioniste américain. Un des principaux conseillers économiques de Woodrow Wilson puis de Franklin Delano Roosevelt, il est un des symboles de l’ère progressiste et un des pionniers d’une concurrence régulée. Il a participé à la création du Federal Reserve System.
[20] Thorstein Veblen, The Engineers and the Price System, Batoche Books, Kitchener, 1921.
[21] J.M. Blum, Public Philosopher, Selected Letters of Walter Lippmann, 1985, New York, Ticknor & Fields.
[22] Walter Weyl (1873-1919) est un des leaders du mouvement progressiste américain. Son ouvrage le plus connu, The New Democracy (1912), est un classique du méliorisme, révélant son chemin vers un avenir de progrès et de modernisation fondée sur des valeurs de la classe moyenne. Le méliorisme est une morale de l’action : le monde n’est pas parfait, mais on peut travailler à son amélioration, dont la fin du Candide de Voltaire donne la parfaite illustration : « cultivons notre jardin ». Alain le qualifiait d’ « optimisme de la volonté ».
[23] Ronald Steel, op. cit.
[24] John Dewey (1859 – 1952) est un philosophe américain spécialisé en psychologie appliquée et en pédagogie. Son système philosophique se rattache au courant pragmatiste développé par Charles S. Peirce et William James. Ses idées politiques et sociales sont proches du socialisme. Il définit la morale ou l’éthique comme la recherche d’un « équilibre » entre le social et l’individuel.
[25] Charles Austin Beard (1874 – 1948) est considéré comme l’un des principaux historiens américains du début du XXe siècle avec Frederick Jackson Turner. Il propose une nouvelle interprétation de l’œuvre des Pères fondateurs des États-Unis en avançant que ces derniers étaient davantage motivés par leurs intérêts économiques que par les principes philosophiques.
[26] Célèbre historien britannique, Bryce (1838 – 1922) entame après des études à Glasgow une carrière de juriste à Londres, puis devient professeur de droit civil à l’Université d’Oxford. Il publie en 1878 son chef d’œuvre, l’Histoire du Saint-Empire romain germanique.
[27] Baker a supervisé l’implication militaire américaine dans la guerre. Comme le Royaume-Uni, les États-Unis disposent uniquement d’une armée de métier. C’est ainsi que l’on doit à Baker et a son assistant, qui ont besoin de trouver des volontaires, la célèbre affiche de l’Oncle Sam pointant son index vers le lecteur.
[28] L’Inquiry (l’Enquête) devait préparer les documents pour les négociations de paix après la Première Guerre mondiale Le groupe, composé d’environ 150 universitaires, a été dirigée par le conseiller présidentiel Edward House et supervisé directement par le philosophe Sidney Mezes. Certains membres de la Commission établirent plus tard le Council on Foreign Relations, entité indépendante du gouvernement.
[29] Craufurd. D. Goodwin (1995), « The Promise of expertise: Walter Lippmann and policy sciences », Policy Sciences, 28, p. 317-345, Kluwer Academic Publishers, Pays-Bas, p. 336.
[30] (1865 – 1959), historien de l’art spécialiste de la Renaissance italienne.
[31] Walter Lippmann est l’inventeur de cette expression.
[32] Steel, op. cit., p. 164-165.
[33] Walter Lippmann, Le Public fantôme, trad. Laurence Decréau, présentation par Bruno Latour, Paris, Démopolis, 2008.
[34] Walter Lippmann, Public Opinion, partie II, chap. II, section 3.
[35] « La création du consentement n’est pas un art nouveau. Il en est un très ancien et était supposé disparaître avec l’apparition de la démocratie. Mais ce n’est pas le cas. La technique de cet art a, en fait, été énormément améliorée, parce qu’elle est à présent basée sur l’analyse plutôt que sur des règles approximatives. Ainsi, grâce aux résultats de la recherche et de la psychologie, associée aux moyens de communication modernes, la pratique de la démocratie a effectué un tournant. Une révolution est en train de prendre place, infiniment plus significative que tout déplacement du pouvoir économique. », op. cit., partie V, chap. XV, section 4.
[36] Ce groupe fondé par Gérard Bardet, André Loizillon et John Nicolétis est né à l’automne 1931 et est transformé en 1933 en Centre polytechnicien d’études économiques. On compte parmi les acteurs de ce groupe Raymond Abellio, Alfred Sauvy, Louis Vallon, Jean Coutrot, Jules Moch.
[37] Ce dont le général lui sera toujours reconnaissant, y compris lorsque, en 1962, Lippmann se retourne contre lui dans L’Unité occidentale et le Marché commun, ouvrage dans lequel il critique vertement la remise en cause du monopole atomique américain au sein du camp occidental à laquelle la France se livre.
A lire également :




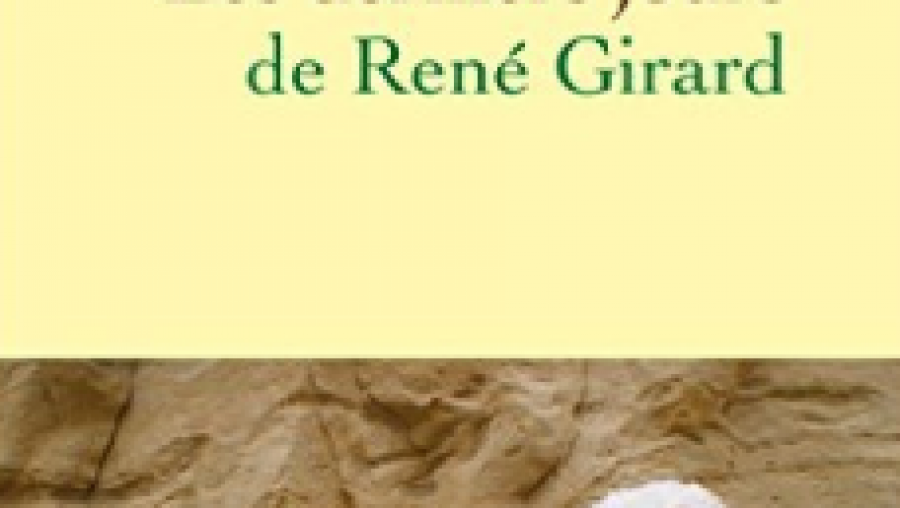
Laisser un commentaire
Créer un compte