Diagnostic pauvreté : 1- Le Bangladesh
Diagnostic pauvreté : 2- Le Chili
Diagnostic pauvreté : 3- L’évolution économique de la Suède
Depuis Montréal, Québec.
 Vers le milieu du XXe siècle, la Nouvelle-Zélande est devenue paralysée par une doctrine d’isolationnisme économique. C’était l’une des économies les plus règlementées, protégées et étatisées du monde. La priorité des fonctionnaires interventionnistes était de maintenir le plein emploi au prix d’une inflation volatile et destructrice. Le keynésianisme étatique était l’idéologie dominante.
Vers le milieu du XXe siècle, la Nouvelle-Zélande est devenue paralysée par une doctrine d’isolationnisme économique. C’était l’une des économies les plus règlementées, protégées et étatisées du monde. La priorité des fonctionnaires interventionnistes était de maintenir le plein emploi au prix d’une inflation volatile et destructrice. Le keynésianisme étatique était l’idéologie dominante.
À la fin des années 1950, la Nouvelle-Zélande se classait au troisième rang mondial selon le PIB par habitant, juste après les États-Unis et le Canada. En 1984, selon ce même classement, la Nouvelle-Zélande avait chuté au 27e rang, au niveau du Portugal et de la Turquie. De plus, le taux de chômage avait atteint 11,6 %, le budget de l’État était en déficit continuel depuis 23 ans, atteignant même parfois jusqu’à 40 % du PIB.
Entre 1973 et 1984, le pays a été secoué par diverses crises économiques reliées aux politiques destructrice du Premier ministre Robert Muldoon, du National Party. Dans le but de réduire le chômage, il lança sa stratégie Think Big, d’immenses investissements étatiques visant à substituer les importations, et qui se sont révélés être des échecs. Il a instauré des contrôles de prix et de salaires pour contenir l’inflation, avec les résultats habituels : pénuries, chômage et encore plus d’inflation. Il a aussi endetté le gouvernement pour soutenir la devise sur les marchés des changes. On dit qu’à l’époque, environ 40 % de la dette étrangère de la Nouvelle-Zélande était reliée aux projets Think Big et au soutien de la devise. Il a finalement mis en place des mesures protectionnistes telles que des tarifs douaniers.
Suite à l’élection de 1984, c’est la gauche qui a pris le pouvoir, avec le Labour Party qui a mis les réformes libérales en branle, ce qui sembla étrange à l’époque. En fait, toutes les autres stratégies avaient échoué, la seule solution restante consistait donc à se tourner vers le mécanisme de marché.
La banque centrale fut réformée, devenant indépendante du pouvoir politique. Son objectif de maintenir le plein emploi fut changé pour un objectif de stabilité des prix, avec une cible d’inflation de 0 % à 3 %. La devise a été dévaluée de 20 %. Le commerce extérieur a été libéralisé. Les tarifs douaniers moyens ont chuté de 27 % à 7 % entre 1986 et 1997. Puis le secteur financier a été le premier à être libéralisé.
Les tâches des diverses administrations publiques ont été recentrées sur le véritable rôle de l’État. Ont été privatisés : les télécommunications, les transports aériens, les services d’irrigation, les entreprises informatiques, les imprimeries gouvernementales, les compagnies d’assurances, les banques, les institutions financières, les institutions de crédit immobilier, les chemins de fer, les transports routiers de personnes, les hôtels, les transports maritimes, les firmes de conseils du monde agricole, etc.
Entre 1987 et 1994, les privatisations ont touché des organisations qui représentaient environ 12 % du PIB auparavant. Ces ventes ont totalisé 13 milliards de dollars, l’équivalent du quart de la dette étrangère du pays. Au total, le transfert au secteur privé de toutes ces activités s’est traduit par une augmentation de leur productivité et une baisse des prix de leurs produits ou services. Ce fut, en définitive, un gain net important pour l’économie du pays.
Il a aussi été décidé que d’autres administrations étatiques pouvaient être gérées comme des entreprises du privé : elles devraient alors être capables de faire des profits et de payer des impôts, comme par exemple les activités relatives au contrôle aérien. Toutes ces agences coûtaient à l’État environ un milliard de dollars par an. Maintenant elles versent un milliard de dollars par an à l’État en dividendes et impôts.
Les effectifs des administrations publiques ont été réduits de 66 % ; la part de l’État dans le PIB est tombée de 44 % à 27 %. Le budget de l’État est alors devenu excédentaire, ce qui a permis de réduire la dette publique de 63 % à 17 % du PIB. Ce qui a permis de réduire de moitié le taux d’imposition sur le revenu et de supprimer un certain nombre de taxes annexes. Les Néozélandais ont décidé qu’il n’y aurait que deux types d’impôts : un impôt sur les revenus et un impôt sur la consommation. Par ailleurs, la progressivité du système fiscal a été grandement réduite. Ainsi, pour les revenus élevés, le taux d’impôt de 66 % pour la tranche supérieure est passé à un taux uniforme de 33 %. Pour les plus faibles revenus, un taux de 19 % a été retenu, alors que les tranches inférieures étaient auparavant taxées à 38 %. Une taxe unique sur la consommation de 10 % et tous les autres impôts ont été supprimés : impôts sur les plus values en capital, impôts sur le patrimoine, etc. Paradoxalement, comme le suggère la courbe de Laffer, les recettes de l’État ont augmenté de 20 % malgré toutes ces baisses d’impôt. La redistribution de la richesse dans la société a été accomplie notamment à l’aide de la taxation négative, une mesure vantée par Milton Friedman.
Au niveau du système d’éducation, dont la réforme a débuté en 1989, la bureaucratie a été grandement réduite et un système de bons d’éducations, ou vouchers, a été adopté, permettant d’introduire de la concurrence dans le système. Avant cette réforme, 85 % des élèves fréquentaient l’école publique. Un an après, ce pourcentage était passé à 84 %, mais trois ans plus tard, il était remonté à 87 % et la performance des étudiants s’est grandement améliorée. Les écoles publiques doivent maintenant bien faire leur travail si elles désirent attirer les étudiants et rester en affaires.
La même chose s’est produite dans le domaine de la santé, où le payeur et le fournisseur du service ont été séparés, afin de donner un choix aux consommateurs et introduire de la concurrence. Les institutions publiques ont fait face à la concurrence d’entreprises privées. La performance du système s’est nettement améliorée.
Pour alléger la règlementation, la solution retenue a été de réécrire les lois en les simplifiant. Par exemple, la nouvelle loi sur l’environnement, le « Resource Management Act », faisait 348 pages, mais remplaçait une loi qui remplissait un volume d’une épaisseur de près d’un mètre. Autres exemples : le Code des impôts, les lois relatives à l’agriculture, celles relatives à la sécurité et la santé, etc.
Le marché du travail a été réformé très tardivement, en 1991 avec le Employment Contract Act (ECA). Sous son égide, les syndicats ont perdu leur exemption d’impôt et l’obligation d’adhérer au syndicat fut abolie ; le libre-choix allait prévaloir. Les prestations d’assurance chômage ont été aussi resserrées, tant au niveau des critères d’admissibilité que de la valeur des prestations, ce qui a eu un effet positif sur l’emploi. Une plus grande flexibilité du marché du travail permet de réduire le chômage et c’est ce qui fut observé en Nouvelle-Zélande.
Les résultats
Les résultats des réformes ont été mauvais au cours des sept premières années, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le parti de gauche qui a pris le pouvoir en 1984 n’a pas cru bon de couper les dépenses de l’État avant de libéraliser le secteur financier et d’abaisser les barrières protectionnistes. L’immense déficit du gouvernement a eu comme impact de faire monter les taux d’intérêt et le taux de change, ce qui a mis du plomb dans l’aile des entreprises néozélandaises, devant maintenant faire face à une plus forte concurrence étrangère suite à la libéralisation du commerce.
L’investissement et l’emploi ont alors grandement souffert de cette situation, ce qui a empiré encore plus la position fiscale du gouvernement. Le parti Labour a réagi en précipitant les privatisations d’entreprises, ce qui n’est jamais une bonne idée. Les privatisations graduelles en période de croissance économique et de surplus budgétaires permettent généralement d’obtenir de biens meilleurs prix pour les actifs. Les réformes auraient commencé sur une bien meilleure note avec un budget équilibré et une cote de crédit AAA pour l’État.
Pourquoi avoir d’abord libéralisé le secteur financier ? Parce que comme c’est le cas partout, les banques ont un très grand pouvoir politique grâce à leurs puissants lobbies. En fait, cette industrie a été la seule à connaître une forte performance entre 1984 et 1987.
Par ailleurs, le bon sens économique aurait voulu que le marché du travail soit libéralisé avant l’abaissement des barrières protectionnistes et la libéralisation du secteur financier. Les réformes de la main-d’œuvre prennent beaucoup de temps à s’implanter, il est donc souhaitable de les faire tôt dans le processus, alors que le secteur financier s’ajuste très rapidement aux nouvelles conditions.
Les principaux produits d’exportation de la Nouvelle-Zélande étaient toujours la laine, la viande et les produits laitiers ; donc des produits issus de l’agriculture, une industrie où le protectionnisme a toujours été prépondérant presque partout dans le monde. Étant donné l’existence de cette barrière protectionniste, il fallait donc diversifier les exportations, ce qui prend beaucoup de temps et requiert un marché du travail flexible, ce qui n’était pas le cas en Nouvelle-Zélande avant 1992. En revanche, la découverte d’importantes réserves de minéraux en Australie a permis à ce pays de véritablement prendre son envol.
Puis le début des années 1990 a été marqué par une récession internationale qui a encore plus empiré la situation de la Nouvelle-Zélande. La libéralisation du secteur financier dans un système bancaire à réserves fractionnaires avait engendré un boum de crédit, dont l’affaissement a contribué aux malheurs économiques du pays.
Ce n’est qu’en 1991-1992 que les réformes du marché du travail furent entamées, ce qui a permis aux entreprises d’améliorer leur compétitivité et de mieux concurrencer sur les marchés mondiaux. Une forte période de croissance économique a alors débuté.
Grâce aux réformes, le déclin économique relatif de la Nouvelle-Zélande a été stoppé, mais ne fut que très peu renversé. Néanmoins, durant les années 1990, l’économie du pays a crû plus vite que celle de l’Allemagne et du Japon, soit un rythme de croissance parmi les plus élevés de l’OCDE, ce qui n’est pas peu dire.
Aujourd’hui, la Nouvelle-Zélande est classée troisième par l’Institut Frazer pour son niveau de liberté économique. Le pays fait très bien à l’égard de ses indicateurs de développement tel que le Basic Capability Index (98,1 %), l’espérance de vie (74 ans), la corruption (9,4 soit l’une des meilleures cote au monde) et de la performance environnementale (88,9 %).
Conclusion
La libéralisation d’une économie est une tâche monumentale qui requiert beaucoup de temps et une exécution sans failles, surtout pour une nation où l’étatisme s’est développé durant des décennies. Des conséquences négatives à court et moyen termes sont inévitables, surtout lorsque l’exécution fait défaut, mais les bénéfices à long terme sont indéniables.
Selon moi, les défenseurs du libéralisme n’aident pas leur cause en évitant de parler des exemples de libéralisation qui ont mal tourné, comme celui de la Nouvelle-Zélande ou de la Bolivie ou du marché de l’électricité californien. En fait, lorsque l’on se donne la peine de bien analyser ce qui s’est vraiment passé, on réalise que d’importantes leçons sont à tirer de ces échecs et que ces derniers sont dus à d’importantes failles dans le processus de libéralisation. Finalement, les échecs de l’étatisme sont beaucoup plus flagrants et prépondérants, il n’y a donc aucune raison de cacher les petits écarts inattendus du libéralisme pour en préserver une image parfaite. Le libéralisme n’est pas le système optimal, mais c’est tout de même le meilleur système, ou le moins pire si on veut.
—-
Sur le web.



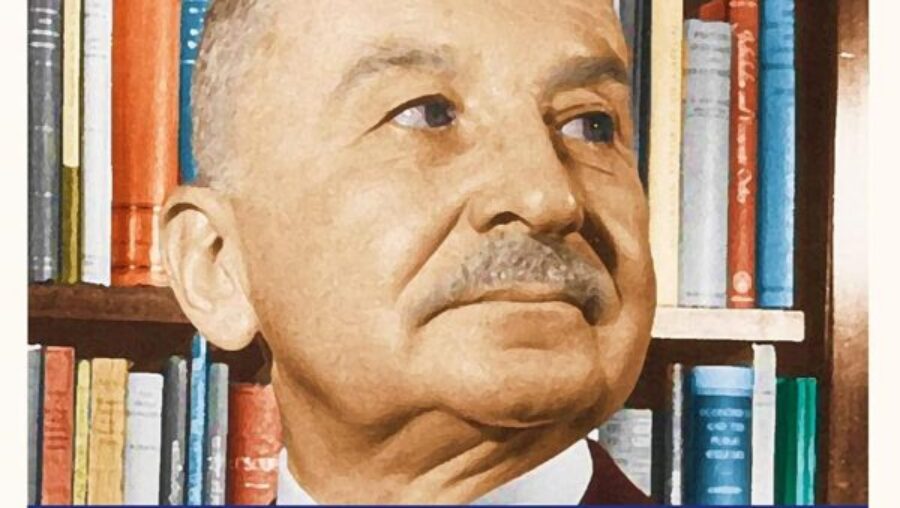

Il est impossible de faire passer ces réformes en France, les français sont manipulés par les gauchos .