Après la mort de Kim Jong-il, ce qui lui fait suite pourrait se révéler pire encore si une lutte de pouvoir incertaine dérive en un conflit armé.
Par Doug Bandow (*), depuis les États-Unis
Article publié en collaboration avec le Cato Institute
Le “Cher Leader” de Corée du Nord, Kim Jong-il est mort. Il n’est pas question désormais de négocier et d’appliquer un nouvel accord nucléaire avec la Corée du Nord dans un avenir proche. La soi-disant République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) est toute entière dévorée par une lutte de pouvoir qui pourrait tourner à la violence. La meilleure option politique de Washington est de prendre du recul et d’observer.
Après son accident vasculaire cérébral d’il y a trois ans, Kim oint son plus jeune fils, Kim Jong-un, pour en faire son successeur. Toutefois, ce dernier a eu peu de temps pour s’établir. Le transfert familial précédent des pouvoirs à Kim Jong-il a pris environ deux décennies. Il y a plusieurs prétendants potentiels à l’autorité suprême de la Corée du Nord, et les militaires peuvent jouer faiseur de rois.
Certains observateurs espèrent voir un “printemps coréen”, mais la population essentiellement rurale de la RPDC est un véhicule peu probable de changement. Les élites urbaines sont susceptibles de vouloir une réforme, mais pas une révolution. Si un Mikhaïl Gorbatchev nord-coréen est tapi dans le fond, il devra se mouvoir lentement pour survivre.
Pendant cette période d’incertitude politique, aucun officiel n’est susceptible d’avoir le désir ou la capacité de conclure un accord abandonnant l’arme nucléaire nord-coréenne. Le leadership se focalisera sur les affaires intérieures et personne n’est susceptible de remettre en question l’armée, qui elle-même peut se désagréger politiquement.
La Chine n’est pas non plus susceptible de jouer un rôle utile. Pékin considère que le statu quo sert son intérêt. Par-dessus tout, la Chine va chercher la stabilité, bien qu’elle puisse très bien tenter d’influencer le processus de succession en dehors de la sphère publique. Mais la Chine ne veut pas ce que l’Amérique veut, préférant la survie de la RPDC, avec de préférence un leadership plus responsable et plus souple.
Washington ne peut guère intervenir dans ce processus. Les États-Unis devront maintenir leur volonté de parler avec la Corée du Nord. Les responsables américains devraient également impliquer Beijing quant à l’avenir de la péninsule, en explorant les préoccupations chinoises et en cherchant à trouver des zones de compromis possibles. Par exemple, Washington devrait s’engager pour qu’il n’y ait pas de bases américaines ou la présence de troupes dans une Corée réunifiée, ce qui pourrait apaiser les craintes de Pékin quant à l’impact d’un effondrement nord-coréen.
Le plus important, c’est que l’administration d’Obama ne se précipite pas pour “renforcer” l’alliance avec la Corée du Sud en réponse à l’incertitude qui règne dans le Nord. La République de Corée est bien capable de se défendre elle-même. Elle devrait prendre les mesures nécessaires pour dissuader l’aventurisme nord-coréen et développer ses propres stratégies pour traiter avec Pyongyang. L’Amérique devrait se retirer d’un engagement de sécurité coûteux, qui ne sert plus ses intérêts.
Kim Jong-il imposa d’inimaginables épreuves au peuple nord-coréen. Cependant, ce qui lui fait suite pourrait se révéler pire encore si une lutte de pouvoir incertaine dérive en un conflit armé. Au lieu d’encourager Pékin à user de son influence pour amener la dynastie Kim à une fin plutôt clémente, les États-Unis peuvent – et doivent – ne faire guère plus qu’observer les développements du Nord de la Corée.
—-
Article originellement publié le 19.12.2011 sur Cato@Liberty, reproduit avec l’aimable autorisation du Cato Institute.
Traduction : JATW pour Contrepoints.
(*) Doug Bandow est un chercheur associé au Cato Institute. Il fut un assistant spécial de Ronald Reagan, il est l’auteur de Foreign Follies: America’s New Global Empire (chez Xulon).

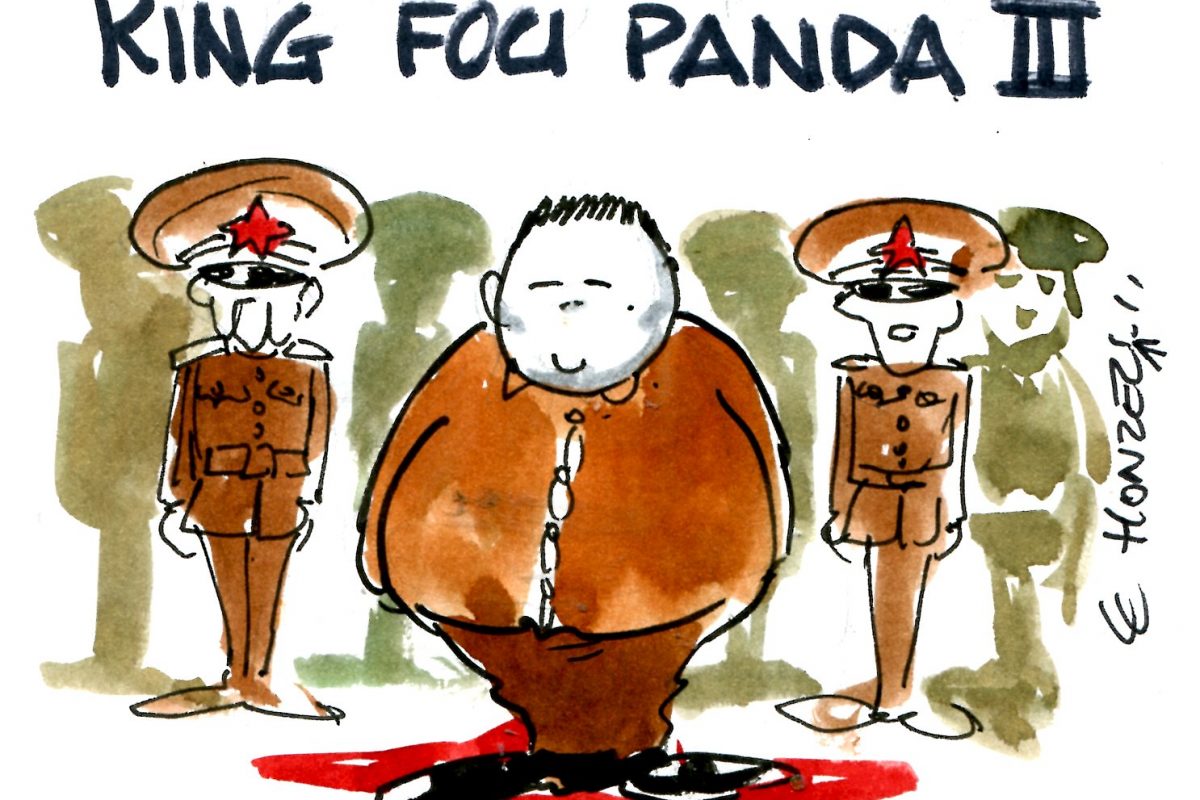

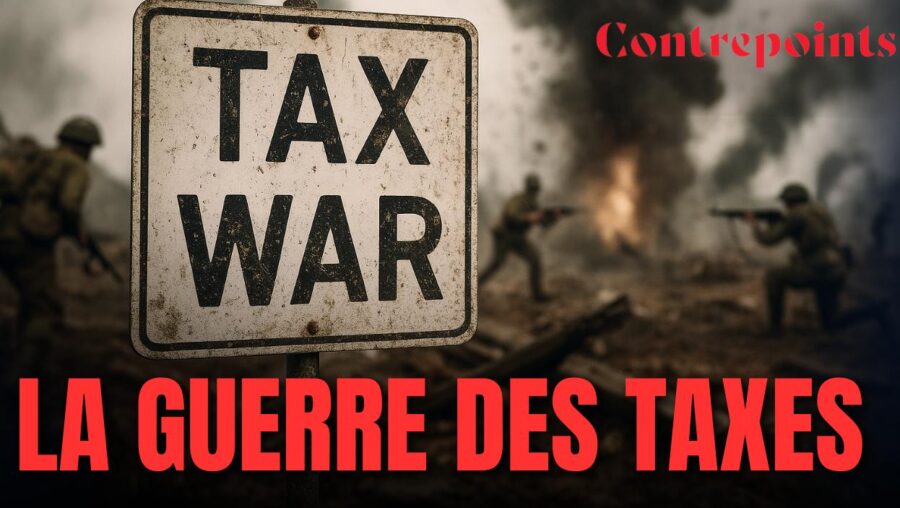


Laisser un commentaire
Créer un compte