Imaginez que des parents financent les études de leurs enfants, en fermant les yeux, sans se soucier d’orientation, de réussite et de projet personnel. Si de tels parents ont à assumer l’intégralité du coût des études de leur progéniture, alors il arrivera un moment où ils demanderont des comptes. Ce n’est pas qu’ils soient économistes de formation, mais c’est dans la nature des relations humaines : si mon enfant me réclame tous les jours de l’argent de poche, je veux en connaitre son utilisation. S’il veut être libre d’affecter l’argent aux usages qu’il désire, alors il devra gagner lui-même son propre argent. Tel est le prix de la liberté : il faut donner en contrepartie du temps à la collectivité. C’est le sens du travail : la vraie solidarité.
En France où l’on pose par principe que l’éducation constitue un service public, les parents ne prennent plus en charge l’intégralité du coût des études, même s’ils le font indirectement en tant que contribuable. Mais le contribuable n’a ni la même liberté ni la même responsabilité que le parent. Et plus il assume par la force des choses le rôle de contribuable, plus il se désengage de son rôle (irremplaçable) de parent. Or plus l’implication financière des parents (ou des étudiants) se réduit au fur et à mesure que grandit la sphère de la prise en charge publique, et plus le sens de la responsabilité est émoussé, entrainant une spéculation collective digne du pari pascalien.
Car il y a la spéculation que l’on voit et que l’on s’empresse de dénoncer à chaque secousse boursière, et il y a la spéculation invisible que l’on ne contrôle plus mais qui engloutit pourtant notre argent à tous puisqu’il s’agit de l’argent public. Or n’oublions jamais que l’argent public n’est pas l’argent de l’État, mais l’argent que l’État nous a prélevé pour le gérer en notre nom afin de financer des biens et services publics qui ne sauraient être produits et gérés par les acteurs privés. Admettons qu’il existe des biens et services publics qui ne sauraient être produits et gérés par des acteurs privés, rien ne garantit pour autant que l’État soit rigoureux et compétent dans la gestion de tels biens, surtout s’il s’en accorde le monopole créant les conditions d’une absence totale de contre-pouvoir et d’obligation de résultats.
Chaque année, la France consacre un budget important aux étudiants sans aucune évaluation de son résultat, juste pour faire du quantitatif, faisant croire au passage à certains jeunes esprits qu’ils sont faits pour les études alors qu’ils sont tout bonnement égarés dans des filières de complaisance ou des formations sans débouchés. Je fais ce constat amer sans réjouissance aucune. Mais chaque année, je suis convoqué pour les examens de rattrapage. Je compose de nouveaux sujets et je viens surveiller les épreuves (ce qui constitue un temps précieux pris sur mon temps de chercheur). Et chaque année, j’observe que la moitié des étudiants (par rapport au nombre d’étudiants officiellement inscrits) que l’on cherche pourtant à repêcher, ne s’est pas dérangée.
Je suis sans arrêt à l’affût d’étudiants motivés et qui veulent s’en sortir, et je consacre à cet effet une grande partie de mon temps à la coopération académique à l’étranger, notamment dans les pays émergents (en Thaïlande, en Syrie, en Algérie, au Maroc ou aux Comores…) où je rencontre d’excellents étudiants [1]. Par respect pour ces étudiants étrangers, sérieux et motivés, il faut aussi dénoncer ceux qui utilisent l’inscription à l’université française pour obtenir une carte de séjour et contourner ainsi les lois sur l’immigration, la motivation pour les études étant plus que secondaire (puisque ces étudiants inscrits ne viennent pas en cours). À leurs yeux, la qualité et la générosité du modèle social exercent plus d’attraction que l’excellence annoncée de notre système d’enseignement supérieur. Un économiste ne saurait leur reprocher d’être rationnel. C’est à nous de changer un système qui envoie des incitations qui ne sont pas de nature à faire émerger les meilleurs éléments et les meilleurs comportements. Il faut donc sélectionner et cela s’applique aussi aux étudiants français, sans discrimination fondée sur l’ethnie, le sexe, la religion ou la couleur de la peau. Seules les qualités personnelles et individuelles, les compétences acquises et la motivation comptent (c’est cela la vision humaniste et positive de l’individualisme), et elles peuvent être partout.
C’est pourquoi je suis aussi sévère à propos de ces étudiants français, qui se disent inquiets pour leur emploi et les perspectives de carrière, mais qui évitent les filières de formation offrant des débouchés alors que les secteurs concernés par ces formations peinent à trouver du personnel qualifié français. Alors en effet, un critère de sélection fondé sur la race, l’origine ou la religion ne saurait être pertinent ni moralement acceptable. Il faut encourager les cerveaux d’où qu’ils viennent, mais aussi savoir refuser ceux qui n’ont pas le niveau requis pour entrer à l’université, d’où qu’ils viennent aussi. Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. C’est en cela que la sélection est juste et nécessaire, et il ne peut y avoir d’orientation efficace sans évaluation des compétences et des motivations. L’orientation efficace implique une sélection juste.
Encore faut-il vouloir changer les choses. Car l’administration universitaire est complice dans la mesure où la dotation budgétaire que reçoit chaque université – autrement dit la part du gâteau que constitue la manne publique – est fonction du nombre d’inscriptions. Voilà comment on déchaîne un processus qui déclenche un dérapage de la dépense publique sans aucune garantie de résultats en termes d’orientations et de compétences acquises dans une spirale inflationniste que plus personne ne contrôle dans la mesure où un système de gestion collective centralisée efface le principe même de responsabilité. Dans le même temps, alors que notre pays ne se sort pas du problème lancinant du chômage, qui constitue un véritable cancer pour notre société, les entreprises installées en France sont obligées de faire appel à la main-d’œuvre étrangère dans un nombre croissant de secteurs (santé, hôtellerie et tourisme, bâtiment, banque…) et pour des postes qualifiés, à défaut de trouver les compétences (ou les motivations) requises chez nous.
Si l’on est donc en droit de reprocher aux banques de prendre des risques inconsidérés en prêtant à des ménages insolvables, on doit de la même manière épingler les comportements similaires en matière de capital humain, surtout que ce dernier constitue notre capital le plus précieux [2]. La frontière entre l’investissement public et le pur gaspillage est bien fine. Au nom d’une conception erronée et caricaturale de la démocratisation de l’université, la collectivité se retrouve à financer des études d’individus qui n’en ont aucunement le profil, les capacités et les conditions intellectuelles requises.
La dépense publique est un investissement (publiquement rentable à terme) dans la mesure où elle sert à financer les études de ceux – d’où qu’ils viennent – qui auront les aptitudes et la volonté de réussir. Grâce à leurs compétences acquises à l’université, et valorisées sur le marché du travail, ils deviendront demain de futurs contribuables, ce qui est une façon de rembourser la dépense initiale et de rentabiliser l’effort de la collectivité. C’est aussi cela être solidaire : on rend à la collectivité (par les impôts) ce qu’elle vous a avancé (en dépenses d’éducation et de formation).
Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il évaluer et orienter, en d’autres termes, sélectionner, ce qui n’interdit aucunement d’ouvrir le plus largement possible le panel de sélection. La sélection n’est pas anti-démocratique tandis que les plus modestes feront toujours les frais de la non-sélection [3].
Dans le cas contraire, la dépense publique sera réalisée en pure perte si elle ne génère pas un flux de revenus futurs, prenant le risque d’augmenter encore – et au-delà du supportable – la part de la population définitivement à la charge de la collectivité (de futurs chômeurs bardés de diplômes).
—-
Sur le web.
Notes :
- Il faut dire que, dans la plupart de ces pays, le système d’enseignement supérieur est resté très sélectif, le plus souvent calqué sur le fonctionnement des universités américaines de sorte que les étudiants refusés dans leur propre pays cherchent à tenter leur chance en France où il y a moins de sélection. ↩
- On leur reprochait jadis de ne prêter qu’aux riches… Mais effectivement, le métier de financier implique l’évaluation des projets d’investissement en vue de faire la sélection des projets les moins risqués, l’épargne étant une ressource rare alors que ses usages peuvent être nombreux. La finance organise donc l’orientation de l’épargne aux meilleures affectations possibles. ↩
- La sélection s’impose même moralement dans le système public où le coût des études est pris en charge par l’État. En effet, je ne peux pas être libre d’étudier ce que je veux avec l’argent des autres : si je veux être entièrement libre dans le choix de mon orientation, alors je finance intégralement le coût de mes études. Il en est de même pour une entreprise. Si elle veut être totalement libre dans le choix de ses investissements, elle doit autofinancer ses projets. Si elle finance à crédit ou si elle ouvre son capital, elle devra rendre des comptes à sa banque pour obtenir un crédit ou à ses actionnaires pour continuer à bénéficier de l’accès au marché financier. Dans la mesure où l’on dépend des autres, on doit rendre des comptes aux autres. ↩


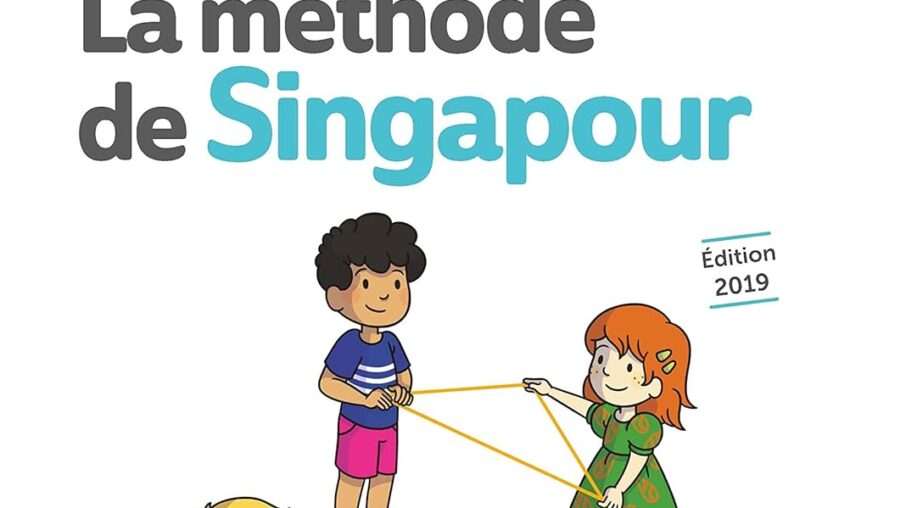

> Il faut encourager les cerveaux d’où qu’ils viennent, mais aussi savoir refuser ceux qui n’ont pas le niveau requis pour entrer à l’université, d’où qu’ils viennent aussi.
Comment donc déterminer le niveau tout en respectant le droit de changer le parcours de formation? Comment permettre aux étudiant avec un BAC L d’accéder aux cours d’études typiquement scientifiques?
Je crois que sous-estimer la question serait une grave erreur.
Très sincèrement, aujourd’hui dans l’immense majorité des cas, le type de bac est déjà une sélection.
Un bac L vaut moins qu’un bac S, ce n’est certes pas un absolu.
Donc des L dans les parcours Scientifiques passent par une année de remise à niveau très basique qu’ils échouent généralement. Ceux qui réussissent tentent une licence, mais j’en n’ai jamais vu en réussir (ce qui ne prouve rien).
Avec une formation L vous n’étes pas équipés pour la science, une remise à niveau s’impose avant de passer les concours. Le droit de changer de formation s’accompagne aussi du devoir de se remettre à niveau pour la nouvelle formation.
Il est impossible de déterminer un quelconque “niveau” absolu, ce qui est évalué c’est votre niveau par rapport aux exigences de la formation à laquelle vous postulez.
RT @Contrepoints: Université : la spéculation invisible Chaque année, la France consacre un budget important aux étudiants sans… http: …
“Grâce à leurs compétences acquises à l’université, et valorisées sur le marché du travail, ils deviendront demain de futurs contribuables, ce qui est une façon de rembourser la dépense initiale et de rentabiliser l’effort de la collectivité.”
Donc parce que l’on a forcé mes parents à payer leurs impôts plutôt que de s’occuper eux-même de mon instruction, je devrais moi même payer des impots toute ma vie ?
non, si on me rend un service, on me donne une facture, je la paye et basta. Le système actuel, tout comme celui que vous proposez d’un vœux pieu (vous nous dites en substance “Il ne faut pas que les gens qui n’ont rien à faire à l’université y aille”) est une mafia : une fois que la mafia a rendu un service, tu en es redevable à jamais.
Le marché est suel à même de diriger les investissement efficacement, qu’ils soient humain ou en capitaux : En payant soit même ses études (par le prêt, le soutien familiale ou le travail) un étudiant est conscient de l’opportunité qui lui est offert et du sacrifice qu’il doit faire pour la saisir. Il va donc travailler pour réussir.
Le système actuel peuple les facs de socio/psycho/LEA/HDA/Musique/Cinéma/Théatre/… avec des feignants (pardon, des “artistes”) qui considère que tout travail est mal par nature, mais ils leur semblent évident que des gens bien moins lotis qu’eux doivent trimer sans relâche pour payer leurs impôts afin de les nourrir.
“Le système actuel peuple les facs de socio/psycho/LEA/HDA/Musique/Cinéma/Théatre/… avec des feignants (pardon, des “artistes”) qui considère que tout travail est mal par nature, mais ils leur semblent évident que des gens bien moins lotis qu’eux doivent trimer sans relâche pour payer leurs impôts afin de les nourrir.”
Mettre des socio/psycho/LEA dans la même catégorie que ceux en musique/cinéma/théatre me parait tellement nul….
Sachant que les capacités d’analyse d’une situation en entreprise d’un socio peuvent être totalement complémentaires de celle d’un gestionnaire (bon ok les mecs sont un peu spécial à la fac, j’en ai côtoyé quelques un avec des cours en commun.).
D’ailleurs la sociologie de gestion est une matière extrêmement intéressante, qui permet un certain recul et une réflexion sur les acteurs/mode de fonctionnement et indicateurs de l’entreprise.
Je ne parle même pas de LEA, qui ont des cours d’économie et de commerce international et de culture étrangère (indispensable en marketing à mon avis) suivant la filière en passant….
Toutes les filières dites “artistique” représente un marché (certe limité), que vous le vouliez ou non.
L’auteur estime qu’il n’y a de sélection à la fac à l’entrée, ce qui est totalement faux. Tous les 5/6 mois, il y a une sélection par les partiels. Qu’on empêche quelqu’un qui n’a pas eu tel ou tel diplôme limiterait de fait ceux qui veulent réussir (voir changer de filière).
“Je fais ce constat amer sans réjouissance aucune. Mais chaque année, je suis convoqué pour les examens de rattrapage. Je compose de nouveaux sujets et je viens surveiller les épreuves (ce qui constitue un temps précieux pris sur mon temps de chercheur). Et chaque année, j’observe que la moitié des étudiants (par rapport au nombre d’étudiants officiellement inscrits) que l’on cherche pourtant à repêcher, ne s’est pas dérangée.”
Oui en première année? C’est ça? Eh bien vous l’avez votre sélection.
Sinon, des chercheurs qui cherchent on en a plein, qui trouve on en a pas beaucoup. Et à ce niveau là, l’argent du contribuable on la regarde plus trop, hein mon cher docteur 😉
Quoi qu’ils soient trop dans ces formations est une autre question et puis c’est typiquement français que de ne baser les connaissances/capacités que sur le diplôme.
@nico
Je parlais personnellement du niveau licence, la ou il n’y a aucune sélection durant les trois première année (sauf dans quelques formations particulière, médecine entre autre). Si tu ne valide pas ta L1, tu peux passer en L2 avec des rattrapages, et ainsi de suite. Tu peux ainsi échouer en 3 ou 4 ans au lieu d’un.
Et je ne dit pas qu’il n’y a pas de marché, ou que c’est inutile. Je suis convaincu qu’il y a un marché pour toutes les formations dispensée en France, simplement, certaines ne rassembleraient que quelques dizaines ou centaines de personnes en France, et non des milliers par fac de province et des dizaines de milliers à Paris.
On peut faire beaucoup de distinctions entre les disciplines artistiques, les “sciences molles” (socio/psycho …) et littéraires (LEA) que j’ai mis dans le même panier pour garder la longueur de mon commentaire dans les limites du raisonnable. Mais vous admettrez que leur point commun principal est un échec énorme de la part des élèves, qui n’est du non pas à la difficulté intrinsèque du domaine (comme en prépa, par exemple, qui impose un rythme que certaines élèves ne peuvent pas supporter, sans avoir la possibilité de le savoir avant) mais simplement par flemme.
Ce sont donc des gens qui dépensent de l’argent public (bourse, aides diverses) et pour qui on en dépense encore plus (coût des études, locaux, salaires) sans qu’ils n’aient aucune considération sur l’origine de cet argent : la sueur d’un salarié du privé qui aurait pu (dû ?) se payer des vacances avec sa famille au lieu de payer des impôts.
De l’aveu de mes collègues maitre de conférence, l’université ne gère pas un niveau, mais un flux d’étudiants.
Il y a sur notre université (sciences) un taux de réussite à maintenir, indépendant du niveau. Donc si tout le monde s’inscrit le niveau baisse.
Tout simplement le système de repêche est déjà symptomatique quand on voit que l’exigence descend de plusieurs crans….
Les université étant financé par leur nombre d’étudiant, elles ne sont pas non plus inciter à se débarrasser de ceux qui n’ont pas le niveau. Ce qui est vrai pour la sélection à l’entrée reste vrai pour l’écrémage.
“Ce sont donc des gens qui dépensent de l’argent public (bourse, aides diverses) et pour qui on en dépense encore plus (coût des études, locaux, salaires) sans qu’ils n’aient aucune considération sur l’origine de cet argent : la sueur d’un salarié du privé qui aurait pu (dû ?) se payer des vacances avec sa famille au lieu de payer des impôts.”
Ce peut être vrai pour l’argent public, même si d’un point de vue personnel je ne pense pas comme vous au niveau de l’écrémage à l’entrée et de la sélection (j’estime que c’est un mal nécessaire et que c’est les possibilité de réorientation du système qui sont mal foutu). D’ailleurs il faudrait m’expliquer pourquoi tout le système est en général basé sur les maths dans toutes les domaines fournissant des emplois, je n’ai toujours pas compris pourquoi au vue de la diminution et de l’utilité plus on monte dans les études.
Concernant les gens qui dépensent l’argent public, là par contre je ne suis pas d’accord (même si personnellement je n’ai jamais eu le droit à un cent à ce niveau là, et j’en aurai bien eu besoin).
Les conditions sont quand même d’être présent sinon la bourse est supprimé par exemple, de même que l’échec si mes souvenirs sont bons (ça il faudrait que je vérifie mais c’est un bordel administratif).
Je vais prendre mon expérience personnel d’étudiant.
Je sors d’un bac STT- Informatique de gestion, personne à l’époque n’aurait misé sur ma réussite en étude supérieure (pas même au bac d’ailleurs). Pourquoi? Parce que si je n’aime pas ou ne comprend pas quelque chose, j’ai vraiment du mal à le travailler (mon principal défaut).
J’ai intégré en première année, une université de sciences en informatique (Paris 6-Jussieu), bien évidemment le niveau en mathématique (d’ailleurs, il n’y avait que ça et très peu d’informatique) était bien supérieur au mien et, démotivé, j’abandonnais juste après les premiers partiels.
J’ai ensuite intégré une première année d’économie gestion, qui fut un échec (totalement de ma faute, démotivé suite à l’année en fac de sciences). J’y ai tout de même validé une partie des matières et me réorientai à nouveau en Administration Economique et Social (AES, si vous connaissez) cette fois.
En première année d’AES, que j’ai eu limite au rattrapage, notamment grâce aux matières économique pour lesquels je me suis découvert une certaine passion (d’excellente note contre de très mauvaise dans les matières comme la psychologie ou la sociologie dont je ne comprenais pas le but). Je me suis juré de ne plus aller aux rattrapages.
J’ai continué jusqu’au master 1, m’intéressant de plus en plus à toute les matières, travaillant de plus en plus, et m’adaptant au système universitaire avec lequel j’ai eu tant de mal, avec des notes en progression constante et même de très bonne notes en dernière année de licence et en Master 1. Rattrapant même mon retard en mathématique d’ailleurs, vu que c’était concret, je savais où ça menait dans les matières de gestion et d’économie, ce qui rend les mathématiques bien plus intéressants d’ailleurs.
A présent, je me trouve en Master 2 de gestion, tout se passe très bien. Mon niveau est équivalent, voir supérieur dans certains domaines, à ceux venant directement d’une licence d’éco-gestion.
La question est: Aurais-je pu faire mon chemin “détourné” si le système n’avait pas été ce qu’il est?
Je précise que j’étais (et suis toujours) salarié (plus de 20 heures par semaine) pendant toutes mes études et que je ne bénéficie d’aucune aide (à part les coûts universitaire qui ne représentent pas ce qu’ils coutent).
Félicitations pour votre courage et votre détermination!
Pour ceux qui sont déterminés et persévérants (dont vous faites apparemment partis) tout est toujours possible. On arrive toujours à trouver une solution et à tirer son épingle du jeux même sans éducation, même sans diplômes, même sans parents riches, je connais personnellement pas mal d’exemple.
L’école c’est surfait et c’est pour les médiocres, les gagne petit, on y apprend pas comme être créatif ou productif mais plutôt comment être un bon petit exécutant (un fonctionnaire quoi). la plupart des gens qui ont réussi de manière éclatante l’on fait sans être des élèves brillants et souvent en ne terminant pas leurs études dont ils se rendaient bien compte qu’elles ne leur apportaient rien.
“L’école c’est surfait et c’est pour les médiocres, les gagne petit, on y apprend pas comme être créatif ou productif mais plutôt comment être un bon petit exécutant (un fonctionnaire quoi). la plupart des gens qui ont réussi de manière éclatante l’on fait sans être des élèves brillants et souvent en ne terminant pas leurs études dont ils se rendaient bien compte qu’elles ne leur apportaient rien.”
Ca dépend des exemples et des époques. Autant je suis tout à fait d’accord que les diplômes sont surfait, mais ils amènent quelque chose qui manque cruellement, la confiance entre les personnes. Bon après le culte du diplôme à la française c’est autre chose…personnellement je pense qu’un BTS a largement les mêmes capacités qu’un doctorant.
Evidemment, ils ne permettent d’être créatif, au fond ce n’est pas leur but, par contre productif, ils permettent tout de même une base faut pas le nier.
Enfin de toute manière la société et les méthodes évoluent tellement vite que l’apprentissage scolaire/universitaire sont dépassé très rapidement mais un prof d’université m’a appris quelque chose de très vrai:
“l’université (ou autre formation supérieur à mon avis) apprend à apprendre”, du moment où c’est acquis le diplôme ne sert qu’à se légitimer (surtout en France).
Les diplômes n’ont que peu de valeurs, mais un docteur et un BTS n’ont, dans la grande majorité des cas pas les mêmes capacités.
Ce n’est ni bien ni mal mais les BTS ne peuvent pas accomplir le travail des docteurs… et les docteurs ne peuvent pas accomplir le travail des BTS.
Qu’est ce que vous entendez par “capacités”?
On prend aussi en compte que la plupart des fac sont totalement boudées par les employeurs qui ne jurent que par les grands écoles privées ? Moi qui suis en 3ème année de Licence en université je sais très bien que je ne serai absolument pas prioritaire par rapport à celui qui a fait ses études en école privée qui a du lui coûter facilement dans les 30000€.
Et de ce fait, beaucoup vont en fac mais certains auront beaucoup de mal à trouver un emploi. Injecter du fric dans quelque chose qui produit énormément de chômeurs est stupide, il faudrait déjà remonter le niveau des universités pour qu’elles soient compétitives avec les grandes écoles.
Le contenu pédagogique est le même, strictement le même.
Ce sont les même profs, les mêmes cours et les mêmes bouquins. La seule différence, c’est le langage et le réseau des grandes écoles, et peut être le fait que l’on t apprenne à te vendre en école, c’est tout. (et encore niveau langage ça change sacrément au niveau master 2)
Testé et comparé.
Alors ce qu’il se passe dans la tête des employeurs (qui est faux d’ailleurs puisque le diplôme ne rentre qu’en troisième position voir plus), seule l’expérience compte.
Rejoins une association, crée toi des expériences, développe des projets, tout ira bien.(évidemment tu ne rentreras pas cadre supérieur dans une boite du CAC40 la première année après le diplôme).