Pourquoi, dans un système bancaire sain et en l’absence de régulateur, une monstruosité, telle celle de Chypre, n’aurait jamais dû exister.
Par Georges Kaplan.
Au 31 décembre 2011, alors que la crise grecque battait son plein, le total du bilan de Laiki Bank était équivalent à 188% du PIB chypriote et la banque opérait avec un effet de levier de 55x (voir page 60). Par effet de levier, j’entends ici le total de l’actif rapporté aux fonds propres – un dessin valant mieux qu’un long discours : un levier de 55x, ça ressemble à ça (en millions d’euros) :
 Alors que la plupart des commentateurs se demandent comment – ô, mon Dieu comment ? – le législateur et la myriade d’instances de contrôle qui sont supposées surveiller les banquiers ont pu laisser passer ça, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, dans un système bancaire sain et même en l’absence de régulateur, un tel monstre n’aurait jamais dû exister.
Alors que la plupart des commentateurs se demandent comment – ô, mon Dieu comment ? – le législateur et la myriade d’instances de contrôle qui sont supposées surveiller les banquiers ont pu laisser passer ça, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, dans un système bancaire sain et même en l’absence de régulateur, un tel monstre n’aurait jamais dû exister.
Le gambit du capital
Au premier abord, on pourrait penser que les actionnaires de Laiki auraient dû être les premiers à s’alarmer d’une telle situation. Après tout, les 601 millions d’euros de capital qui risquent de partir en fumée au moindre coup de tabac, c’est leur argent. De là, un certain nombre de commentateurs en concluent – conformément aux prédictions de l’effet Dunning-Kruger – que les banquiers sont incompétents et donc, qu’il faut les mettre sous la bienveillante tutelle des politiciens (lesquels ne connaissent des banques que les distributeurs automatiques de liquide). Mais en réalité, il existe une situation dans laquelle utiliser des effets de leviers aussi monstrueux au risque de faire sauter la banque de l’intérieur est parfaitement rationnel du point de vue des actionnaires.
Imaginez que vous soyez le gérant d’une petite Sarl dans laquelle vous avez investi 1 000 euros – ce qui fait que vous n’êtes engagé personnellement qu’à hauteur de ces mêmes 1 000 euros – et que vous décidiez, dans un moment d’enthousiasme débridé, de devenir riche en faisant un énorme pari sur le CAC 40. Votre plan consiste à trouver un créancier qui accepte de vous prêter 999 000 euros de telle sorte que, avec le million d’euro dont vous disposez, vous allez pouvoir acheter 250 contrats futurs sur le CAC 40 – soit une exposition totale de 9 282 500 euros à l’heure où j’écris ces lignes (250 x 3 713 x 10) – et gagner 92 825 euros pour chaque point de hausse de l’indice. Avec ce montage simple, vous pouvez gagner des centaines de milliers d’euros si le marché monte et, dans le cas contraire, vous ne perdez que vos 1 000 euros de capital. Admettez-le, c’est tentant : dans ce cas, il est tout à fait rationnel de risquer l’intégralité de votre capital sur un coup de poker.
Évidemment, me direz-vous, il est hautement improbable que vous trouviez un jour un créancier assez stupide pour vous prêter une telle somme alors que non seulement vous n’avez que 1 000 euro de capital mais qu’en plus, vous vous apprêtez à schpiler [1] comme un laquais sur des contrats futurs. Bien sûr, vous avez parfaitement raison : c’est impossible. Sauf si vous êtes une banque.
L’aléa moral
Il se trouve que, depuis des décennies, nos gouvernants et leurs banques centrales se sont mis en tête qu’une banque ne devait pas faire faillite. Entendez-moi bien : il n’est pas ici question, lorsqu’une banque est en difficulté, de sauver ses actionnaires mais ses créanciers, ceux qui lui permettent de s’endetter et, au premier chef, les déposants. Fonds de garantie des dépôts bancaires, lignes de crédit et prises de participations des États, prêts à taux défiant toute concurrence de la banque centrale… Depuis des décennies, les pouvoirs publics – et donc les contribuables – se portent systématiquement garants des dettes de leurs banques et mettent tout en œuvre pour que les créanciers de ces dernières soient à l’abri en cas de faillite.
Seulement voilà, cette habitude – qui part sans doute des meilleures intentions du monde – a une conséquence : les banques peuvent tout à fait prendre des risques parfaitement démesurés tout en trouvant sans difficulté des financements pour gonfler leurs bilans. Très simplement : les créanciers des banques parient sur ces aides publiques et, presque à chaque fois, ils ont raison. C’est ce qu’on appelle un aléa moral : plus les pouvoirs publics laissent à penser que les contribuables sont garants des dettes des banques, plus les banques peuvent s’endetter à bon compte, plus le système est instable.
L’exemple de Lehman Brothers est des plus parlants. Alors que tout le monde – j’ai bien dit tout le monde – savait que la banque de Dick Fuld opérait avec un effet de levier de l’ordre de 31x et collectionnait les actifs abominables, le spread CDS à 5 ans de Lehman Brothers entamait l’année 2008 à peine au-dessus de 1%. Ce n’est qu’en mars, quand le marché a commencé à douter d’un sauvetage de Bear Stearns, que le spread s’envole au-delà de 4%. Regardez bien la suite sur cette capture d’écran Bloomberg : le 14 mars, Bear Stearns est sauvé et que fait le spread CDS de Lehman ? Il repasse tranquillement sous le seuil des 2% : la musique joue toujours, le bal continue. Dans ce cas-là, à la louche, on peut estimer que l’aléa moral réduisait le coût de financement de Lehman Brothers de pratiquement 2% ; de 2% sur plus de 600 milliards de dollars de dette.
Dura lex, sed lex
La solution est extrêmement simple : il faut laisser les banques faire faillite. Les actionnaires doivent perdre l’intégralité de leur investissement et, si c’est nécessaire, les créanciers de la banque doivent y passer aussi (en respectant le principe de séniorité des déposants). L’application de ce principe ne doit souffrir aucune exception : c’est la règle du jeu, elle doit être connue de tous et appliquée systématiquement. Vous aurez beau réglementer les banques à hue et à dia, vos lois seront – au mieux – inefficaces tant qu’actionnaires et créanciers n’auront pas la certitude d’être les premiers à payer en cas de problème.
Le capitalisme ne fonctionne que s’il est aiguillonné par des opportunités de profits et tempéré par des risques de pertes. C’est de l’équilibre entre ces deux incitations fondamentales que dépend sa capacité à s’autoréguler : réduisez les perspectives de profits et vous ferez immanquablement chuter les investissements – c’est-à-dire la croissance future ; réduisez les risques de pertes et vous encouragerez à coup sûr les investissements les plus spéculatifs – c’est-à-dire la prochaine crise. C’est la règle du jeu. Si vous empêchez le système de fonctionner, ne vous plaignez pas quand il ne fonctionne pas.
—
Sur le web.
Note :
- Argot, de l’allemand spielen (jouer) : comprenez « spéculer comme un goret ». ↩

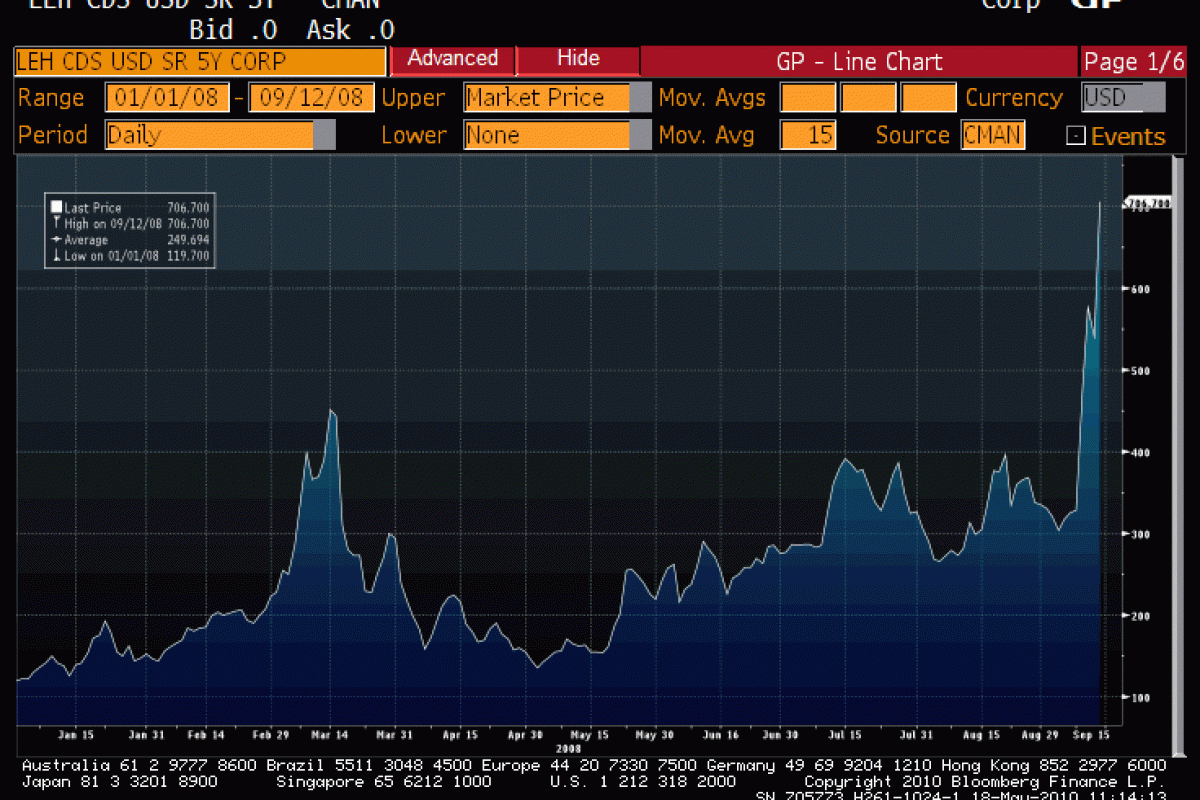


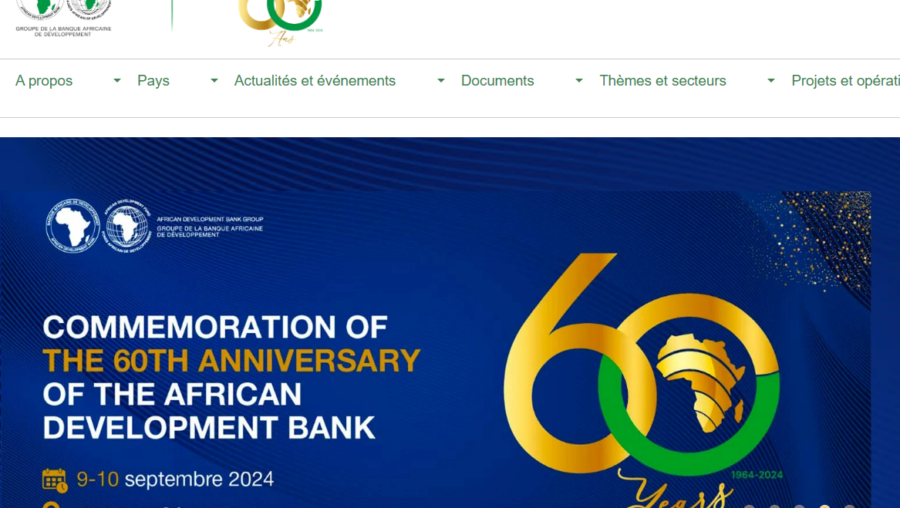

A l’heure où je lis ces lignes, le contrat future est à 3733, Vu côté actionnaire, la perte possible de 1000 euros est ridicule par rapport au gain de près de 2 millions. Donc on se trompe si l’on pense qu’impliquer l’actionnaire aura un effet. Le point important est de bien faire payer les créanciers imprudents dans le respect de l’ordre de séniorité établi au départ, et d’éviter que des créanciers puissent venir s’intercaler, “à la BCE”, dans cette liste de priorité sans l’accord de ceux qu’ils rejettent plus loin.
@MichelO
“Donc on se trompe si l’on pense qu’impliquer l’actionnaire aura un effet”
Tout d’abord, ce n’est pas de l’actionnaire n’ayant que 1000€ de capital dont parlait Georges Kaplan. Ce n’était qu’un exemple. Imaginez un actionnaire ayant 1, 10, 100 ou 500 Millions d’euros, voire plus, de capital dans la banque. Croyez-vous que la perspective de perdre ces sommes lui serait indifférente? D’autre part, même 1000€ peuvent représenter une somme importante au regard de certains actionnaires, ceux qui ont des revenus modestes. Il y a des petits porteurs qui se montrent plus acharnés que des gros lors des AG alors qu’ils n’ont perdu qu’une somme ridicule en valeur absolue part rapport à celle perdue par les gros.
Je me suis peut-être mal exprimé, mais je voulais faire remarquer que la responsabilisation de l’actionnaire consécutive à la suite de la perte qu’il subit dans une faillite est marginale, et un faux-semblant et un alibi pour maintenir les irrégularités dans le traitement des principaux créanciers. Cela d’autant que l’actionnaire est en principe conscient du levier formidable appliqué à ses fonds, et que si toute perte est douloureuse, on ne joue en levier 50 que des sommes qu’on peut néanmoins admettre de perdre.
Et les créanciers? Ce sont eux qui permettent le levier, après tout, en prêtant 50 fois les fonds propres.
Si on arrête de leur promettre le sauvetage coute-que-coute, seront-ils toujours aussi nombreux au portillon?
Excellent article
Toujours aussi bon. Merci.
Établissons des banques à responsabilité illimitée comme avant…Ou comme les banques privées Suisses!
Drôle de titre…
“dans un système bancaire sain et en l’absence de régulateur”
S’il n’y a pas de régulateur, je doute que cela puisse être un système sain.
Le régulateur sera la concurrence M Lafayette, et donc au libre choix se en quoi votre ancêtre croyait.