C’est l’histoire de ce péché capital que raconte Florent Quellier, historien de l’alimentation.
Par Jean-Baptiste Noé.
 De tous les péchés, la gourmandise est le plus toléré, le plus accepté. C’est l’histoire de ce péché capital que raconte ici Florent Quellier, historien de l’alimentation, en s’attachant à montrer les évolutions temporelles de notre rapport à la nourriture et à la table. Si la goinfrerie a toujours suscité la réprobation, car signifiant un manque de maîtrise de soi, une incapacité à se tenir, la gourmandise, lorsqu’elle se lie aux arts de la table, rejoint le domaine de la civilité et du savoir-vivre. La tolérance complice de l’Église a contribué à faire accepter les plaisirs de la table, d’autant que de nombreux ordres religieux sont à l’origine de recettes et de friandises raffinées. Cela explique la dichotomie entre pays protestants et pays catholiques dans le rapport à la nourriture. La gastronomie s’inscrit ainsi dans la géographie, et c’est une véritable géopolitique du goût qui se dessine.
De tous les péchés, la gourmandise est le plus toléré, le plus accepté. C’est l’histoire de ce péché capital que raconte ici Florent Quellier, historien de l’alimentation, en s’attachant à montrer les évolutions temporelles de notre rapport à la nourriture et à la table. Si la goinfrerie a toujours suscité la réprobation, car signifiant un manque de maîtrise de soi, une incapacité à se tenir, la gourmandise, lorsqu’elle se lie aux arts de la table, rejoint le domaine de la civilité et du savoir-vivre. La tolérance complice de l’Église a contribué à faire accepter les plaisirs de la table, d’autant que de nombreux ordres religieux sont à l’origine de recettes et de friandises raffinées. Cela explique la dichotomie entre pays protestants et pays catholiques dans le rapport à la nourriture. La gastronomie s’inscrit ainsi dans la géographie, et c’est une véritable géopolitique du goût qui se dessine.
Cette géopolitique est tout autant sociale que territoriale. Les princes et les cours ont contribué au développement de la bonne chère, à la promotion des plats fins et des mets raffinés. Ce faisant, en étant prêts à payer cher pour avoir de bons cuisiniers et de bons produits, ils ont permis à la cuisine de poursuivre ses progrès.
Jusqu’au XVIIIe siècle, gourmet désigne l’amateur de vin, et friand l’amateur de bonne chère. C’est au XVIIIe siècle que gourmet commence à désigner l’amateur de la chère, et qu’il va de pair avec la gourmandise. C’est le lent travail de civilisation de la table et des mœurs qui a permis de faire entrer la gourmandise parmi les arts libéraux, ce qui lui vaut le qualificatif d’art de la table. Autour de la gourmandise se codifient les manières de préparer les plats et les manières de les manger. De même qu’il y a des propos autorisés à table, et d’autres, prohibés. La gourmandise tisse ainsi des liens avec la littérature, l’esprit intellectuel, les bons propos. La table n’est plus uniquement le lieu où l’on mange et où l’on boit, mais aussi le lieu où l’on parle, et où les choses de l’esprit peuvent se développer ; les boissons vineuses facilitant la commodité de la conversation.
Faire bonne chère consiste aussi à savoir parler de ce que l’on mange. Autour de la table se développe la littérature gastronomique. La langue est épurée afin de permettre de décrire ce que l’on mange et ce que l’on boit. Le métier de chroniqueur gastronomique apparaît et gagne ses galons de noblesse. En ce début de XIXe siècle, il ne s’agit pas d’avoir uniquement un fin palais, mais aussi un esprit vif. Comme toujours, à travers l’histoire gastronomique et culinaire, ce ne sont pas seulement des mets et de la table que l’on parle, mais l’on étudie des thèmes fondamentaux et constructeurs du fonctionnement d’une société à travers sa façon de penser et de se comporter. En explorant son rapport à la table, on aborde frontalement son rapport au divin, à l’économie et à ses représentations culturelles et sociales.
— Florent Quellier, Gourmandise : Histoire d’un péché capital, Armand Collin, avril 2013, 224 pages.
—
Sur le web.

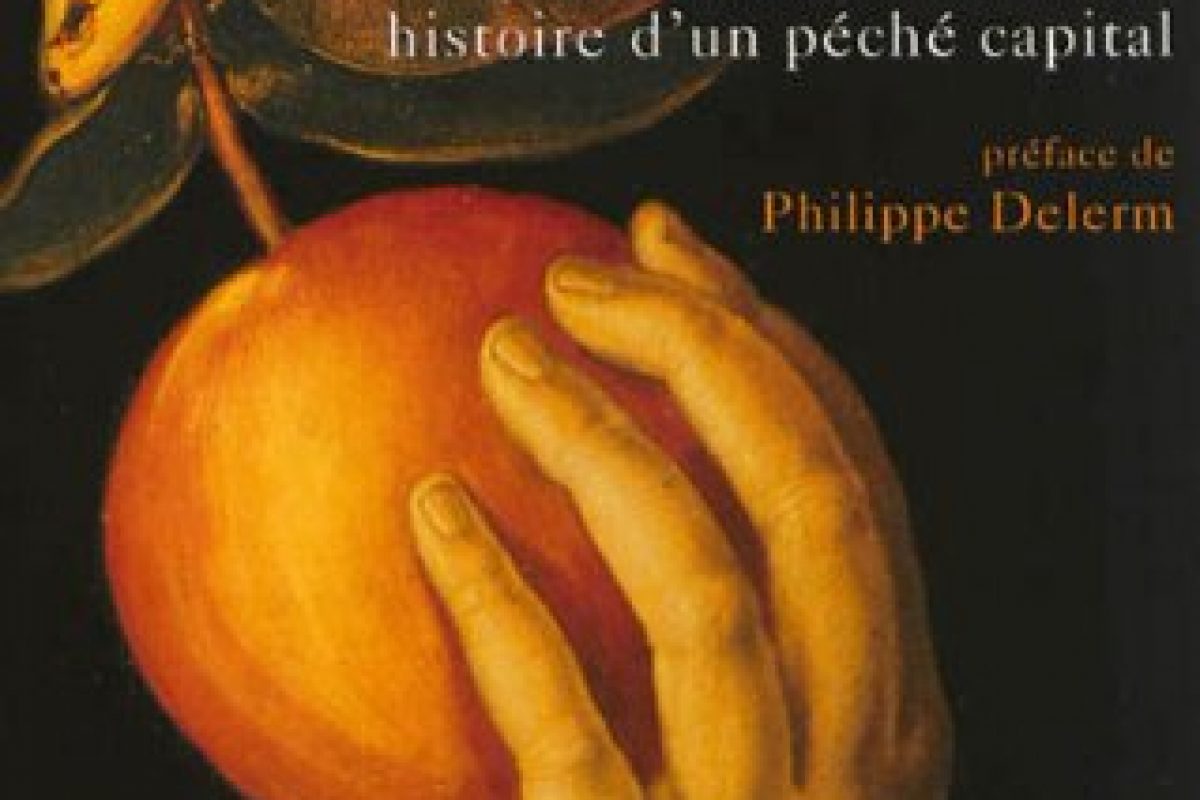
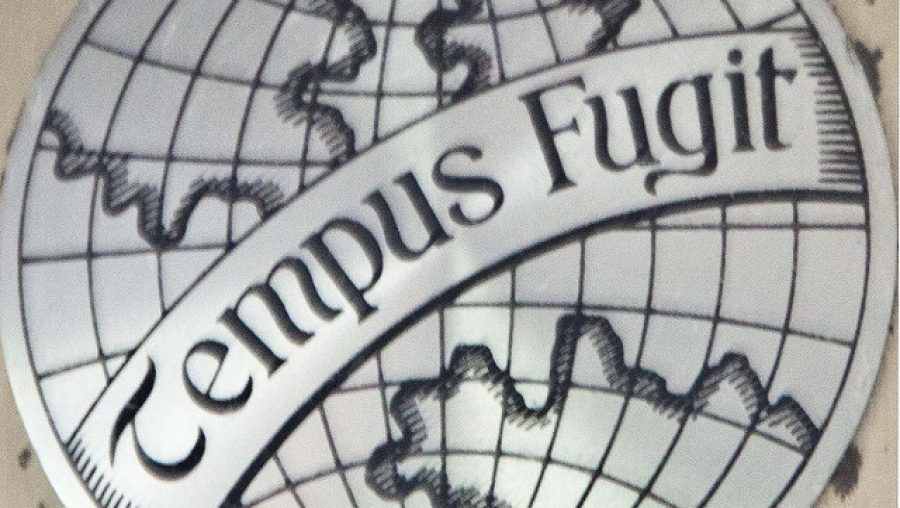

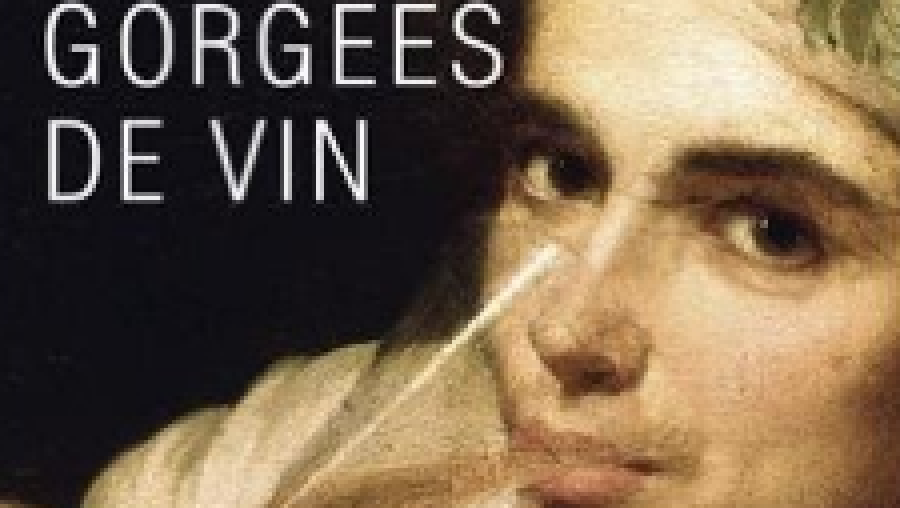
Attention, le mot « gourmandise » est ambigu: Son premier sens correspond à la goinfrerie http://www.cnrtl.fr/definition/gourmandise.
L’emploi catholiques réfère évidemment au sens le plus ancien, comme en témoigne le terme anglais, « glutony ».
Autre piège lexical, « capital » ici ne signifie pas « grave ».
Les « péchés capitaux », définis par St Thomas d’Aquin, sont les vices.
Les péchés graves (meurtre…) sont appelés « péchés mortels ».
Il n’est donc pas tellement lieu de s’étonner que « La tolérance complice de l’Église a contribué à faire accepter les plaisirs de la table ».
« Il est bon d’apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, qu’il est des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus raffinés ». (C. Baudelaire)
Merci JB 🙂