Par Mathieu Laine.
Raymond Aron avait, à n’en pas douter, une attitude libérale. Il était modeste, vigilant et, surtout, tolérant. Il aimait la liberté et, contrairement à la plupart de ses adversaires, avait le souci du débat honnête, fondé sur une confrontation pacifiée et sereine des arguments contraires. Il a également fait preuve d’une liberté d’esprit et d’un très grand courage à l’heure du marxisme triomphant.
Aron n’est cependant ni Tocqueville ni Hayek. Il a certes démontré une puissance conceptuelle évidente en rebâtissant, par exemple, la philosophie de l’histoire. Il nous a par ailleurs offert un bel exemple d’engagement solitaire contre une pensée dominante et égarée. Il nous a, aussi, livré des outils de vigilance particulièrement utiles pour nous garder des tentations totalitaires. Mais en raison de ses hésitations, de ses contradictions, de ses sympathies keynésiennes (dans sa préface à L’Opium des intellectuels, il s’avouait “personnellement, keynésien avec quelques regrets du libéralisme”), de son scepticisme exacerbé à l’encontre de l’autorégulation par la responsabilité individuelle, de son mépris pour ce qu’il appelait, à tort, “l’économisme” et de sa confiance à peine voilée dans l’intervention de l’État-providence, son entrée au Panthéon des grands penseurs libéraux n’est pas évidente. Fasciné par le phénomène politique (“l’art le plus haut”, comme il disait), Aron a souvent recherché la synthèse et l’équilibre là où d’autres pensent qu’ils sont malheureusement impossibles.
Aron n’a, par ailleurs, eu de cesse de qualifier de “dogmatiques” des penseurs qui ont été, en réalité, plus visionnaires que lui. Ce fut le cas de Hayek, qu’il côtoya notamment à Londres pendant l’Occupation. Tout en admirant chez ce grand penseur autrichien des qualités proches des siennes, un profond courage intellectuel et une immense culture, il éprouvait une grande réticence pour son courant de pensée. Pour lui, Hayek et ses amis étaient tout simplement des économistes idéologues et fanatiques. C’est ainsi, par exemple, qu’Aron s’est totalement désintéressé des raisonnements qui ont permis aux économistes libéraux, de prouver de manière rigoureuse, dès les années 1920-1930, l’inefficacité des recettes interventionnistes et l’impossibilité absolue de rendre viable une économie socialiste. Certes, ces théories étaient très peu connues à l’époque mais Aron était justement l’un des rares qui y avait accès. Or, bien loin de prendre conscience de leur importance, il a persisté, jusque dans les années 1970, à croire viable un système qui s’est effondré quelques années plus tard, exactement comme l’avait anticipé Hayek.
Aron ne croyait-il pas, finalement, trop en l’État et pas assez dans l’homme ? Il est clair qu’il a toujours vanté les mérites d’une économie mixte dont on mesure chaque jour davantage les limites. Il refusait également de rejoindre Tocqueville, qu’il a pourtant contribué à faire connaître, dans sa crainte de la tyrannie douce et aimait à rappeler que “la société française pourrait absorber une dose supplémentaire de social-démocratie sans plonger pour autant dans le despotisme tutélaire”. La tendance actuelle à la déresponsabilisation et à la victimisation vient pourtant confirmer la prédiction tocquevillienne.
Aron s’est peut-être laissé trop facilement emprisonner dans un libéralisme strictement constitutionnel et politique. À l’inverse d’un Hayek ou, plus tard, d’un Jean-François Revel, il semble en effet être tombé dans le piège tendu par les “constructivistes” qui, voyant leurs idéologies s’effondrer, ont tenté d’emporter la pensée libérale dans leur chute. Sans doute aurait-il dû profiter de son aura pour dénoncer cette malhonnêteté intellectuelle et alerter l’opinion sur la différence fondamentale qui distingue l’idéologie libérale des autres : alors que le “constructivisme” marxiste ou fasciste et, dans une moindre mesure, l’étatisme contemporain cherchent tous à changer l’homme, le libéralisme cherche au contraire à le respecter. Au lieu de cela, Aron a joué l’amalgame en dénonçant le “dogmatisme” d’une pensée qui s’avère pourtant être la plus pragmatique de toutes puisque son postulat n’est autre que l’action humaine.
Aron porte ainsi, en quelque sorte, une part de responsabilité dans cette étrange exception culturelle qui fait triompher, dans notre pays, la défiance à l’égard de valeurs et de solutions qui, partout ailleurs, ont contribué à un plus grand respect des individus et à une amélioration de leurs conditions de vie.
Il n’en demeure pas moins un intellectuel de grand talent. De ce fait, ses écrits constituent un excellent “sas” entre la pensée unique et une pensée libérale plus profonde, plus cohérente et davantage susceptible d’offrir les outils permettant de construire une société ouverte, efficiente et respectueuse des droits fondamentaux. Les jeunes générations auraient donc tout intérêt à lire ou relire Aron, pour le style, l’intelligence, le témoignage et le sens de l’engagement, mais certains d’entre eux gagneront sans doute à le prendre plus comme une introduction, un tremplin, une invitation paradoxale à découvrir ce qu’Aron a délaissé. C’est ainsi qu’Aron trouve pleinement sa place dans la galaxie des auteurs libéraux et qu’il sert les intérêts d’un projet de société que notre pays ne pourra que redécouvrir s’il ne veut pas dépérir.
—
Retour au sommaire de l’édition spéciale Raymond Aron, 30 ans déjà
- Raymond Aron : l’homme et son œuvre par José Colen
- Raymond Aron le dissident par Marc Crapez
- Aron, libéral hétérodoxe par Frédéric Mas
- Raymond Aron, itinéraire politique et intellectuel par Fabrice Copeau
- Aron, penseur des relations internationales et de la stratégie par Frédéric Mas
- Aron, Weber et Hayek par Marc Crapez
- La réalité est toujours plus conservatrice que l’idéologie par Florent Basch




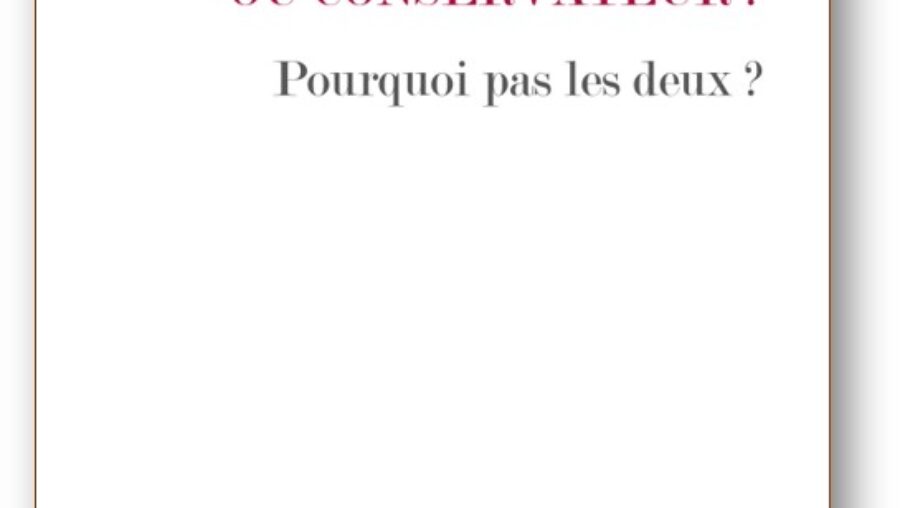
Bonne idée de republier l’article de Mathieu Laine. Le sectarisme avec lequel Aron ignorait les économistes libéraux est désolant. Si encore, conscient de son ignorance, il s’était abstenu de parler d’économie… Aron condamnait le « dogmatisme » d’auteurs dont il n’avait jamais fait l’effort d’étudier sérieusement les théories. Attitude très française. C’est à regretter qu’il ne soit pas né dans un autre pays : au lieu d’un Aron, on aurait peut-être eu un Hazlitt.
>Merci à Contrepoints d’avoir fait autant de place à Aron, un véritable génie de la liberté, qui a surtout compris le coté « Ying Yang » du dialogue entre libéralisme et démocratie, qui ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre.
Les libertariens anarcho-capitalistes sont contre la démocratie mais pour le libéralisme le plus total, comment pourriez vous expliquer comment ces deux valeurs sont interdépendantes?