Par Johan Rivalland.
La liberté est le sujet fondamental au centre des préoccupations de Contrepoints, à travers articles, analyses, réflexions, discussions. Au-delà de l’actualité, de l’Histoire, des perspectives d’avenir, qu’en est-il de ce sujet dans la littérature, en particulier lorsqu’on pense à son opposé le plus extrême : le totalitarisme ?
J’ai déjà eu l’occasion, ici-même, de commenter quelques grands romans d’Ayn Rand, qui trouveraient toute leur place dans cette série. Je vais donc prolonger avec d’autres réalisations, dans des registres parfois très voisins.
Quatrième volet, aujourd’hui, avec l’évocation du totalitarisme soviétique, pour lequel il y avait l’embarras du choix, mais dont nous présenterons ici brièvement trois grands classiques caractéristiques de son environnement, ainsi que deux films évocateurs.
La ferme des animaux de George Orwell
 Voilà un roman qui, pour moi comme pour beaucoup, reste une référence. À travers une situation imaginaire, dans un cadre particulier, une ferme, et pour personnages principaux des animaux, on retrouve tous les ingrédients de ce qui caractérise les régimes totalitaires, au premier rang desquels, bien sûr, les régimes communistes, auxquels on ne peut que penser ici dès le début de la lecture.
Voilà un roman qui, pour moi comme pour beaucoup, reste une référence. À travers une situation imaginaire, dans un cadre particulier, une ferme, et pour personnages principaux des animaux, on retrouve tous les ingrédients de ce qui caractérise les régimes totalitaires, au premier rang desquels, bien sûr, les régimes communistes, auxquels on ne peut que penser ici dès le début de la lecture.
Les similitudes sont parfaites : même débuts, à travers la prise de pouvoir par une révolution, mêmes idéaux, faits de beaux principes pleins d’humanité et de générosité, même émergence de principes de commandement (lois), érigés par des intellectuels qui se durciront rapidement et se verront bientôt confisquer leur révolution par des éléments nettement moins intellectuels qui régneront davantage par la force et la brutalité, même utopie égalitariste qui, inévitablement, dérive vers l’émergence d’une nomenklatura.
D’où la magnifique formulation, qui résume à elle-même parfaitement ce que donne ce type de régime, d’un point de vue idéologique : « Tous les animaux sont égaux, mais il y en a qui le sont plus que d’autres ».
Un roman d’une grande efficacité. Vous voulez savoir ce qu’est le communisme. Inutile d’aller chercher des ouvrages compliqués, si vous n’êtes pas très courageux. Vous en avez ici une parfaite illustration. Tous les régimes de cette inspiration connaissent inéluctablement ce déroulement. Invariablement.
Plus proche de nous encore, cet État africain dont le Président dictateur eut l’idée de chasser tous les fermiers blancs pour leur substituer des noirs, compétents ou pas, entraînant un effondrement de l’économie du pays, des famines et un accroissement de la pauvreté. N’était-ce pas le Zimbabwe ? Similitudes troublantes…
Un roman remarquable et mémorable. Désormais un grand classique, qui mérite de figurer sur les meilleures listes.
Rhinocéros d’Eugène Ionesco
 Pas facile de rédiger un commentaire sur cette célèbre pièce de théâtre du grand Ionesco. Une pièce en apparence légère, théâtre de l’absurde diront certains, mais je crois que l’auteur récusait ce terme. Une œuvre toute tournée, d’après ce que l’on sait, contre les idéologies de masse, les totalitarismes Nazi, et plus spécifiquement certainement communiste, l’auteur étant d’origine roumaine et ayant eu à fuir celui-ci, mais aussi contre les maux de notre civilisation occidentale, dont notamment la dictature de la mode ou celle de la majorité.
Pas facile de rédiger un commentaire sur cette célèbre pièce de théâtre du grand Ionesco. Une pièce en apparence légère, théâtre de l’absurde diront certains, mais je crois que l’auteur récusait ce terme. Une œuvre toute tournée, d’après ce que l’on sait, contre les idéologies de masse, les totalitarismes Nazi, et plus spécifiquement certainement communiste, l’auteur étant d’origine roumaine et ayant eu à fuir celui-ci, mais aussi contre les maux de notre civilisation occidentale, dont notamment la dictature de la mode ou celle de la majorité.
Pourquoi des rhinocéros et non des moutons, car c’est bien souvent en moutons de Panurge que l’on dit habituellement que beaucoup ont tendance à se comporter ? Ici, l’explication réside dans l’attrait de la force, de la puissance, la protection (présumée) du groupe, signes extérieurs des plus grandes idéologies de masse.
Dans ce contexte, qu’en est-il de la liberté ? Qui pour s’opposer au groupe et veiller au respect de l’ordre des choses et de l’identité de chacun, de l’individu plutôt que du groupe ? Débat pas si simple et loin d’être clos.
Il faut un homme de caractère et indépendant pour affirmer, comme le fait le personnage principal Bérenger (pourquoi avoir choisi un alcoolique, je m’interroge) que « l’homme est supérieur au rhinocéros » et que « le devoir véritable est de s’opposer à eux, lucidement, fermement », faisant référence à ceux qui se laissent entraîner dans cette sorte de mode, de tentation ou de faiblesse, consistant à se laisser transformer en animal.
Sombrent ainsi, tour à tour, à la fois ceux qui sont bien placés, ont de belle situations, les intellectuels (jamais les derniers ; le personnage du logicien en présente une belle parodie), et même ce personnage dont j’ai apprécié la caricature, de l’ancien instituteur Botard, un peu prétentieux, aux raisonnements « passionnels et simplistes », qui « parle en clichés », avec beaucoup de « lieux communs », comme le relève d’ailleurs le personnage de Dudard vers la fin (qui le défend en affirmant que « tout le monde a le droit d’évoluer »), un Botard à la fois un peu anarchiste et théoricien de la lutte des classes et prêt en apparence à défendre les plus grandes causes, sans que cela ne l’empêche de se compromettre lui-même à la première occasion, même si l’on peut penser qu’il est sincère.
Et, face à ces événements, Bérenger constate, dans la longue tirade que voici, que « si cela s’était passé ailleurs, dans un autre pays et qu’on eût appris cela par les journaux, on pourrait discuter paisiblement de la chose, étudier la question sur toutes ses faces, en tirer objectivement des conclusions. On organiserait des débats académiques, on ferait venir des savants, des écrivains, des hommes de loi, des femmes savantes, des artistes. Des hommes de la rue aussi, ce serait intéressant, passionnant, instructif. Mais quand vous êtes pris vous-même dans l’événement, quand vous êtes mis tout à coup devant la réalité brutale des faits, on ne peut pas ne pas se sentir concerné directement, on est trop violemment surpris pour garder tout son sang-froid. »
De la lucidité, en quelque sorte, servie par quelques notes d’humour acerbe.
Malheureusement, la réponse de son interlocuteur Dudard (nous sommes dans le dernier acte) se borne à remarquer que lui aussi a été surpris au début, puis dit avoir commencé à s’habituer… (« On s’y habitue, vous savez. Plus personne ne s’étonne (…) »). Là est sans doute tout le problème. Les événements se déroulent souvent assez insidieusement…
Dudard lui-même n’adopte-t-il pas une position relativiste, jugeant son interlocuteur bien sûr de lui et se demandant où s’arrête le normal et où commence l’anormal. N’affirme-t-il pas « la supériorité de la pensée théorique et scientifique sur le sens commun et le dogmatisme » ? Et d’ajouter qu’« il faut toujours essayer de comprendre (…), remonter jusqu’aux causes (…), avoir « une ouverture d’esprit qui est le propre de la mentalité scientifique. Tout est logique. Comprendre, c’est justifier ».
Et, bien sûr, toujours cette fausse idée, cette illusion de la liberté, qui veut que chacun soit libre de suivre le mouvement (personnage de Daisy, qui s’interdit de retenir Dudard de rejoindre les rhinocéros). Toujours Daisy, qui ne réagit que « mollement » (« Si, vraiment, c’est un engouement passager, le danger n’est pas grave »), symbolisant ainsi le manque de réaction du plus grand nombre (qui finit par rejoindre le mouvement) et qui, en réaction à l’idée de Dudard qu’« il vaut mieux critiquer du dedans que du dehors », répond qu’il a bon cœur, avant de constater qu’il part rejoindre les rhinocéros et d’affirmer, inactive, que de toute façon « on n’y pouvait rien ».
En homme contrarié, Bérenger en vient à souhaiter la solidarité internationale. Mais, là encore, l’expérience montre que celle-ci tarde bien souvent à intervenir, lorsqu’elle existe autrement que dans les discours.
Le zéro et l’infini d’Arthur Koestler
 Un roman évocateur de l’univers oppressant du système soviétique et de l’esprit du communisme pour lequel, comme l’indique si justement le titre, l’individu ne représente rien (zéro) face à la collectivité, à l’opposé du monde libre où pour les humanistes tout au moins il a une valeur infinie, qui ne vaut d’être sacrifiée au bien-être hypothétique d’une quelconque collectivité.
Un roman évocateur de l’univers oppressant du système soviétique et de l’esprit du communisme pour lequel, comme l’indique si justement le titre, l’individu ne représente rien (zéro) face à la collectivité, à l’opposé du monde libre où pour les humanistes tout au moins il a une valeur infinie, qui ne vaut d’être sacrifiée au bien-être hypothétique d’une quelconque collectivité.
Le personnage principal, haut responsable communiste de la première heure, se voit suspecté de trahison alors même qu’il n’avait aucunement dérogé à l’esprit de la Révolution. Réalisera-t-il son auto-critique lors des interrogatoires musclés qu’il va subir ? Restera-t-il fidèle à l’esprit qui le guida lors de la Révolution ou doutera-t-il en fin de compte du bien-fondé de celle-ci ?
Une peinture intéressante de l’élimination (au sens physique et historique) de la première génération des pères de la Révolution, au profit de ceux, moins intellectuels et idéalistes, qui leur ont succédé et craignaient « l’embourgeoisement » de ceux-ci.
Une bonne leçon pour tous ceux, souvent intellectuels auto-proclamés, qui rêvent encore d’une nouvelle révolution soi-disant au service du peuple et du bien public, et qui ne mène jamais qu’à l’asservissement total de l’homme.
La vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck
 On connait l’univers de l’après-chute du Mur de Berlin, à travers des films de qualité et bourrés d’humour tels que GoodBye Lenin !. Mais de quoi se souvient-on sur le coeur de la vie des gens au temps du Mur ? Et les jeunes générations ont-elles vraiment conscience de ce que pouvait représenter la vie au jour le jour en RDA, ou d’autres pays du giron soviétique à l’époque ? Que reste-t-il de monuments tels que Le zéro et l’infini ou de joyaux tels que Nous les vivants ?
On connait l’univers de l’après-chute du Mur de Berlin, à travers des films de qualité et bourrés d’humour tels que GoodBye Lenin !. Mais de quoi se souvient-on sur le coeur de la vie des gens au temps du Mur ? Et les jeunes générations ont-elles vraiment conscience de ce que pouvait représenter la vie au jour le jour en RDA, ou d’autres pays du giron soviétique à l’époque ? Que reste-t-il de monuments tels que Le zéro et l’infini ou de joyaux tels que Nous les vivants ?
C’est tout le mérite, donc, de ce film que de nous présenter les méthodes de la Stasi, telles qu’on les a souvent vues décrites pour les uns et dont on n’a éventuellement jamais entendu parler pour les autres. Un film fondamental de ce point de vue, même si la qualité des images et le milieu particulier dans lequel il se situe (les artistes et personnes influentes proches du pouvoir) ôte partiellement à l’atmosphère lugubre et grisâtre de la vie des petites gens ou personnes plus modestes, comme dans Barbara, même si cela reste parfaitement bien sombre et permet de ressentir l’aliénation de ce monde contre-nature, où le malaise est permanent.
Le film commence par un interrogatoire, mené par un « camarade-capitaine » particulièrement dur et intransigeant de la Stasi, avec ses méthodes imparables pour « faire avouer » le suspect, en particulier la privation de sommeil.
Un interrogatoire enregistré qui sert ensuite de leçon à l’école de la Stasi, où il fait bon d’éviter les questions qui pourraient paraître trop compassionnelles se souciant de la cruauté réservée au sort du présumé coupable, contre la supposée « arrogance » duquel on est mis en garde, sauf à devenir à son tour suspect d’être également un « ennemi du socialisme » et se trouver, à ce titre, « traqué » à son tour, comme on l’enseigne dans cette école où l’on apprend à devenir « le bouclier et le glaive du Parti », en faisant même le serment. Mieux vaut, au contraire, se joindre aux applaudissements de circonstance à la fin du cours et éviter ainsi de se faire remarquer.
Toute spontanéité est exclue dans cette société, on ne tardera pas à le constater à travers le film. Et c’est authentique. La suspicion est présente aussi bien dans le choix du vocabulaire que sur le moindre détail d’une pièce de théâtre (puisque le personnage principal est un écrivain et en compose).
Même celui qui se croit épargné par le système, car faisant plus ou moins partie de la Nomenklatura, est peut-être espionné dans ses moindres déplacements, a des micros cachés partout dans son appartement, est fiché (comme tout le monde et avec un systématisme insoupçonné à l’époque) ou est susceptible d’être trahi par ses propres enfants, même en toute innocence de leur part.
Un monde où l’on a cessé de comptabiliser les suicides tant ils se situent à un niveau inouï. Et ce dernier point ne sera pas étranger à notre histoire, que je vous laisse, pour le reste, découvrir.
Un film de grande qualité, qui permet de rappeler ou faire connaître la réalité du système totalitaire à la soviétique et les méthodes de la Stasi en particulier.
À la fois dur et oppressant, tout en apportant une touche de sensibilité, presqu’irréaliste, au beau milieu de cette noirceur et cette société où l’individu n’a pas d’existence propre, où la vie des autres ne mérite aucun égard, tout étant soumis au collectif. À découvrir.
Barbara de Christian Petzold
 Je n’avais pas entendu parler de ce film à sa sortie. Un film au budget probablement modeste, certes, mais qui fait partie de ces films si tristement évocateurs de ce que pouvait être la vie en RDA. Glauque, insipide, terrifiante, inquiétante. Peut-on même parler de « vie » ? « Mais on ne peut pas vivre, ici » dit à un moment le personnage principal, Barbara, à celui qu’elle aimerait rejoindre à l’Ouest et qui lui dit, un rien impatient et pour lui manifester son amour, qu’il aimerait bien rester là pour vivre avec elle. Radical, mais parfaitement réaliste.
Je n’avais pas entendu parler de ce film à sa sortie. Un film au budget probablement modeste, certes, mais qui fait partie de ces films si tristement évocateurs de ce que pouvait être la vie en RDA. Glauque, insipide, terrifiante, inquiétante. Peut-on même parler de « vie » ? « Mais on ne peut pas vivre, ici » dit à un moment le personnage principal, Barbara, à celui qu’elle aimerait rejoindre à l’Ouest et qui lui dit, un rien impatient et pour lui manifester son amour, qu’il aimerait bien rester là pour vivre avec elle. Radical, mais parfaitement réaliste.
Un film très réussi, dans des décors et une ambiance aussi ternes que pouvait l’être la RDA telle qu’on l’imagine après qu’on nous l’ait tant décrite, à l’instar des pays de l’Est dans le giron de l’URSS.
Une vie morne et lugubre, quasi absurde, faite de méfiance permanente, de paranoïa auto-protectrice, d’absence de véritable liberté.
Un contexte qui explique pourquoi cette infirmière rêve de pouvoir passer à l’Ouest et se trouve mutée dans un tout petit hôpital de province, suspectée de chercher à passer à l’acte.
Mais pouvait-on vraiment y parvenir, dans cette société sous surveillance ?
Je n’en dis pas plus. Je vous laisse vous glisser dans la peau de ce personnage au peu d’émotions extérieures. Vivre un petit moment comme si vous vous trouviez là-bas, dans cette atmosphère glaçante de la RDA.
Vous n’en apprécierez que mieux le prix de votre liberté.
Le prochain volet de notre série, dans les tout prochains jours, portera sur quelques témoignages en provenance du monde totalitaire.
— George Orwell, La ferme des animaux, folio Gallimard, janvier 1984, 150 pages.
— Eugène Ionesco, Rhinocéros, folio Gallimard, mai 1972, 246 pages.
— Arthur Koestler, Le zéro et l’infini, Calmann-Lévy, avril 2005, 248 pages.
— Florian Henckel von Donnersmarck, La vie des autres, Paradis Distribution, octobre 2007, 137 minutes.
— Christian Petzold, Barbara, Pyramide Vidéo, octobre 2012, 105 minutes.
Article publié initialement le 26 janvier 2014.




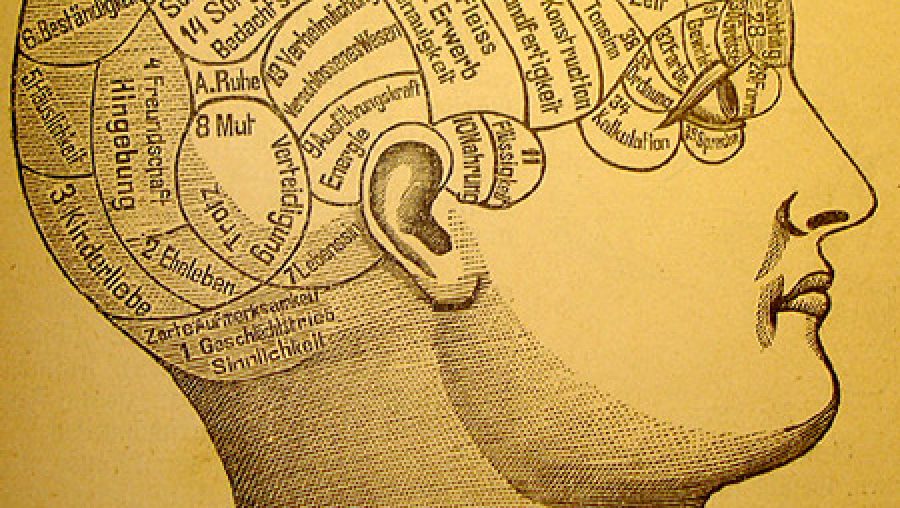
Barbara : Bon, je vais vous raconter la fin
sur la plage…
C’est vraiment un super film à l’ambiance angoissante
Il serait tout aussi édifiant de présenter des « oeuvres » qui feraient positivement et en toute sincérité l’éloge de tels systèmes , les prenant pour le contraire de ce qu’ils sont.
Cela permet de mesurer l’aveuglement de leurs auteurs, a la perpective de l’histoire, et l’obsolescence, le ringard, le kitch dans lesquels est tombée leur prose.
Il est facile de voir par quels romantismes ils se sont aveuglés, mais aujourd’hui, en 2013, par quels mécanismes la masse s’aveugle t’elle?
Qu’est-ce qui est plus intuitif et séduisant ?
A) un État, personnage puissant et incorruptible protégeant les citoyens en leur apportant stabilité, justice, richesse gratuite (sans trop préciser d’où elle vient). Qui par des interventions ciblés permet de remettre l’ordre gràce à son élite éclairée et bien pensante.
B) laisser les citoyens régler leur problème eux-même et leur marché s’auto-réguler. Laisser les citoyens être responsable quand ça va bien et quand ça va mal.
Le premier est séduisant, il est conforme à une pensé magique, conforte le besoin naturel de croire en une force supérieur, nous décharge de toute responsabilité sur notre sort. Il permet de faire des choses que jamais un individu ne ferait, comme voler son voisin. On peut blâmer l’État pour des échecs et comme on ne sait plus comment se passer de lui on continue à lui vouer un culte car on craint son absence. Il est facilement justifiable par une pensée au premier degré.
Le deuxième exige une pensée bien supérieur au premier degré qui analyse les effets collatéraux et dynamique, c’est contre intuitif. Ce qu’on ne voit pas. Le premier donne un sentiment de puissance, bien qu’illusoire, que le deuxième peu difficilement fournir sans effort.
La principale critique faite à « la vie des autres » est que le film montrait une surveillance personnalisée, avec le risque que le surveillant ait de la sympathie pour le surveillé. L’horreur du système était que surveillants et surveillés ne pouvaient être en relation durable, la rotation des surveillants et les surveillants des surveillants garantissant le contrôle maximum d’un groupe totalement anonyme sur les individus, présumés coupables sauf preuve du contraire, preuve bien sûr impossible à fournir.