Par Johan Rivalland
La compassion à l’égard des malheureux, des « exclus », des déshérités, de tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre souffrent ou sont en danger, peut être perçue comme un sentiment sain, comme une source de motivation, à la fois contre l’indifférence et l’inaction, susceptible de stimuler l’entraide, le partage, le don de soi, la charité ou tout ce qui peut venir accompagner l’être en difficulté, ne pas rester indifférent à son sort ou à son malheur, l’épauler, voire, si on le peut, le tirer de sa misère ou de l’obstacle auquel il est confronté, pour mieux le voir repartir dans la vie ou au moins, selon le cas, lui mettre un peu de baume au cœur, passagèrement, en espérant le soulager et lui permettre de trouver les ressources pour s’en sortir.
Mais lorsque la politique s’en mêle, et que cette « solidarité » est organisée ou, pire, devient un véritable fonds de commerce destiné, entre autres arguments décisifs, à assurer l’élection ou la réélection, allant même jusqu’à jouer du ressentiment, avec tous les dangers que cela comporte, alors très souvent les choses se gâtent. Et on ne connait que trop bien les dérives auxquelles cela donne lieu, qui peuvent bien mener jusqu’à l’enfer…
L’homme compassionnel
 C’est le mérite de Myriam Revault d’Allonnes d’avoir eu l’idée, en 2008, d’écrire un petit ouvrage tout à fait d’actualité portant ce titre, et bienvenu dans le cadre d’une réflexion sur la démocratie et notre société médiatique.
C’est le mérite de Myriam Revault d’Allonnes d’avoir eu l’idée, en 2008, d’écrire un petit ouvrage tout à fait d’actualité portant ce titre, et bienvenu dans le cadre d’une réflexion sur la démocratie et notre société médiatique.
Avec la fin des Trente Glorieuses et la montée du chômage comme des incertitudes, nous sommes en effet passés de la lutte des classes et tout le vocabulaire qui y est rattaché à un tournant compassionnel, s’appuyant sur les concepts de fracture et de protection. L’idée de compassion, distincte de la pitié, davantage d’ordre religieux selon l’auteur, est alors liée au spectacle, à l’éveil de l’intérêt en tirant parti des conditions médiatiques.
S’appuyant sur les écrits de Tocqueville, Rousseau, ou encore Montesquieu, notamment, Myriam Revault d’Allonnes montre les liens, et à l’inverse les distinctions entre l’envie, la pitié et la compassion, qui vont jusqu’à jouer un rôle structurant dans la démocratie.
Ainsi, de même que la vertu politique représente, selon elle, l’impulsion dominante des républiques antiques, l’honneur celle de la forme monarchique, et la crainte celle du despotisme, la compassion est, quant à elle, liée à la similitude, issue de l’égalité démocratique qui engendre la pitié (relative aux maux qui pourraient nous advenir à nous-mêmes) et l’envie (vouloir prendre la place des autres, sans se mettre cette fois à leur place, par frustration, et parce qu’on estime que l’objet est accessible).
On débouche ici sur l’idée de mimétisme, accordant à l’opinion commune, au plus grand nombre, un pouvoir de vérité.
Dès lors, l’attrait de la similitude touche à la fois les opinions, les croyances et les dispositions affectives. Et la posture des candidats à l’élection présidentielle, par exemple, se veut compassionnelle, répondant à cette attente de ressemblance du candidat avec ses électeurs, appuyant sa légitimité sur la mise en avant d’une politique de proximité, portée par une certaine empathie avec les problèmes des petites gens mis en lumière par les médias, davantage que par le souci de l’intérêt du plus grand nombre ou de l’universalité. La « démocratie participative » va, en ce sens, encore plus loin que l’idée tocquevilienne de « tyrannie du nombre ».
Les dérives de la société compassionnelle
L’auteur se réfère de manière très judicieuse à Hannah Arendt, qui opère une intéressante distinction entre compassion (sensibilité à la souffrance de l’autre, en tant qu’individu particulier, sans impliquer pour autant de sentiment de supériorité et où ne règne aucune asymétrie) et pitié (forme de condescendance humiliante pour celui qui en est l’objet, qui consiste à s’attrister sans être touché dans sa chair et peut s’étendre à la masse souffrante).
Dans le premier cas, on touche au domaine des passions, la compassion étant comparable à l’amour et appelant la réciprocité, contrairement à la pitié, qui est une « compassion pervertie », faisant du souffrant un agrégat.
« Le problème apparaît quand la pitié – compassion pervertie – envahit le champ entier de la politique, ajoute l’auteur, et se donne à la fois en spectacle et en discours jusqu’à annihiler le souci proprement politique de la liberté. »
D’où l’idée que la Révolution est source de violence et d’inhumanité, la pitié se renversant en cruauté, afin de sauver l’humanité malgré elle. Les souffrances des malheureux se sont ainsi trouvées glorifiées par les révolutionnaires français, leur attribuant d’emblée un caractère vertueux, alors que la richesse était a contrario assimilée au vice et à la corruption. Leur objectif est alors de libérer les hommes de la pauvreté et de « rendre heureux les malheureux, au lieu d’établir la justice pour tous » (Hannah Arendt). Cela renvoie à toutes les idéologies sur la fabrique de l’Homme nouveau, dont s’inspirent les systèmes totalitaires, à commencer par la Terreur révolutionnaire.
L’égoïsme de la société est, dans cette lignée, une idée qui vient de Rousseau, à qui Arendt impute cette dérive qui consiste à importer le sentiment d’humanité à l’intérieur du champ politique et dont l’influence fut décisive sur la politique révolutionnaire et les discours de Robespierre.
Pour finir, la dernière partie du livre porte sur la société du spectacle, depuis l’Antiquité, avec au centre l’idée de Rousseau que les spectacles répétitifs et éphémères, à l’image des journaux télévisés aujourd’hui par exemple, tuent l’imagination et suspendent notre capacité de réflexion et de jugement, finissant par entraîner l’accoutumance et donc notre incapacité à agir ou réagir. Une idée fort intéressante, si ce n’est qu’elle semble en partie amoindrie par ce que révèle le brillant ouvrage de Michel Terestchenko Un si fragile vernis d’humanité : Banalité du mal, banalité du bien, déjà présenté ici-même, auquel je renvoie également de nouveau et qui permettra d’aller beaucoup plus loin encore dans la réflexion que le présent ouvrage, déjà si passionnant.
— Myriam Revault d’Allonnes, L’Homme compassionnel, Seuil – collection Débats, janvier 2008, 102 pages.

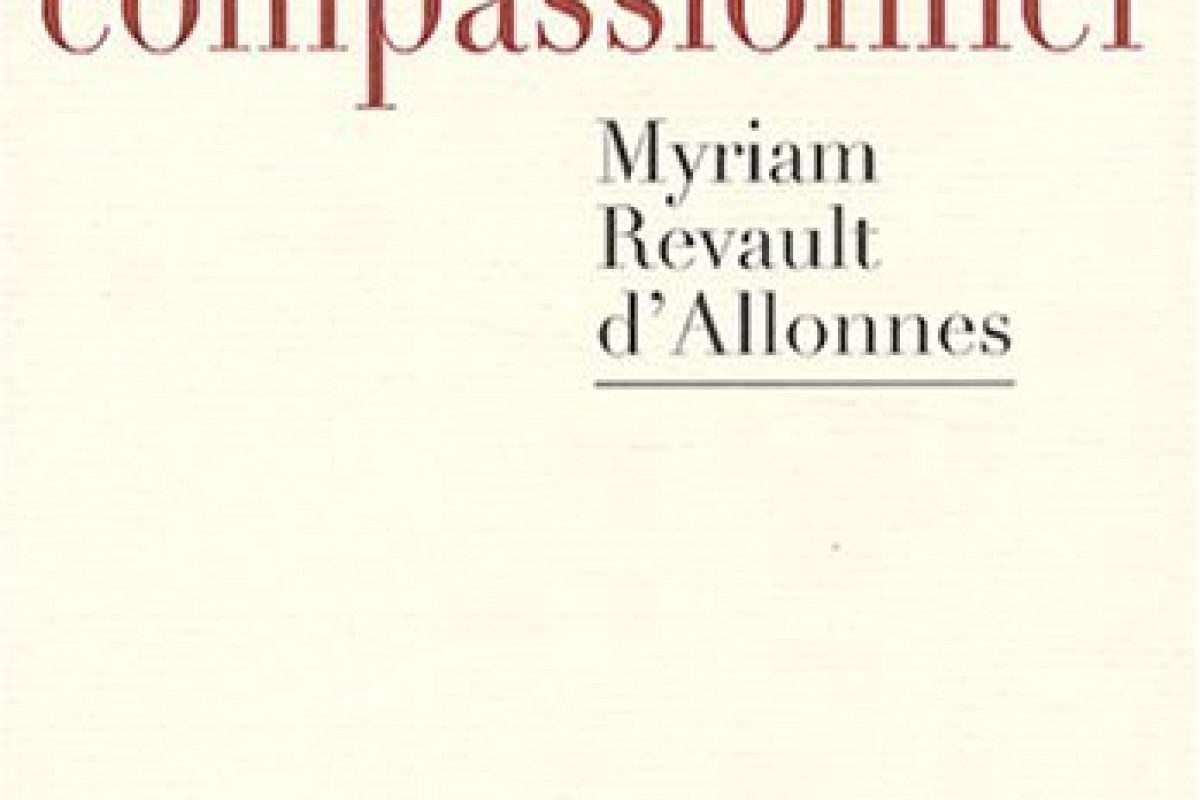

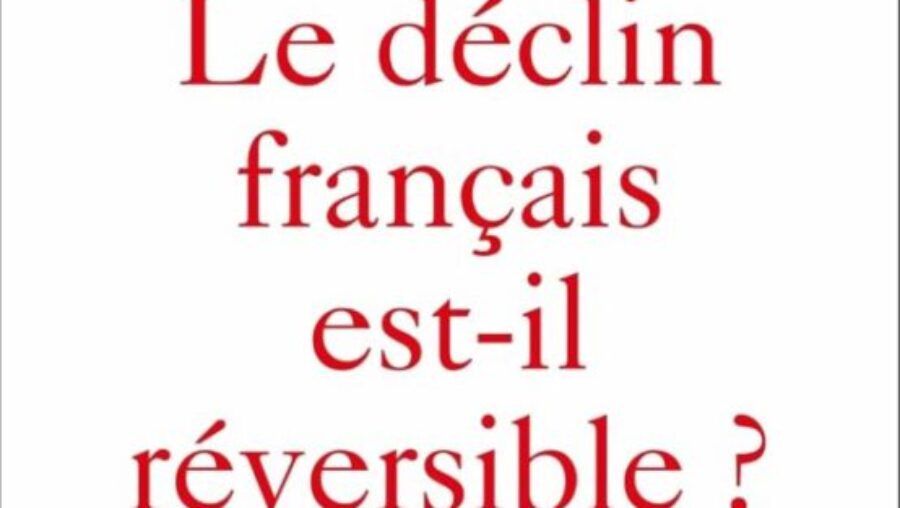
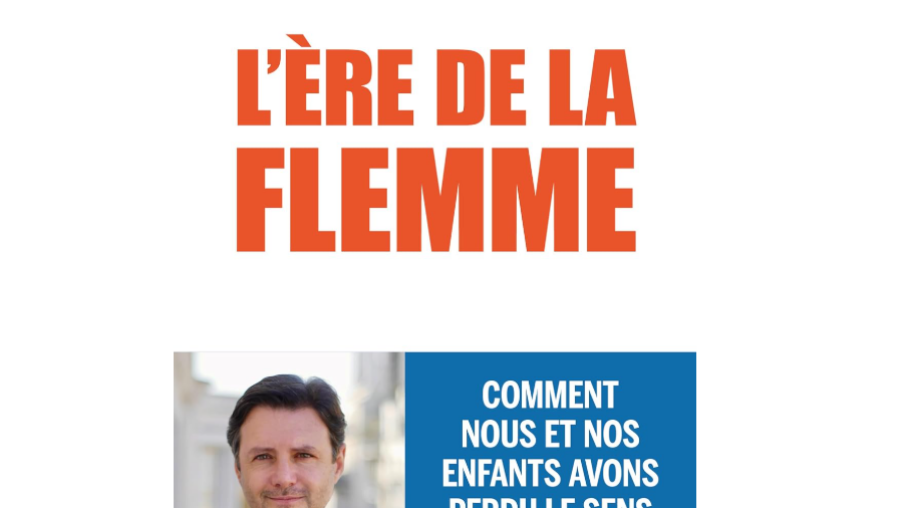
Merci Johan pour ces chroniques super instructives !
Intéressant. Merci.
Cette compassion d’État est contraire à la charité chrétienne. En effet, dans la charité, est incluse l’idée qu’il n’y a pas d’échange, pas de retour sur investissement. Même la fierté de donner en est exclue. L’État ne donne que de manière utilitariste (et inefficace, bien entendu), et toujours à des fins d’auto-promotion. Et c’est pourquoi le mot “charité” provoque le dégoût chez les gens de gauche : il les renvoie au caractère intéressé, orgueilleux, de leur solidarité.