Par Emmanuel Brunet Bommert.
L’idée d’une possible altération quant à l’identité « nationale » défraye les chroniques, partout dans le monde.
Pourtant, s’il y a bien une chose qui ne saurait être seulement nationale, c’est bien le concept d’identité. Une telle inquiétude a des implications bien plus vastes que ce qu’elle ne laisse transparaître, de prime abord. Ce n’est que parce qu’elle s’est étendue jusqu’au concept de nation, qu’elle s’est exposée comme un sujet prioritaire, dans les préoccupations gouvernementales. Cet intérêt ne fera que croître, à mesure que le problème va s’amplifier.
L’identité n’est pas que personnelle, elle relève aussi d’une appartenance.
Si l’on estime qu’elle se perd, ce n’est point seulement de symboles ou d’idéaux dont on parle, mais de la place qu’en tant qu’individus l’on occupe au sein d’une communauté. Sans la capacité d’identifier ce dont la société est garante, il n’est pas possible de s’y insérer comme un membre à part entière. Au même titre que l’on s’imaginerait difficilement adhérer à un mouvement dont on ignore complètement les valeurs ou les motivations.
Si elle n’a plus son signalement habituel, il n’est plus possible de déterminer quelles sont ses valeurs et, par là, sur quelle base les citoyens peuvent s’affirmer les uns par rapports aux autres. Utiliser l’expression « identité nationale » est impropre et conduit à donner un grand crédit aux définitions des nationalistes, qui aimeraient réduire l’identité de la civilisation à la seule nation. Pourtant elle est un fait de la société tout entière, non pas seulement d’un seul de ses organes : elle transcende les frontières, débordant l’autorité des administrations. Elle est capable d’exister et de croître partout où des personnes, mues par des principes communs, travaillent de concert à leur bénéfice mutuel.
Les grands empires firent cette erreur commune, qui consiste à mélanger l’identité du citoyen, du peuple et de la société.
Il peut se faire plusieurs citoyens au sein d’un peuple, comme plusieurs populations dans une société, mais tous partageront les valeurs de cette dernière : les musulmans, les Chinois, les Hébreux, les Indiens comme les Celtes sont divers exemples de sociétés, capables de se déployer même au sein de nations étrangères, et d’y maintenir leurs institutions, malgré la concurrence d’une autorité pourtant supérieurement armée.
Les principes des civilisations permettent l’identification. Or, ils ne naissent pas des lois, mais des accords tacites, que l’on entretient avec autrui et que l’on transmet à sa descendance, comme autant de racines : la société naît de la famille. C’est elle qui va en sauvegarder les fondations, en pérenniser l’héritage.
Non pas comme un patrimoine inexplicable, qui vivrait sa propre vie dans l’esprit des Hommes, mais comme une action volontaire consistant en une éducation caractéristique de sa lignée, dans le respect des conventions sociales communes à l’ensemble de la cité. C’est là la raison pour laquelle les livres sacrés, qui ne représentent rien pour le jeune enfant, deviennent pourtant un fondement de sa vie lorsqu’ils sont contés par le père ou la mère : ils se font traditions, devenant une racine de la communauté1.
Si les conservateurs s’attachent tant au concept de « foyer », c’est qu’il est un pilier de la société toute entière et s’ils le savent, c’est parce qu’ils l’ont découvert au sein du leur. Si le mot « Patrie » est si proche du latin pater, le père, c’est qu’il fut compris depuis des générations que la famille en est la racine. L’effacement de l’identité, dans nos sociétés à l’époque moderne, n’est pas directement le fait des gouvernements, dont les assemblées, les décrets ou les armées n’ont pas un tel pouvoir : elle fut plus probablement causée par un événement exceptionnellement destructeur.
Un épisode si dévastateur que des millions de familles se retrouvèrent soudainement amputées d’une partie de leur substance : la première guerre mondiale, qui eut raison de dizaines de millions de foyers à travers le monde, est de ceux-là. En l’absence d’un père pour transmettre l’héritage des traditions2 à leurs jeunes enfants, ils perdirent un précieux lien vers leurs ancêtres.
Les conflits qui apparaissaient si vivaces entre certains peuples, disparurent soudainement. Ce qui semblait d’antan si raisonnable de soutenir, devint désuet. Les enfants, laissés seuls face à leur instruction, peuvent y pourvoir, mais les parents épargnent nombre de douloureuses épreuves. Sans eux, l’unique moyen d’apprentissage revient à refaire l’expérience des mêmes erreurs. Pourtant, les choses ne furent pas si simples et, en plus de disparaitre dans les décombres, leurs géniteurs les gratifièrent du plus dangereux présent à offrir à un ignorant : la fortune et la gloire.
Ils laissèrent derrière eux un imposant héritage financier et moral, souvenir d’une époque de prospérité, à la génération d’orphelins. Si immense, tout du moins, qu’ils ne pourraient subir le contrecoup de leurs erreurs que des décennies après leur mort. La déconfiture fut d’autant repoussée qu’ils s’élevaient sur l’excellence d’un florissant début de vingtième siècle3.
La civilisation française eut un immense embarras pour se relever de la Der des ders, qui fut particulièrement dévastatrice de ses principes moraux. Ceux qui auraient dû les inculquer furent soit décimés dans ses charniers soit si terriblement métamorphosés par les horreurs de la guerre, qu’ils mirent de côté leur esprit combattif, pourtant essentiel à la sauvegarde de la liberté. Dès lors, tout futur conflit serait d’ores et déjà perdu, puisque ceux qui pouvaient le mener grandissaient avec la terreur d’un nouveau bain de sang.
Ceux qui vécurent dans ce nouveau monde n’eurent plus qu’une seule obsession : la sécurité d’un foyer, fort et solide, à même de remplacer celui qui leur faisait défaut. Le socialisme ne connut jamais une plus grande croissance que durant l’entre-deux guerres, se nourrissant de la mémoire des morts.
Puissant d’une génération entière de jeunes gens, ne désirant qu’un immense bras protecteur, il progressa comme jamais ses partisans ne l’avaient rêvé. Il se fit, tout naturellement, promoteur d’un patriotisme corrompu par le même nationalisme qu’au début du siècle. Puisque la nation s’était substituée à la famille, ses chefs devinrent des figures paternelles. Si certains pays tombèrent plus tôt dans ses griffes que d’autres, c’est que les civilisations ne sont pas égales dans la misère et certaines la connurent avec plus de précocité que d’autres : la Russie fut exposée bien avant la première guerre mondiale.
S’il y a quelque chose de commun, c’est que les diverses formes du socialisme sont séduisantes pour ceux qui n’ont jamais connus de solides valeurs familiales : la promesse de la camaraderie, de la fraternité et de la solidarité, sont aisées à corrompre lorsque l’on enseigne plus la responsabilité qui va de pair.
Le despotisme le plus féroce naît toujours de la volonté des survivants4. Ceux-là tentent, tant bien que mal, de combler leur vide intérieur par quelque chose de grand et de fort. Les nations ayant instituées l’éducation comme une fonction de l’État et qui, par la suite, connurent des guerres si cataclysmiques furent tout spécialement exposées, la jeune population ayant déjà pris l’habitude de se référer à l’instruction du gouvernement, elle n’espère plus la trouver dans ses propres expériences. Car si les valeurs traditionnelles de la société établirent, par la vigilance des familles, un solide bouclier contre les dérives de l’instruction publique, la disparition de millions de foyers leur ouvrit un véritable boulevard.
La tyrannie naissante n’est pas l’aube d’une civilisation nouvelle, mais le crépuscule de la précédente. Car lorsque le pouvoir devient la seule valeur commune, toutes les revendications individuelles en appellent à lui seul, au point qu’il se fait à terme plus de gens pour le combattre que pour le défendre. La société n’ayant pas d’autres principes, les divers peuples qui la composent vont se disloquer les uns des autres. Ils ne pourront alors se réunir qu’autour de nouvelles valeurs, plus proches de leurs aspirations et de leurs identités propres. Les anciens concitoyens deviendront des ennemis mortels : l’empire étant tombé, l’ère des royaumes peut commencer.
L’identité de la société, c’est ce que l’on nomme communément la « civilisation ». C’est elle qui fait toute la différence entre le Chinois et l’Israélien, entre l’Allemand et l’Égyptien. Les valeurs communes vont au-delà du pouvoir ou du droit, elles représentent un ensemble de principes qui, en plus de la seule garantie de justice, servent de socle à la communauté. Le « contrat social » n’est ainsi pas le seul lien fondateur d’une société, celle-là est autant issue de la sympathie, de l’attachement, du passé commun comme des diverses dettes morales ou matérielles des gens qui la composent.
Elle est éminemment discriminatoire, l’on peut même en dire qu’il ne saurait y avoir de sociétés sans différenciations. Que les gens se rassemblent parce qu’ils se correspondent physiquement ou moralement, ils en viendront toujours à expulser ceux qui divergent. C’est une spécificité humaine que de se lier à ce qui nous est le plus proche, prioritairement à ce qui semble plus éloigné, ainsi que d’écarter ce qui nous apparait le plus exotique.
Plus la société évolue plus ses valeurs se simplifient pour se rapprocher du seul idéal de justice commune. Par-là, la quantité de peuplades et d’agglomérations qui la rejoignent s’agrandit. Les différences se font moins concrètes avec le passage du temps : l’identité commune est maintenant comprise comme une série de valeurs et non plus comme la seule proximité physique ou linguistique.
En s’affinant, elle se renforce et peut s’étendre au-delà des murs de la cité, accompagnant chaque voyageur. Elle est enfin libre d’embrasser le monde entier de sa vision distinctive de la droiture qui, dès lors qu’elle sera comprise de tous, permettra la croissance du commerce et l’extension de la culture, même auprès des peuplades les plus éloignés.
Si la société se raffine, le foyer va s’enraciner plus profondément en son sein, devenant dépendant de sa stabilité pour perdurer. Car si les parents éduquent aux principes, la communauté va être sollicitée pour l’instruction, à mesure de l’écoulement des âges : plus elle s’agrandira plus son entretien se fera exigeant et onéreux en compétences et connaissances.
Mais la mort brutale des anciens conduit à devoir réapprendre les valeurs, par soi-même. S’il y a de grandes chances de réussir une telle entreprise, très nombreux seront ceux qui échoueront en s’y essayant. Ceux-là choisiront alors de revenir vers un foyer, capable d’instruire : un père de substitution d’un côté et une mère de l’autre. Parfois, devenus parents, ils en viendront à se demander si transmettre à leurs enfants des concepts considérés comme « désuets » est justifiable. Beaucoup préféreront « laisser le choix », décidant par-là de faire confiance à leur progéniture ignorante pour s’éduquer seule, se remettant à la chance et au hasard.
Seulement, l’enfant n’a pas plus de chances de réussite que ses propres géniteurs et, lorsque viendra son tour d’enseigner aux siens, il se demandera s’il est justifié de transmettre quoi que ce soit, se donnant comme excuse que s’il a lui-même pu faire « ses propres choix », alors son héritier le pourra aussi. La nouvelle génération se voit jugée comme « responsable de ses propres décisions », mais l’on se garde bien de lui enseigner les concepts de choix, de décision et de responsabilité.
Si quelques-uns parviennent à prendre de bonnes décisions, qu’en est-il des autres ? C’est là la raison de la promptitude des peuples à suivre la route de la servitude : il y a, dans l’intellect de chaque individu, une volonté plus ou moins marquée à revenir au foyer. Une détermination à retourner vers la simplicité de l’enfance et, plus encore si l’on n’a pas assimilé la nécessité d’être responsable de sa propre vie, vers l’autorité parentale. Non pas celle qui guide, mais celle qui épargne des expériences douloureuses, oubliant par-là que la famille ne fait pas que protéger, elle permet de devenir le souverain de sa propre vie, celui qui sera à même de fonder un foyer à son tour.
- Si tous les Chinois mangent en utilisant des baguettes, c’est que leurs parents les ont éduqués à le faire. La société conforte cette tradition, mais n’en est pas l’origine. En l’absence du soutien d’un foyer, le jeune sera toujours libre d’imiter ceux qu’il rencontrera dans leurs manières, mais il passera des années à maîtriser les habitudes les plus élémentaires. S’il est doué, son avenir ne s’en ressentira pas, mais s’il éprouve la moindre difficulté dans son instruction, il demeurera déphasé durant toute sa vie. ↩
- Ainsi que les principes de la société, que certaines véhiculaient. ↩
- Cette richesse, héritée de la première révolution industrielle, fut suffisante pour mener à bien deux guerres mondiales et reconstruire l’ensemble du monde après coup. ↩
- Qu’importe s’ils furent les gagnants ou les perdants. ↩




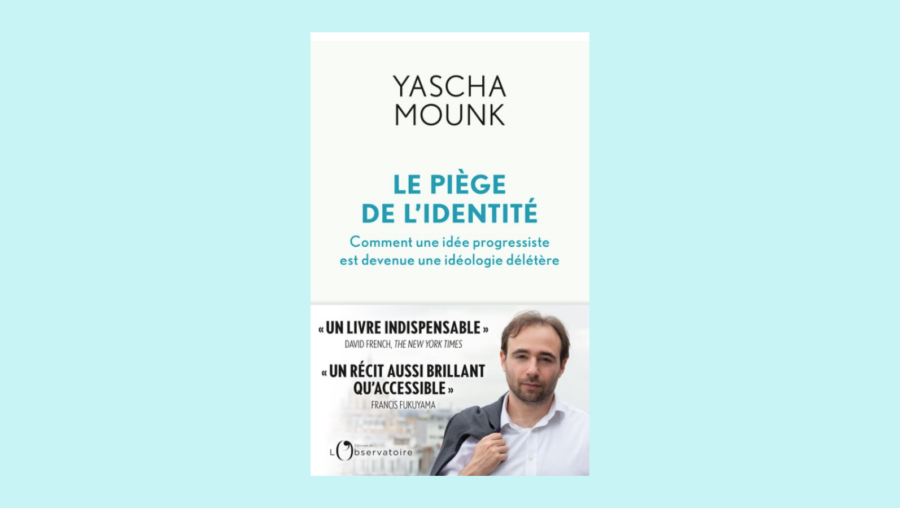
Oh, très belle manière de résumer le XXème siècle, et une très juste conclusion.
Je ne suis pas sûre néanmoins d’avoir bien tout saisi, vous parlez de foyer, puis communauté puis civilisation ok. Ce que vous nous dites c’est que l’individu doit prendre conscience qu’il est une personne responsable totalement de lui, à moitié responsable de son foyer, responsable dans sa communauté et un peu responsable de sa civilisation? Et pour les jeunes générations pour qui tout fout le camps, la responsabilité en saura d’autant plus importante?
” la promesse de la camaraderie, de la fraternité et de la solidarité, sont aisées à corrompre lorsque l’on enseigne plus la responsabilité qui va de pair.”
n’est-ce pas plutôt ” la promesse de la camaraderie, de la fraternité et de la solidarité, sont aisées à corrompre lorsque l’on n’enseigne plus la responsabilité qui va de pair.”?
M. Brunet Bommert écrit des choses fort justes. J’ai failli écrire:
“Dommage qu’il soit actuellement basé entre Hong Kong et Shenzhen, en Chine.”
Mais c’eût été injuste, donc stupide.
Simone Weil parlait elle aussi beaucoup d'”enracinement”.
C’est la clé de la crise actuelle, qui n’est pas “d’abord” économique.
Qui a dit: “les pauvres n’ont que la Patrie”? Et s’est bien vrai: le voudraient-ils, ils ne peuvent s’exiler.
Pardon: …”Et c’est bien vrai…”
S’il est basé en Chine, déjà, il n’en a rien à cirer des Droits Fondamentaux. C’est pas rien, dans une vie de libéral.
” basé entre hong kong et shenzen … ”
rien que ça , pour ceux qui connaissent un peu la géo de la chine , c’est à s’en pisser dessus … aller voir sur google map !
un ” québecquoi ” qui habite à hong kong , et qui vient nous parler d’identité nazionaleuleuleuleuleuleu ….
pour le reste, mais quel charabia mes amis , mon dieu mon dieu mon dieu …
” si la société se raffine … ” merci total !!
Il prévoit de se réinstaller dans le no man’s land entre les deux Corée. Pour jouer de la musique fort sans déranger personne, c’est le top.
De toute façon, je comprends RIEN à ce qu’il raconte.
“Un épisode si dévastateur que des millions de familles se retrouvèrent soudainement amputées d’une partie de leur substance : la première guerre mondiale, qui eut raison de dizaines de millions de foyers à travers le monde, est de ceux-là.” What. The. Hell.
réflexion faites , ça doit vouloir dire à hong kong ET shenzen ? il ne faut jamais se foutre de la gueule des gens trop vite !
j’ai rien compris non plus , ça ressemble à une dissertation de phylo du bac de français …
…. n’ayez pas peur….
l’identité nationale est une réalité, ne jouez pas au rouge, n’essayez pas de rayer ce que vous n’aimez pas ou ne comprenez pas.
évidemment il y a de multiples identités aussi