L’économiste de gauche James K. Galbraith critique très sévèrement le dernier ouvrage de Thomas Piketty. Que ce soient la définition du capital, le ratio richesse-revenus, la méthode qu’il emploie pour arriver à ses chiffres ou ses recommandations politiques, le keynésien de gauche n’épargne rien à l’économiste du parti socialiste.
Par James K. Galbraith [*] depuis les États-Unis.

Qu’est-ce que le capital ?
Pour Karl Marx, il s’agissait d’une catégorie sociale, politique et légale : les moyens de contrôle des moyens de production par la classe dominante. Le capital pouvait être monétaire, il pouvait s’agir de machines ; il pouvait être fixé ou bien variable. Mais l’essence du capital n’était ni physique ni financière. C’était le pouvoir que ce capital donnait aux capitalistes, en l’occurrence l’autorité de prendre des décisions pour extraire du travailleur son surplus.
Au début du siècle dernier, l’économie néoclassique a laissé tomber cette analyse sociale et politique pour une analyse mécanique. Le capital a été alors réenvisagé comme un objet physique qui, associé avec du travail, générait une production. Cette idée du capital permettait d’exprimer mathématiquement la fonction de production, de façon à ce que salaires et profits puissent être reliés aux produits marginaux respectifs de chaque facteur. Cette nouvelle vision des choses a ainsi élevé le rôle des machines au dessus du rôle social de leurs propriétaires, légitimant le profit comme la juste rétribution d’une contribution indispensable.
La mathématisation pousse à la quantification.
Par exemple, si l’on compte affirmer qu’une économie utilise plus de capital (par rapport au travail) qu’une autre, les facteurs doivent y être exprimés dans la même unité. Pour le travail, ce pourrait être une heure de temps de travail. Mais pour le capital ? Laissons de côté le «modèle céréalier de Ricardo, où le capital (les semences) et la production (la farine) sont un seul et même produit ; on doit d’une manière ou d’une autre rendre comparables les différents équipements et stocks qui constituent concrètement le stock de capital.
Mais comment ?
Bien que Thomas Piketty, professeur à l’école d’économie de Paris, ait écrit un livre massif intitulé Le Capital au XXIe siècle, il rejette explicitement (et de façon caustique) la vision marxiste. Il est sous certains abords sceptique de l’économie mainstream moderne, mais il voit quand même le capital (en principe) comme une agglomération d’objets physiques, tout comme dans la théorie néoclassique. Et il doit donc faire face à la question de comment mesurer quantitativement ce capital.
Son approche est en deux phases.
D’abord, il amalgame les biens physiques d’équipement avec toutes les formes de richesses mesurables par de l’argent, y compris les terrains et les logements, que cette richesse soit utilisée productivement ou non. Il n’exclut que ce que les économistes néoclassiques appellent le capital humain, sans doute parce que cela ne peut être acheté et vendu. Puis il estime ces richesses à leur valeur de marché. Sa mesure du capital n’est pas physique mais financière.
Je crains que ce ne soit là une source de confusion terrible.
Une bonne part de l’analyse de Piketty tourne autour du rapport entre le capital (tel qu’il le définit) et le revenu national : le ratio capital/revenu. Il devrait être évident que ce ratio dépend lourdement des variations de la valeur de marché. Piketty le dit, d’ailleurs. Par exemple, quand il décrit la chute du ratio capital/revenu en France, Grande-Bretagne et Allemagne après 1910, il ne parle qu’en partie de la destruction physique des biens d’équipement. Presque rien n’a été détruit en Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, et celles qui ont eu lieu en France ont été largement exagérées à l’époque comme l’a montré Keynes en 1919. Il y en a eu également très peu en Allemagne, qui est restée intouchée jusqu’à la fin de la guerre.
Alors, qu’est-il arrivé ? La variation du ratio de Piketty était largement due aux revenus les plus élevés, produits par la mobilisation générale, en regard de la valeur du capital sur le marché, où les gains étaient limités ou ont chuté pendant et après la guerre. Plus tard, quand les valeurs des actifs se sont effondrées pendant la Grande Dépression, ce n’est pour l’essentiel pas le capital physique qui s’est désintégré, mais seulement sa valeur de marché. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la destruction a joué un rôle plus important. Le problème est que, tandis que les changements de prix sont évidemment différents des modifications physiques, Piketty les traite comme s’ils étaient deux aspects du même phénomène.
L’évolution des inégalités n’est pas un phénomène naturel.
Piketty continue pour montrer que, en relation avec le revenu courant, la valeur de marché des biens de capital a fortement augmenté depuis les années 1970. Dans le monde anglo-américain, calcule-t-il, ce ratio est passé de 250 % ou 300 % alors à 500 % ou 600 % aujourd’hui. D’une certaine manière, le capital est devenu plus important, dominant, un plus grand facteur de la vie économique.
Piketty attribue cette augmentation à une croissance économique plus lente par rapport à la rémunération du capital, selon une formule qu’il qualifie de loi fondamentale. Algébriquement, il l’exprime par r > g, où r est la rémunération du capital et g la croissance du revenu. Ici encore, il semble parler de volumes physiques de capital, accrus année après année par les profits et l’épargne.
Sauf qu’il ne mesure pas des volumes physiques et que sa formule n’explique pas bien les tendances des différents pays. Par exemple, son ratio capital-revenu atteint un pic pour le Japon en 1990, il y a près d’un quart de siècle au début de la période de non-croissance du Japon, et en 2008 pour les États-Unis. Tandis qu’au Canada, qui n’a pas connu de krach financier, il a l’air de continuer à augmenter. Un esprit simple dirait que c’est la valeur de marché plutôt que la quantité physique de capital qui change, et que cette valeur de marché est entraînée par la financiarisation et exagérée par les bulles, gonflant où elles peuvent, et chutant quand elles explosent.
Piketty veut fournir une théorie relative à la croissance, qui nécessite du capital physique en entrée. Et pourtant, il utilise une mesure empirique qui n’a pas de rapport avec le capital physique productif et dont la valeur monétaire dépend en partie du rendement du capital. D’où vient ce taux de rendement ? Piketty le garde pour lui. Il se contente d’affirmer que le rendement du capital a eu une certaine valeur en moyenne dans l’histoire, mettons cinq pour cent sur la terre au dix-neuvième siècle, et davantage au vingtième.
La théorie néoclassique de base estime que le taux de rendement du capital dépend de sa productivité (marginale). Dans ce cas, on est censé penser au capital physique, et cela semble être (encore) l’opinion de Piketty. Mais les tentatives de construire une théorie du capital physique avec un taux de rendement technologique se sont effondrées il y a bien longtemps, sous les attaques foudroyantes de critiques de Cambridge (en Angleterre) dans les années 1950 et 1960, notamment Joan Robinson, Piero Sraffa et Luigi Pasinetti.
Piketty ne consacre que trois pages à la « controverse des deux Cambridge », mais elles sont importantes car largement erronées.
Il écrit :
« La controverse a continué […] entre des économistes basés surtout à Cambridge dans le Massachusetts (dont [Robert] Solow et [Paul] Samuelson) et d’autres économistes travaillant à Cambridge, en Angleterre […] qui voyaient dans le modèle de Solow (non sans une certaine confusion par moments) une affirmation selon laquelle la croissance est toujours parfaitement équilibrée, niant ainsi l’importance que Keynes attribuait aux fluctuations de court terme. Ce n’est pas avant les années 1970 que ce que l’on appelle le modèle néoclassique de croissance de Solow ne l’aura emporté. » [Retraduit de l’anglais, NdT]
Mais le sujet de la dispute n’était pas Keynes, ni les fluctuations. Elle portait sur le concept de capital physique et sur le fait de savoir si le profit pouvait être dérivé d’une fonction de production. Pour résumer autant que possible, l’affaire était triple. Premièrement : on ne peut pas additionner les valeurs des biens de capital pour obtenir une quantité globale sans un taux d’intérêt a priori, qui, puisqu’il est a priori, doit venir du monde financier et non du monde physique. Deuxièmement, si le taux d’intérêt réel est une variable financière, qui varie pour des raisons financières, alors l’interprétation physique d’un stock de capital évalué en termes monétaires est dénuée de sens. Troisièmement, et plus subtilement, si le taux d’intérêt baisse, il n’existe pas de tendance systématique à adopter une technologie plus intensive en capital, comme le modèle néoclassique le supposait.
En bref, la critique de Cambridge vidait de son sens l’affirmation selon laquelle les pays riches s’étaient enrichis en utilisant plus de capital.
En fait, les pays riches utilisent souvent moins de capital apparent ; ils produisent une plus grande part de services, et leurs exportations comportent davantage de travail (ce qu’on appelle le paradoxe de Leontief). Au lieu de cela, ces pays sont devenus riches, comme l’avança plus tard Pasinetti, en apprenant, en améliorant leurs techniques, en installant des infrastructures, avec de l’éducation et, comme je l’ai moi-même suggéré, en mettant en place une réglementation en profondeur et des assurances sociales. Rien de tout ça n’est censé avoir de relation nécessaire avec le concept de capital physique selon Solow, et encore moins avec une mesure de la capitalisation des richesses dans les marchés financiers.
Il n’y a aucune raison de croire que la capitalisation financière ait une relation étroite avec le développement économique. La plupart des pays asiatiques, y compris la Corée, le Japon et la chine, se sont fort bien portés pendant des décennies sans financiarisation, tout comme l’Europe continentale dans les années d’après-guerre, ou encore les États-Unis avant 1970.
Et le modèle de Solow ne l’a même pas emporté. En 1966, Samuelson a reconnu la validité de la position de ses contradicteurs !
La distribution des revenus
Le noyau empirique du livre de Piketty traite de la distribution des revenus d’après ce que révèlent les relevés fiscaux dans une poignée de pays riches ; principalement la France et le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, le Japon, la Suède et quelques autres. Ses vertus tiennent en ce qu’il permet une vision à long terme, et en ce qu’il donne une attention détaillée au revenu des élites, ce que d’autres approches du sujet manquent souvent.
Piketty montre qu’au milieu du XXe siècle, la part de revenu empochée par ces élites a chuté grâce principalement aux effets et répercussions de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit notamment de la syndicalisation, de la hausse des salaires, de l’imposition progressive sur le revenu, et des nationalisations et expropriations en Grande-Bretagne et en France. La part de l’élite est restée basse pendant trois décennies. Puis cette part a augmenté à partir des années 1980, fortement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, moins en Europe et au Japon.
La concentration de la richesse semble avoir atteint un maximum autour de 1910, chuté jusqu’en 1970, puis augmenté depuis. Si les estimations de Piketty sont correctes, la part de la richesse des élites en France et aux États-Unis reste aujourd’hui sous ses valeurs de la Belle Époque, tandis que la part des plus hauts revenus aux États-Unis est revenue à ce qu’elle était lors du Gilded Age [la période entre 1865 et 1901, NdT]. Piketty croit aussi que les États-Unis sont un cas extrême, et que les inégalités de revenus aux États-Unis y dépassent celles que l’on trouve dans les grands pays émergents, comme l’Inde, la Chine ou l’Indonésie.
Ces mesures sont-elles originales et fiables ? En entrée de jeu, Piketty clame être le seul héritier vivant de Simon Kuznets, le grand spécialiste des inégalités du milieu du vingtième siècle. Il écrit :
« Étonnamment, personne n’a poursuivi les travaux de Kuznets de manière systématique, sans doute en partie parce que l’étude historique et statistique des relevés fiscaux est dans une sorte de no man’s land académique, trop historique pour les économistes et trop économiste pour les historiens. C’est dommage, parce que la dynamique des inégalités de revenus ne peut être étudiée que dans une perspective de long terme, ce qui n’est possible que si l’on utilise les relevés fiscaux. » [Retraduit de l’anglais, NdT]
Cette affirmation est incorrecte. Les relevés fiscaux ne sont pas la seule source de données fiables sur les inégalités ; dans un papier publié en 1999, Thomas Ferguson et moi-même avons cherché de telles données pour les États-Unis de 1920, et nous avons trouvé à peu près la même tendance que Piketty trouve aujourd’hui1.
 Il est bon que nous voyions nos résultats confirmés, puisque cela souligne un point de grande importance.
Il est bon que nous voyions nos résultats confirmés, puisque cela souligne un point de grande importance.
L’évolution des inégalités n’est pas un processus naturel. L’égalisation massive aux États-Unis entre 1941 et 1945 était due à la mobilisation, opérée sous un contrôle des prix strict accompagné de taux marginaux confiscatoires de l’impôt sur le revenu. Le but était de doubler la production sans créer de millionnaires profitant de la guerre. Inversement, le but de l’économie de l’offre après 1980 était (principalement) d’enrichir les riches. Dans les deux cas, ces politiques ont largement atteint leurs objectifs.
Sous le président Reagan, les changements au code américain des impôts ont encouragé une plus grosse rémunération des dirigeants d’entreprise, l’utilisation de stock options, et (indirectement) la dispersion des firmes high-tech en entreprises capitalisées séparément, qui deviendraient à terme Intel, Apple, Oracle, Microsoft et les autres. Maintenant, les revenus les plus élevés ne sont plus des salaires fixes, mais suivent de près le marché boursier. C’est le simple résultat de la concentration de la propriété, du mouvement du prix des actifs, et de l’utilisation du capital pour payer les dirigeants. Pendant la bulle technologique, la correspondance entre l’évolution des inégalités de revenus et le NASDAQ était parfaite, comme Travis Hale et moi-même l’avons montré dans un papier tout juste publié dans la World Economic Review.
Le lecteur profane ne sera pas surpris.
Cependant, les universitaires doivent composer avec le travail classique et dominant de Claudia Goldin et Lawrence Katz entre autres, qui affirment que le modèle de l’évolution des inégalités de revenu résulte d’une « course entre l’éducation et la technologie » quand il s’agit des salaires, où l’un est d’abord en tête, puis cède sa place à l’autre. (Quand l’éducation mène, les inégalités sont censées baisser, et inversement). Piketty fait preuve de déférence envers cette affirmation, mais n’ajoute aucune preuve en sa faveur, et ses faits le contredisent. La réalité est que les structures salariales changent bien moins que les revenus issus des profits, et que l’essentiel de l’augmentation des inégalités vient d’un flux plus important de revenus des profits vers les très riches.
En comparaison mondiale, il y a un large faisceau d’indices convergents, et pour autant que je sache, rien ne vient soutenir l’affirmation de Piketty selon laquelle les revenus aux États-Unis aujourd’hui seraient plus inégaux que dans les grands pays émergents. Branko Milanovic indique que ce sont l’Afrique du Sud et le Brésil qui ont les inégalités les plus marquées. De nouveaux travaux du Luxembourg Income Study (LIS) placent l’inégalité des revenus en Inde loin devant celle des États-Unis. Mes propres estimations placent cette dernière en dessous de la moyenne des pays hors OCDE, et elles sont cohérentes avec celles du LIS concernant l’Inde.
Une explication probable pour ces divergences est que les données relatives à l’impôt sur le revenu ne sont comparables que dans la mesure des revenus imposables, et leur précision est limitée par l’efficacité des systèmes fiscaux. Ces deux facteurs posent problème dans les pays en voie de développement, où les données fiscales ne reflèteront guère le niveau d’inégalités que d’autres mesures révèlent. (Et dans les émirats pétroliers qui n’imposent pas les revenus, on ne peut pas avoir de données). Inversement, de bons systèmes fiscaux révèlent les inégalités. Aux États-Unis, le fisc reste craint et respecté, les riches déclarant, pour la plupart, l’essentiel de leurs revenus à l’IRS. Les données fiscales sont utiles, mais c’est une erreur de les prendre pour parole d’Évangile.
Un livre sur le capital qui ne parle pas du capital
Pour résumer jusqu’ici, le livre de Thomas Piketty sur le capital ne parle ni du capital au sens que lui donnait Marx, ni du capital physique utilisé comme facteur de production dans le modèle néoclassique de croissance économique.
C’est un livre qui parle de la valeur attribuée à des actifs tangibles et financiers, de la distribution de ces actifs à travers le temps, et de la richesse héritée d’une génération par la suivante.
En quoi est-ce intéressant ? Adam Smith a écrit quoi en penser, d’une façon lapidaire et sans appel : « La richesse, comme le dit M. Hobbes, c’est le pouvoir ». L’évaluation de la richesse privée mesure le pouvoir, même si son propriétaire ne joue aucun rôle économique actif. Les propriétaires absents, ou les frères Koch, ont ce genre de pouvoir. Piketty l’appelle capitalisme patrimonial, c’est-à-dire pas le vrai capitalisme.
« Le vieux système des taux d’imposition marginaux élevés était efficace en son temps. Mais est-ce que revenir à ce système marcherait ? Hélas, non. »
Grâce à la Révolution française, l’enregistrement des richesses et des héritages est fiable depuis longtemps dans la patrie de Piketty. Ce qui permet à ce dernier de montrer comment la concentration de la richesse est simplement déterminée par le rendement des actifs et la croissance de la population. Si le taux de rendement dépasse le taux de croissance, alors les riches et les vieux s’enrichiront par rapport aux autres. En même temps, les héritages dépendent du degré avec lequel les vieux vivent (plus ils vivent longtemps, plus ils accumulent), et du rythme auquel ils meurent. Ces deux forces engendrent un flux d’héritages que Piketty estime en ce moment à environ 15 % du revenu annuel de la France ; étonnamment haut pour un facteur qui n’attire aucune attention des journaux et des manuels d’économie.
Qui plus est, pour la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, le « flux d’héritages » augmente depuis 1980, son niveau passant de négligeable à substantiel, en raison d’un taux de rendement des actifs financiers plus élevé, ainsi que d’une mortalité légèrement croissante dans une population plus âgée. La tendance semble devoir continuer, même si l’on se demande quel sera l’effet de la crise financière sur les valeurs des actifs. Piketty montre aussi (dans la faible mesure où ses données le lui permettent) que la part de richesse mondiale tenue par un petit groupe de milliardaires a augmenté bien plus que le revenu moyen au niveau mondial.
Quel est le problème politique ? Piketty écrit :
« Qu’importe si les inégalités de richesse ont été initialement justifiées, les fortunes peuvent croître et se perpétuer au-delà de toute limite raisonnable, et au delà de toute justification rationnelle possible en termes d’utilité sociale. Les entrepreneurs tendent ainsi à devenir des rentiers, non seulement avec le passage des générations, mais même au cours de leur propre vie… Une personne qui a de bonnes idées à quarante ans n’en aura pas nécessairement à quatre-vingt-dix, et ses enfants non plus. Pourtant, leur richesse reste. » [Retraduit de l’anglais, NdT]
Avec ce passage, il fait une distinction qu’il avait auparavant laissée dans le flou : entre la richesse justifiée par « l’utilité sociale » et celle qui ne l’est pas. C’est la vieille distinction entre « profit » et « rente ». Mais Piketty a supprimé notre capacité à utiliser le mot « capital » dans son sens normal, désignant un facteur de production qui génère un profit dans le secteur « productif », pour le distinguer de la source de revenu du « rentier ».
Comme remède, Piketty demande une mesure spectaculaire, un « impôt mondial progressif sur le capital », formule qui désigne un impôt sur la fortune. En effet, qu’est-ce qui pourrait mieux convenir à une ère d’inégalités (et de déficits budgétaires) qu’un prélèvement sur les avoirs des riches, peu importe leur lieu et leur nature ? Mais si un tel impôt ne parvient pas à distinguer les fortunes qui ont encore leur « utilité sociale » et celles qui n’en n’ont pas, distinction que Piketty vient tout juste d’inventer, alors il ne s’agit peut-être pas d’une idée assez mûrement réfléchie.
Dans tous les cas, Piketty admet que sa proposition est « utopique ». Pour commencer, dans un monde où seuls quelques pays mesurent les hauts revenus de manière fiable, il faudrait complètement recenser la matière fiscale, créer un Domesday Book (le recensement des propriétés de l’ensemble de l’Angleterre, commandé au XIe siècle par Guillaume le Conquérant) mondial et annuel mesurant les avoirs nets de tout le monde. C’est au-delà des capacités même de la NSA. Et si la proposition est utopique, ce qui est un synonyme de vaine, alors pourquoi la proposer ? Pourquoi lui consacrer un chapitre entier, à moins peut-être pour y inciter les naïfs ?
D’autres opinions politiques de Piketty se trouvent dans deux chapitres où le lecteur risque d’arriver, après près de cinq cents pages, un peu fourbu. Elles le montrent ni comme un révolutionnaire, ni comme un néolibéral, ni même comme spécifiquement Européen. Malgré ses remarques désobligeantes plus tôt sur la sauvagerie des États-Unis, il s’avère que Thomas Piketty est un social-démocrate typique et redistributeur largement dans le moule du New Deal américain.
Comment le New-Deal s’est-il attaqué à la forteresse de privilèges qu’étaient les États-Unis du début du vingtième siècle ?
D’abord, il a fallu bâtir un système de protection sociale, notamment la Social Security, le salaire minimum, des normes de travail équitables, de l’écologie, des emplois publics, des travaux publics, sachant que rien de tout ça n’existait auparavant. Et les gens du New Deal ont réglementé les banques, refinancé les prêts hypothécaires, subjugué le pouvoir des entreprises. Ils ont construit une richesse partagée en commun par tout le monde en contrepoids des actifs privés.
Une autre partie du New Deal (surtout dans sa dernière phase) était la fiscalisation. Avec la guerre qui approchait, Roosevelt a infligé des taux marginaux d’imposition élevés, surtout sur les revenus issus de la propriété du capital. L’effet en était de décourager les grosses rémunérations des dirigeants. Les grandes entreprises ne distribuaient pas leurs bénéfices, construisaient des usines et (après la guerre) des gratte-ciel, et ne diluaient pas leurs actions en les distribuant à des initiés.
Piketty ne consacre que quelques pages à l’État-providence. Il dit peu de choses sur les biens publics : son objectif reste l’impôt. Pour les États-Unis, il exhorte à un retour à des taux nationaux de 80 % sur les revenus annuels au-delà de 500 000 dollars et d’un million de dollars. C’est peut-être son idée la plus populaire auprès des cercles de la gauche américaine, nostalgiques du bon vieux temps. Et pour sûr, le vieux système des hauts taux marginaux d’imposition était efficace en son temps.
Mais est-ce que ça marcherait de revenir maintenant à ce système ? Hélas, non. Dans les années 1960 et 1970, ces taux marginaux étaient bourrés de niches fiscales. Les chefs d’entreprises compensaient leurs petits salaires par de gros avantages en nature. Ces taux étaient surtout haïs par les quelques-uns qui gagnaient de grosses sommes avec leur travail (le plus souvent) honnête, et devaient vraiment payer : stars du sport, acteurs de cinéma, artistes, auteurs de renom, etc. Le point important du Tax Reform Act de 1986 était de simplifier les choses en imposant les taux plus bas à une base bien plus large de revenus taxables. Remonter les taux ne produirait pas (et Piketty le reconnaît) une nouvelle génération d’exilés fiscaux. La raison en est qu’il serait trop facile d’éviter ces taux, avec des astuces que n’avaient pas les ploutocrates moins mondialisés de la génération de nos grands-parents. Quiconque est familier avec les niches fiscales internationales comme le « double sandwich irlandais-hollandais » sait de quoi je parle.
Si le cœur du problème est un taux de rendement des actifs privés qui est trop élevé, la meilleure solution serait de l’abaisser. Comment ? Augmentez les salaires minimum ! Ça diminue le rendement du capital qui repose sur le travail peu qualifié. Soutenez les syndicats ! Taxez les profits des entreprises et les plus-values du capital des individus ! Baissez les taux d’intérêts qu’on attend aujourd’hui des entreprises ! Cela se fait en créant de nouveaux prêteurs publics et coopératifs pour remplacer les méga-banques zombies d’aujourd’hui. Et si quelqu’un se préoccupe des droits monopolistiques accordés par la loi et les accords commerciaux aux gros labos pharmaceutiques, aux grands media, aux avocats, aux docteurs et aux autres, il y a toujours la possibilité (comme le rappelle Dean Baker) d’introduire davantage de concurrence.
Enfin, il y a les droits de succession et de donation, ce bijou de l’Ère Progressiste [NdT : une période qui succède au Gilded Age, et va des années 1890 à la Première Guerre Mondiale, marquée par des réformes politiques, économiques et sociales comme la Prohibition]. Ils ont les faveurs de Piketty, mais pour de mauvaises raisons. Le but premier des droits de succession n’est pas de ramener de l’argent, ni même de ralentir la création de fortunes démesurées en tant que tel, puisque l’impôt n’interfère pas avec la créativité ou la destruction créatrice. L’idée est de bloquer la formation de dynasties. Et la grande vertu de cet impôt, comme il est appliqué aux États-Unis, est la culture de la philanthropie ostentatoire qu’il favorise, en recyclant la fortune vers les universités, les hôpitaux, les églises, les théâtres, les bibliothèques, les musées et les revues indépendantes.
Voilà les associations sans but lucratif qui créent environ 8 % des emplois américains, et dont les services améliorent le niveau de vie de toute la population. Évidemment, l’impôt qui nourrit cette philanthropie est aujourd’hui très érodé, les dynasties sont un énorme problème politique. Mais à la différence de l’impôt sur le capital, l’impôt sur les successions reste viable, en principe, parce qu’il nécessite que la richesse soit évaluée une seule fois, à la disparition de son propriétaire. Bien plus pourrait être fait si la loi était plus stricte, avec un taux plus haut, un seuil plus immédiat, pas de niches, et moins d’utilisation des fonds en résultat pour promouvoir des politiques néfastes, comme abolir cet impôt.
Au final, Le capital au XXIe siècle est un livre lourd, rempli d’informations de qualité sur les flux de revenus, des transferts de richesse, et la distribution des ressources financières dans certains des pays les plus riches du monde. Piketty avance avec raison, depuis le début, que la science économique de qualité doit commencer, ou au moins inclure, un examen méticuleux des faits. Pourtant, il ne constitue pas un guide politique sérieux. Et malgré ses grandes ambitions, son livre n’est pas le chef d’œuvre de grande théorie que son titre, sa longueur, et sa réception (jusqu’ici) ne le suggéreraient.
—
Paru dans le magazine américain Dissent (printemps 2014) sous le titre « Kapital for the Twenty-First Century? ». Traduction : Benjamin Guyot pour Contrepoints
[*] James K. Galbraith est professeur à la Lyndon B Johnson School of Public Affairs, à l’Université du Texas à Austin, et auteur de The End of Normal, à paraître bientôt.
Retour au sommaire de l’édition spéciale “Piketty superstar ?”
- « The American Wage Structure, 1920–1947 », publié dans Research in Economic History. Vol. 19, 1999, 205–257. Mon livre de 1998, Created Unequal, traitait déjà des inégalités salariales de 1950 au début des années 90. Pour une mise à jour récente, cf. James K. Galbraith et J. Travis Hale, « The Evolution of Economic Inequality in the United States, 1969–2012: Evidence from Data on Inter-industrial Earnings and Inter-regional Incomes. » publié dans World Economic Review, 2014, no. 3, 1–19, disponible à http://tinyurl.com/my9oft8. ↩


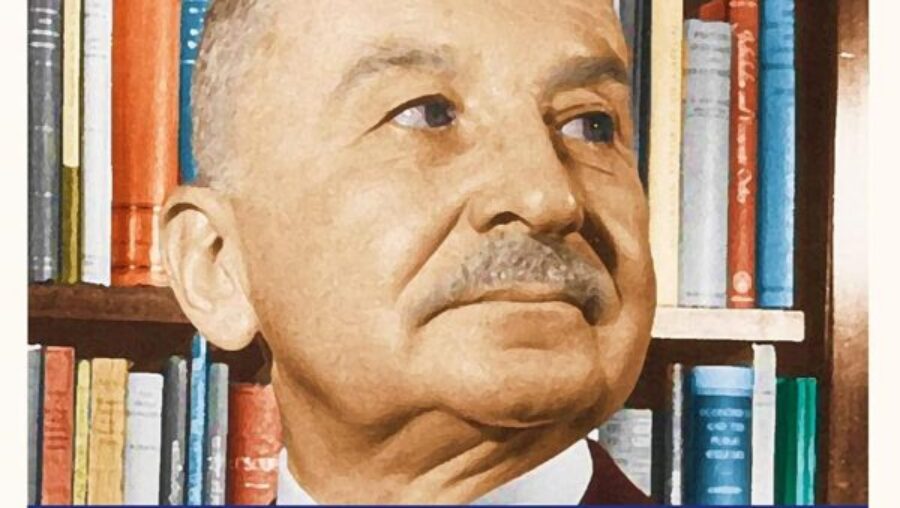

On peut reconnaître à Piketty le mérite d’avoir éveillé (à défaut de le conclure) un débat passionnant… pour peu qu’on s’intéresse au sujet 🙂
“les pays riches utilisent souvent moins de capital apparent ; ils produisent une plus grande part de services, et leurs exportations comportent davantage de travail (ce qu’on appelle le « paradoxe de Leontief »). Au lieu de cela, ces pays sont devenus riches, comme l’avança plus tard Pasinetti, en apprenant, en améliorant leurs techniques, en installant des infrastructures, avec de l’éducation”
Je me souviens de travaux montrant que l’instruction des travailleurs comptait moitié moins que l’investissement par tête dans la hausse de la productivité, malheureusement j’ai oublié le nom des auteurs 🙁 (Razzak et Timmins ?). Cela me fait penser un peu à la situation des BRICs, où le capital marginal supplémentaire venu de l’étranger peine à se “réaliser” pleinement faute de qualifications des travailleurs à la marge. Du coup la vitesse de développement économique exacerbe l’hétérogénéité de la population et creuse mécaniquement les inégalités déjà existantes, le temps de la transition vers une économie globalisée. C’est à mon sens ce qui explique pourquoi, contrairement aux affirmations de Piketty, et comme le rappelle Galbraith ici, les inégalités sont plus profondes en Inde qu’aux USA. A quel point l’homogénéité d’une population joue sur les inégalités de revenus, comparée au niveau de “redistribution” appliqué par l’état ? Il me semble que la progressivité des taux d’imposition est plutôt faiblement correlée aux indices de Gini: http://ftp.iza.org/dp6910.pdf (et je crois que le faible effet observé s’explique non par la redistribution faite autoritairement, mais plutôt par une évolution du niveau de charité effectivement désiré par la population qui jouerait le rôle de variable confondante).
Bref si l’afflux de capital creuse effectivement des inégalités, l’alternative constituerait un nivellement par le bas inacceptable. Pourquoi tuer toute croissance dans l’espoir (peut-être vain) de ralentir le creusement des inégalités ?
Galbraith poursuit:
“La réalité est que les structures salariales changent bien moins que les revenus issus des profits, et que l’essentiel de l’augmentation des inégalités vient d’un flux plus important de revenus des profits vers les très riches.”
Je me demande aussi à quel point cet accroissement des revenus des très riches est une situation transitoire, voire éphémère, due au moins en partie à la succession de bulles spéculatives engendrées par le crédit facile des dernières décennies, et la marée de déflation qui frappe la finance mondiale depuis quelques années. Les plus riches sont aussi les plus puissants (et inversement) et sont les mieux placés pour profiter des bulles, puis parviennent à se prémunir (au détriment de tous les autres) de la déflation par la manipulation des cours et la corruption des institutions (interventions des banques centrales, scandale du Libor, bailouts, etc.) – toutes choses dénoncées justement sur Contrepoints et qui ne constituent pas un capitalisme libéral.
Dans tous les cas, le livre de Piketty comme la critique de Galbraith tombent dans le même écueil fondamental dénoncé par les libéraux: il ne répond pas à la bonne question parce qu’il se focalise sur un concept d’inégalité qui est statique, global … et finalement assez inutile au progrès de l’Homme. Personne dans ce monde ne part de la même ligne de départ, et “égalité” ne signifie pas essayer de nous faire arriver ensemble à la même ligne d’arrivée non plus. Améliorer le sort de tous, cela veut dire raccourcir pour tous la longueur et la pénibilité du trajet, cela veut dire que la seule inégalité qui compte vraiment c’est celle entre là d’où je pars et là où je pourrais arriver sans faire de mal aux autres. Une inégalité qu’il convient de maximiser plutôt que de réduire.
Par ailleurs mêmes les solutions avancées d’impots sur la fortune généralisés ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais: la progressivité des taux est incapable des effets que lui attribuent Piketty et Galbraith: http://www.heritage.org/budgetchartbook/Images/income-tax-receipts-600.jpg
Taxez les plus riches, et vous déformez la structure des prix et des revenus en sens inverse ce qui répartit la charge fiscale (qu’elle croisse ou qu’elle baisse) sur tout le monde, riche comme pauvre – sauf sur ceux qui peuvent se faire payer de force et décréter autoritairement le niveau de leurs indemnités.
Pareil avec une hausse imposée des salaires minimaux: c’est une mesure néfaste qui enferme les plus vulnérables dans une trappe d’exclusion sociale, et donc aggrave l’hétérogénéité de la population et donc, du raisonnement même exposé dans l’article, aggraverait l’écart de vitesse entre riches et pauvres.
http://fr.irefeurope.org/Richesses-et-croissance-les-tromperies-statistiques-de-Thomas-Piketty,a2892
http://philmagness.com/?tag=thomas-piketty
http://institutdeslibertes.org/piketty-ou-quand-un-oint-du-seigneur-se-prend-les-pieds-dans-le-tapis/#.U2-S1UN3c_M.facebook
http://www.atlantico.fr/decryptage/polemique-chiffres-piketty-ecrase-debat-plus-grand-que-lui-nicolas-goetzmann-1591587.html
ASSOCIATION POUR LA MEMOIRE DES CRIMES HISTORIQUES ET ACTUELS DU COMMUNISME: https://www.facebook.com/pages/AMCHAC/166611226830060