Par Julien Gayrard
L’acception du terme de libéralisme en France ne recouvre pas la signification qu’on peut lui donner ailleurs, loin s’en faut. « On le sait ! » aurez-vous, libéraux, tôt fait de rétorquer : ils seront là-bas appelés progressistes, là-bas conservateurs et là-bas libertaires. Nous, nous nous comprenons. Nous avons notre bible. Le drame de toute redéfinition est de se faire souvent pro domo.
Un mot n’est jamais qu’un signe1 renvoyant vers un contenu culturel et cognitif propre à la compréhension de chacun. Celui de « libéralisme », comme un autre, peut, à vouloir rassembler différentes significations, devenir un obstacle à toute compréhension de ce vers quoi il chercherait à faire signe. Comme tout suffixe doctrinal, l’isme du libéralisme, comme celui du marxisme ou de tout autre isme au potentiel idéologique, permet de regrouper des notions éparses, proches les unes des autres mais parfois éloignées. Force est alors un jour de chercher à sans dégager : libertarien ou marxien font ce genre d’apparition pour se débarrasser de cet écrin qui, destiné à mettre en valeur un contenu, finit par l’occulter. Ou en vue d’en dire un autre… Mécompris que nous sommes.
Redistribuer les cartes…
Supposons, béotien, que nous ne sachions pas quel lien établir entre un libéralisme littéraire, un libéralisme économique et une doctrine de la liberté. Mieux encore : situons-nous aux antipodes de toute compréhension préalable. Antipodiens, pour reprendre cette belle idée de Richard Rorty affirmant une nécessaire herméneutique, nous ne savons pas de ce dont il s’agit…
Si nous annonçons que « le libéralisme n’est pas une philosophie de la liberté », la compréhension de ce titre se fera, pour chacun, sur la base de ce que ces termes retiennent chez lui, de ce vers quoi ils font signe et de la façon dont il articule ces termes (le gap entre libéral et libéral peut être ici immense). C’est avec ces cartes et l’ordonnance de ces cartes que chacun peut alors répondre à cet énoncé par la négative, l’affirmative ou la critique (il pourra également lire l’article cité).
Un homme libre est il un libéral ? Le tort d’un libéralisme à la française pourrait alors être celui de ne plus douter de son identité. Dans une obsession partisane à lever le doigt pour dire son nom, plutôt que de dire ce qu’il est ou, mieux, ce qu’il croit être (nous sommes donc en politique). Tort aussi qu’il aurait de passer son temps à pointer son index, et avec raillerie, sur ce qu’il n’est pas… Sorte d’affirmation malheureuse de soi dans la négation de l’autre et définition en creux. Tous, nous voulons la liberté, l’humanité, le bien être de l’autre. Disant cela, nous ne disons rien. Et quiconque peut alors se prétendre libéral (on a pu entendre des barrons de partis d’extrême gauche se déclarer « libéraux ») comme quiconque, libéral, pourrait s’avérer ne l’être pas.
Citons, en creux, ce qu’écrivait Ludwig von Mises, en creux puisque von Mises y fait une déclaration thétique, partant de ce qu’il qualifie de libéralisme et y rassemblant non seulement ce qu’il faut entendre par là et mais également ce qui ne l’est pas. Nous sommes en 19562 :
« Ceux qui ont l’habitude des écrits publiés ces dernières années sur le libéralisme vont peut-être m’objecter que ce qui est appelé libéralisme dans le présent ouvrage ne coïncide pas avec ce que l’on comprend habituellement sous ce terme dans la littérature politique contemporaine. Je suis loin de le nier. Au contraire, j’ai moi-même souligné que ce que l’on entendait sous le vocable de “libéralisme” aujourd’hui, particulièrement en Allemagne, est totalement différent de ce que l’histoire des idées appelle “libéralisme” pour décrire le contenu du programme libéral des XVIIe et XVIIIe siècles. Presque tous ceux qui se prétendent de nos jours “libéraux” refusent de se prononcer en faveur de la propriété privée des moyens de production et défendent des mesures en partie socialistes et interventionnistes. Ils cherchent à justifier leur position en expliquant que l’essence du libéralisme ne consisterait pas à adhérer à l’institution de la propriété privée mais à d’autres choses, et que ces autres choses exigent un développement plus poussé du libéralisme, qui ne devrait plus dès lors défendre la propriété privée des moyens de production mais se faire à la place l’avocat du socialisme et de l’interventionnisme. Ce que ces “autres choses” peuvent bien être, les pseudo-libéraux doivent encore nous l’expliquer. Nous les entendons beaucoup parler d’humanité, de magnanimité, de véritable liberté, etc. Il s’agit certainement de sentiments nobles et respectables que tout le monde approuvera immédiatement. En fait, toute idéologie y souscrit. Toute idéologie – hormis quelques courants de pensée cyniques – pense défendre l’humanité, la magnanimité, la véritable liberté, etc. »
Outre la courte définition que fait ici von Mises du libéralisme comme adhésion « à l’institution de la propriété privée » et l’accusation concernant celui qui n’y adhère d’être « l’avocat du socialisme et de l’interventionnisme », nous aurions tendance, un demi-siècle plus tard, à voir qu’en effet la tradition libérale s’inscrit, toujours et néanmoins, comme un ensemble de préceptes.
Si, par libéralisme, j’entends la protection de la liberté et de la propriété individuelle, ne serait-ce pas, toujours et partout, parce qu’il s’agit, surtout et d’abord, de la protection de mes propres libertés et de mon propre intérêt ? Posture qui est l’apanage de toute politique fallacieuse, jouant du déni et du bien de tous et de chacun : le bien de l’autre, mais sous couvert du mien. Et il faudrait s’accorder ici avec von Mises, pour affirmer que tous sont de « pseudos-libéraux »… et ainsi les libéraux.
Face à un von Mises, ici doctrinaire, cherchant à introduire dans la réalité ce que la théorie distille, il existe une myriade d’auteurs littéraires ayant eu un discours et une approche pragmatique du libéralisme, tirant conseils et avis de leurs observations. Une approche comme celle d’un auteur qui songerait à sortir l’autre de la pauvreté en lui murmurant à l’oreille pour lui enseigner des « libère-toi ! », avant d’affirmer sa propre liberté. D’un auteur défiant vis-à-vis de l’affirmation de soi comme modèle, un auteur affirmant pourtant les nécessités de la libre entreprise et des droits individuels, du libre-échange et du cosmopolitisme, voulant aussi le progrès social, celui technologique et doutant également de la capacité et du bien fondé de la gestion gouvernementale de toute chose : Mark Twain.
Mark Twain, comme nombre d’autres grands auteurs, a ce mérite de montrer qu’il n’y a pas d’individualisme véritable mais une légitime et subjective recherche de la liberté.
Mark Twain et la société civile – un inclassable entre progressistes et conservateurs ?
Dans un article publié par le Ludwig von Mises Institute, en 2010, Jeffrey A. Tucker3 met en exergue la distance sémantique que les termes de Liberal ou Conservative opèrent à travers l’histoire. Un liberal, au sens anglo-saxon, est un progressiste. Il faut comprendre que tout qualificatif, nous l’avons dit, fait signe vers ce que chacun retient. Il souligne avec raison qu’il n’y a pas de choix à faire.
 Mark Twain reste outre-Atlantique un auteur aussi bien qualifié de « liberal » que de « conservative ». Cette confusion, nous dit Tucker, est en partie due au changement de sens du terme de « liberalism » en tant qu’idéologie, et à l’incapacité de la critique contemporaine de comprendre les implications que ce terme pouvait avoir au 19ème siècle.
Mark Twain reste outre-Atlantique un auteur aussi bien qualifié de « liberal » que de « conservative ». Cette confusion, nous dit Tucker, est en partie due au changement de sens du terme de « liberalism » en tant qu’idéologie, et à l’incapacité de la critique contemporaine de comprendre les implications que ce terme pouvait avoir au 19ème siècle.
Au moment où Twain meurt, en 1910, nous rappelle Tucker, « le liberalism était à l’aube d’une transformation. L’âge d’or du capitalisme avait montré son visage, avant de disparaitre, et avait provoqué l’envie et l’idolâtrie de la plupart des gens. La vision progressiste du liberalism provoqua alors un glissement vers le socialisme et la gestion gouvernementale ». « Un demi-siècle plus tard, le liberalism aura pris un sens radicalement opposé à celui qu’il avait au 19ème siècle, ceux qui s’opposaient à la gestion gouvernementale et étaient en faveur de la libre entreprise étant alors appelés conservatives. »
Mais la puissance littéraire de Twain, outre la traçabilité concernant le libéralisme que Jeffrey A. Tucker y voit, réside aussi dans sa volonté systématique de sortir l’autre (les enfants) de la naïveté. Twain est en ce sens un écrivain des Lumières, un Voltaire américain qui, plutôt que de dire ce qu’est la liberté, la montre. Le meilleur moyen de comprendre le libéralisme, disons, pragmatique et anti-étatiste de Twain, comme critique de la société mais également entreprise de libération de l’autre reste de le lire.
Le Prince et le pauvre : tout pouvoir corrompt
L’attitude générale que Twain adoptera envers le pouvoir politique se retrouve dans la description de la transformation de Tom Canty dans Le Prince et le pauvre (1881) : Tom est un pauvre qui se retrouve en situation de remplacer le prince suite à une confusion d’identité provoquée par un jeu idiot consistant à s’échanger les vêtements. Voilà Tom devenu Prince. Lorsque notre prince reconnait de l’intérieur les ravages que peut provoquer le pouvoir, il se scandalise et entreprend alors de faire des réformes sociales. Mais le Tom Canty d’autrefois, doux, charmant et sans cruauté, subit alors un changement radical, une fois le pouvoir à sa disposition4 :
« L’étoile qui présidait à sa destinée prenait de jour en jour un éclat plus splendide. Bientôt cette étoile ne se trouva plus voilée par aucun nuage et inonda le monde de ses feux. Tom avait dépouillé toutes ses hésitations, toutes ses craintes. On ne se souvenait plus de ses gaucheries. Son embarras avait fait place à la grâce, à l’aisance, à la confiance. Et tout cela était l’œuvre secrète de l’enfant du fouet. […] Les adulations de ses courtisans, leurs salamalecs lui semblaient une musique enivrante ; mais cet enivrement ne lui faisait point perdre sa bonté naturelle ; il était et demeurait le défenseur résolu des pauvres, des faibles et des opprimés ; il avait déclaré une guerre impitoyable aux abus et aux iniquités et il la menait vigoureusement et sans relâche. Il lui était déjà arrivé de relever un mot prononcé trop haut par un comte ou un duc et de faire trembler l’audacieux sous son regard. ».
Voila notre Tom devenu Prince du Bien. Pourtant, lors de la Recognition procession, ses sentiments semblent avoir changés5 :
« Tom Canty contemplait cette mer mouvante qui s’agitait à ses pieds, et sur laquelle il semblait marcher ; son cœur se gonfla d’orgueil et il se dit qu’il n’y a pour l’homme qu’un but en ce monde : être Roi et être l’idole d’une nation ! »
Le pouvoir corrompt. Il corrompt non seulement le réformateur mais aussi ceux qui ont l’intention d’utiliser leur pouvoir au nom de la liberté, comme voulait le faire Tom Canty durant les premiers stades de son règne. Le système bureaucratique et institutionnel provoque cela chez les meilleures personnes, et ce pouvoir dans les mains des plus mauvaises peut libérer toute sorte de maux qu’elles qualifieront de Bien.
Tom Sawyer et Huckleberry Finn ou l’absence de l’État
Le thème du pouvoir corrupteur revient également dans Les aventures de Tom Sawyer et Les aventures de Huckleberry Finn, deux grands romans américains dans lesquels l’État brille par son absence ou la tentative de le fuir. Cela fait en effet partie du grand charme et de la puissance durable de ces deux romans : ils décrivent les affaires d’une société évoluant en dehors de l’État. L’État n’y a qu’un rôle négatif : il fabrique et impose des lois et pousse nos héros à devenir des hors-la-loi cherchant la liberté ailleurs. Mais cette liberté à laquelle invite Twain est aussi celle montrant du doigt le jeu que mettra en œuvre chaque individu pour se départir de l’autre en cherchant à le tromper.
Au début du roman, Tom mystifie une série d’enfants afin qu’ils fassent le travail à sa place, celui de peindre une clôture, prétextant qu’il s’agit là non pas d’un labeur mais plutôt d’un appel venu de plus haut et auquel il faut être fier de souscrire. Une fois que ses camarades observent la fierté que Tom feint de tirer de la peinture, ils décident qu’ils aimeraient aussi peindre. Il refuse d’être payé pour le faire, car pouvoir le faire est une chance. Tom négocie alors et de la même façon cette occasion qu’ils ont de peindre une clôture pour d’autres marchandises : une pomme, un cerf-volant, un rat mort, une “corde pour le faire balancer” et bien plus encore. Ces éléments peuvent sembler sans valeur, d’un certain point de vue, mais sont pourtant très prisés par leurs propriétaires.
L’objectif que les amis de Tom poursuivent avec ces marchandises est subjectivement perçu comme plus précieux que le commerce qu’ils engagent par ce biais. Voila qui semblerait violer les dictons néoclassiques concernant l’inutilité du travail. Tom les persuade autrement. Il les persuade qu’ils tireront plus de joie et de gratification d’un travail bien fait que d’une compensation monétaire face à l’absence total d’intérêt que représente cette tâche.
Les enfants font l’expérience de cette absence d’intérêt, de la désutilité6, de ce travail sans salaire, mais cette absence est compensée par le prestige associé à ce travail, un prestige clairement subjectif. Et si nous lisons, dans Tom Sawyer, que ces enfants s’épuisent tous dans ce labeur pénible, il s’en trouve toujours un qui souhaite prendre sa place.
Twain écrit alors7 :
« Tom se dit qu’après tout l’existence n’était pas si mauvaise. Il avait découvert à son insu l’une des grandes lois qui font agir les hommes, à savoir qu’il suffit de leur faire croire qu’une chose est difficile à obtenir pour allumer leur convoitise. Si Tom avait été un philosophe aussi grand et aussi profond que l’auteur de ce livre, il aurait compris une fois pour toutes que travailler c’est faire tout ce qui nous est imposé, et s’amuser exactement l’inverse. Que vous fabriquiez des fleurs artificielles ou que vous soyez attaché à une chaîne, on dira que vous travaillez. Mais jouez aux quilles ou escaladez le mont Blanc, on dira que vous vous amusez. »
Ce concept de « jouer » comme bien de consommation trouve son écho chez Rothbard8 :
« Les activités qui sont entreprises purement pour elles-mêmes ne constituent pas un travail mais un pur jeu, et sont à ce titre des biens de consommation. Le jeu, en tant que bien de consommation, est soumis à la loi de l’utilité marginale comme tous les autres biens et le temps passé à jouer sera mis en balance face à l’utilité pouvant découler d’autres biens qu’il sera possible de se procurer. »
Voici un exemple de la façon dont l’économie de Tom Sawyer est imprégnée du sentiment que ce qui est subjectif reste le facteur déterminant dans le choix d’échanger et de travailler ou de jouer. Ce subjectivisme est au cœur de la théorie économique qui anime le récit. Mais la théorie économique de Mark Twain ne supplante pas son libéralisme littéraire. Parce qu’il est un homme libre et n’aura d’autre souci que de libérer les autres. Libre donc, comme pour nous indiquer aussi ou nous donner des pistes pour nous rappeler qu’aucune politique, quand bien même libérale, ne nous offrira de liberté, que toute liberté est celle que chacun se donnera à soi et de la façon la plus intelligente.
- Comme exemple extrême, évoquons le terme « Dieu », grand vide-ordure sémantique. ↩
- Ludwig von Mises, La Mentalité anticapitaliste (The Anti-Capitalistic Mentality) (1956). ↩
- Jeffrey A. Tucker, “Mark Twain’s Radical Liberalism”, Ludwig von Mises Institute, 2010. ↩
- Mark Twain, Le Prince et le Pauvre, Chap. XXX, Tom au faîte des grandeurs. Traduit de l’anglais par Paul Largilière. ↩
- Ibid., chap. XXXI. ↩
- « Un homme dépensera par conséquent son travail tant que l’utilité marginale du rendement dépassera la désutilité marginale de l’effort de travail. Un homme arrêtera de travailler quand la désutilité marginale du travail sera plus grande que l’utilité marginale des biens plus nombreux obtenus par l’effort », Murray Rothbard, L’Homme, l’économe et l’État, Institut Charles Coquelin, Paris, Traduction Hervé de Quengo, p.39. ↩
- Mark Twain, Tom Sawyer, Chap. VI. ↩
- Murray Rothbard, id., p.38. ↩

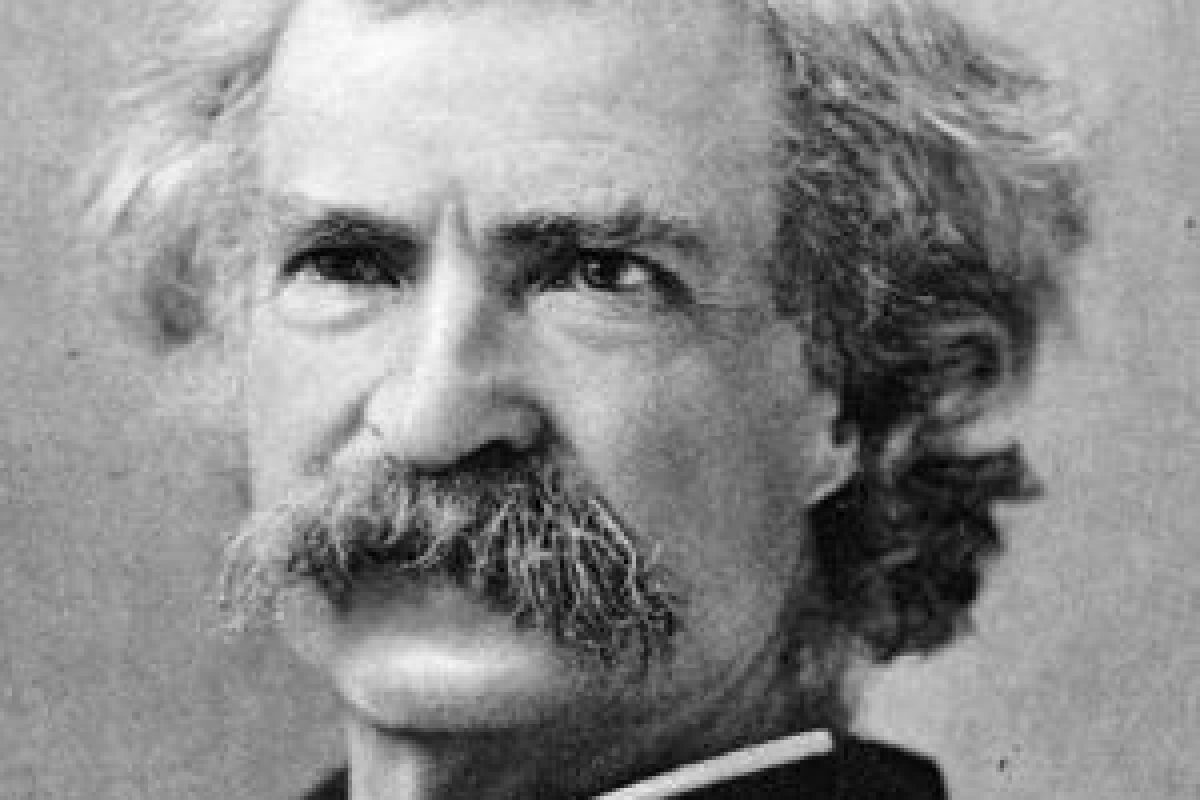

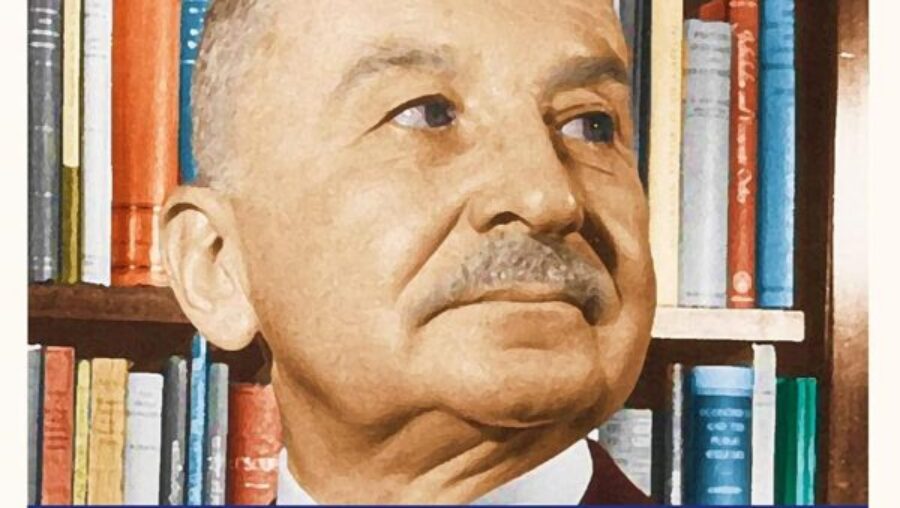


Interresant. Je suis toujours surprise par l’incapacité des français et dans une moindre mesure des pays comme l’Espagne ou l’Italie a analyser de façon pragmatique les modèles économiques et par suite les possible réformes à entreprendre. Malheureusement je crains que cela viennent de notre lourd héritage catholique. Si permettre à tous le monde d’accéder à des moyens de production est légitime, partager le fruit de cette production est beaucoup moins légitime. Comme vous le dites justement dans votre article il n’existe qu”une légitime et surtout “subjective” recherche de la liberté. Normer cette liberté comme le fond les systèmes sociaux contemporains et économiques européens est en soit une contradiction. Le seul moyen de rendre cette liberté à l’homme est de lui donner les moyens de la chercher , de la construire et non de lui donner un cadre matériel considéré par nos dirigeants formatés par une idéologie paternaliste issue des années post guerre comme étant l’aboutissement de cette recherche. Nous sommes tous différents, nos besoins sont différents: cette pensée n’est qu”une escroquerie favorisant les personnes “in” et broyant les personnes “out”. C’est un échec patant !!!
Pays latins.