À première vue (nous y reviendrons) Histoire de l’humanisme en Occident est un passionnant ouvrage d’Abdennour Bidar, philosophe qui s’érige contre le caractère « un peu démodé » de l’humanisme aujourd’hui, à une époque où pourtant « les frontières entre communautés, religions, civilisations se reforment de façon menaçante, et où les sociétés semblent souffrir de tant de divisions internes ».
Le terrible XXe siècle et ses régimes fascistes et totalitaires est, il est vrai, passé par là, hanté par ses rêves de fabrication d’un « homme meilleur » et d’une « humanité supérieure ». Avec les horreurs que l’on sait.
L’ambition de l’auteur est donc de tenter de réhabiliter l’humanisme et une certaine vision de la fraternité, basée sur la connaissance et la transmission d’une culture, celle de l’intériorité. Non un savoir purement théorique, mais une « philosophie de vie » fondée sur une éthique personnelle, fondée sur la réflexion intérieure et le refus de la résignation, dans une époque devenue éminemment relativiste et dont d’aucuns « déplorent la misère morale, intellectuelle et spirituelle ».
Démarche qui s’inscrit comme contre-pli à l’anti-humanisme, à la fois dans sa dimension barbare et celle du scepticisme, dont Hobbes pourrait être l’un des représentants.
Réapprendre à admirer l’Homme
L’anti-humanisme de la modernité traite, quant à lui, de l’Homme à partir de théories déterministes (sociologie, histoire, psychanalyse), amoindrissant le rôle des choix personnels, de la conscience et de la singularité qui caractérisent l’être humain, en une période (XXe siècle) où totalitarismes, guerres mondiales et génocides ont conduit au nihilisme et à douter de la nature humaine.
C’est pourquoi l’auteur en appelle à « réapprendre à admirer l’homme » et « ne pas laisser le pouvoir aux cyniques », plutôt que de continuer à démolir l’humanisme ou éprouver de la pitié à son égard, quand il ne s’agit pas simplement de le tourner en dérision avec une certaine dose de cynisme et de misanthropie.
Sur un plan culturel, à rebours de tous ces artistes pessimistes qui renforcent la démoralisation collective, il souhaite donc que l’on se tourne davantage vers des œuvres qui expriment « la grandeur, la beauté, l’énergie, la noblesse, la générosité, la solidarité, la fraternité, dont les êtres humains sont capables ».
Ce qui ne signifie pas non plus tomber dans l’idéalisme béat.
Abdennour Bidar se réfère ainsi à des auteurs comme Dostoïevsky ou John Steinbeck, qui montrent l’ambivalence de la nature humaine, exprimant une espérance et une foi en l’être humain, au-delà de la noirceur qui peut être la sienne.
Selon l’auteur, il s’agit en définitive de répondre à la question « Qu’est-ce que l’homme ? » qui, seule, peut permettre ensuite à chacun de mieux réfléchir à qui il est. C’est en ce sens que la connaissance des humanismes historiques de l’Occident se révèle utile.
Et c’est la finalité de cet ouvrage. S’appuyer sur l’héritage collectif qui est le nôtre, « non pas pour devenir plus savant mais aider à devenir soi-même ».
Le foyer de l’humanisme monothéiste
L’auteur commence par s’intéresser à ce que l’idée de Dieu a pu jouer dans l’humanisme monothéiste.
À travers l’évocation du livre de Job, Abdennour Bidar souligne ainsi la filiation très ancienne des Lumières dans la Bible, avec l’idée que « l’homme n’a qu’à consulter sa propre conscience pour savoir ce qui est juste ou injuste ».
Mais c’est surtout la notion d’héritage qui est ici importante :
« Une idée, une époque, si nouvelles soient-elles, ne surgissent jamais du néant… d’une forme disparue mais pas morte ».
L’auteur en vient ensuite à s’inquiéter de la réduction de l’Homme à sa matérialité.
« Dans la société de masse, l’homme passe du statut de sujet à celui d’objet parce qu’il est privé de la direction réelle de sa propre vie […] Il voit ses propres buts sacrifiés au profit des buts généraux de la société elle-même, ou des individus les plus puissants de cette société. De façon ouverte dans les totalitarismes soviétique ou fasciste et sous les régimes autoritaires, de façon plus dissimulée dans les démocraties, l’individu a le sentiment que […] se réduisent sa part de liberté soit à rien, soit à des désirs télécommandés ».
Le foyer de l’humanisme antique selon Abdennour Bidar
Après l’humanisme monothéiste et la recherche de la proximité mystérieuse entre Dieu et l’Homme, Abdennour Bidar s’intéresse à l’humanisme antique et sa quête de l’immortalité, avec la pensée de Platon, au-delà des dangers totalitaires que présente son versant utopiste, mais aussi celles de Socrate ou d’Aristote, entre autres, puis de la pensée romaine, des épicuriens et stoïciens, « jusqu’au seuil du christianisme », qui convergent dans l’idée d’un humanisme qui « commande à l’être humain de devenir ce qu’il est, de redevenir ce qu’il fut (réminiscence) ou ce qu’il est en profondeur et en réalité ».
Ce qui s’inscrit, nous dit l’auteur, dans la continuité de l’humanisme monothéiste, l’Homme ne naissant pas accompli, mais cherchant en permanence, par introspection (le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, mais aussi, ajoute l’auteur, le moins connu « occupe-toi de toi-même », qui signifie « travaille à devenir celui que tu es en profondeur », les deux étant interdépendants et constituant une sorte d’éloge de la singularité), à se rapprocher de la vérité, du bien, du juste.
C’est à travers la tragédie grecque que le sujet émerge et se trouve pleinement confronté à la condition humaine. Une transition s’amorce alors vers une justice plus humaine, se détachant peu à peu de l’ordre divin.
On assiste à la naissance d’un humanisme politique par le biais de l’apparition d’une première forme de démocratie (Ve siècle av. J.-C). Car « elle respecte, elle assure l’entière et nécessaire liberté de toutes les consciences, de toutes les croyances, de tous les cultes, mais elle ne fait d’aucun dogme la règle et le fondement de la vie sociale. » En effet, « la vie dans la société démocratique est en ce sens une éducation à l’humanité, parce qu’elle seule développe en chacun son potentiel proprement humain de conscience, de raison, de parole libre et responsable. »
La société, nous dit Abdennour Bidar, est ainsi la matrice de notre humanité, cette dernière s’acquérant davantage par la culture que par la nature.
Cela ne va pas de soi, dans la mesure où :
« Toute société humaine n’est pas humaniste. Pour qu’elle le devienne, elle doit être organisée de telle façon que les hommes puissent y devenir plus humains, et pas seulement manger à leur faim, subvenir à leurs besoins de base, ou vivre en sécurité face à la violence ou aux agressions extérieures. »
La suite se gâte hélas, à mon sens, l’auteur passant d’Aristote à l’idéal de la Vita Activa d’Hannah Arendt, qui ne me paraît pas forcément conforme aux aspirations du plus grand nombre, pour s’appuyer finalement sur une vision de l’économiste André Gorz consistant à vouloir « bâtir la civilisation du temps libéré », selon des principes qui m’apparaissent inspirés de Marx (l’aliénation de l’homme au travail, prolongée ici de celle « au pouvoir politique sans participation » et « à la consommation de plaisirs sans accomplissements ») qui, s’ils peuvent être discutés, aboutissent ici à des prescriptions du type « il faut » ou « il n’y a qu’à », autrement dit à une nouvelle forme d’utopie, basée toujours sur les mêmes types de présupposés ou de vocabulaire (« empêcher l’exploitation des gens par l’industrie du divertissement et des loisirs »), utopies dont l’histoire me semble avoir malheureusement montré les dangers dans leurs diverses tentatives généralement pas très pacifistes.
Abdennour Bidar reconnaît pourtant que l’on peut considérer la vision des Grecs, et à travers eux d’Aristote, comme élitiste, en ne négligeant pas de préciser comment ils en étaient arrivés à se libérer en grande partie des servitudes du corps grâce à l’importance de l’esclavage. Ce qui ne l’empêche pas d’établir un parallèle très marxiste entre esclavage antique et « exploitation » actuelle de l’homme par l’homme au nom des « intérêts économiques qui nous dépassent et de l’asservissement des masses à la consommation passive de divertissements multiples », encourageant ainsi à s’inspirer des Grecs, avec l’idée que « pour que chacun mérite le nom d’humain, il faut qu’il se donne à lui-même, et que la société s’organise pour lui donner les moyens d’une vie véritablement libre. »
Oui, mais comment ? (en s’inspirant du « modèle de l’homme avisé », selon l’auteur) Cela ne ressemble-t-il pas surtout à un vœu pieu ou à un énième appel à la révolution ?
Le foyer de l’humanisme de la Renaissance
On peut regretter également que l’auteur semble presque éluder tout ce qui sépare l’Antiquité de la Renaissance. Ne s’est-il donc rien passé de digne d’intérêt durant toute l’époque intermédiaire ?
Durant la Renaissance, période essentielle de la « redécouverte » des textes de l’Antiquité et des langues grecque et latine, selon l’auteur (et quid de Saint-Thomas d’Aquin, notamment, tout de même cité quelque pages plus loin ?), l’humanité y serait vue comme une qualité acquise, « au fur et à mesure de l’éducation et du travail sur soi ». Une idée majeure qui aurait été perdue de vue dans l’humanisme moderne de type démocratique, malgré tout l’intérêt de la conception de l’égale dignité de tous les hommes qu’elle représente. Or, « la dignité est autant affaire de droit que de devoir envers soi-même », selon l’auteur, et il s’agit de quelque chose qui s’apprend. Les « humanités » d’autrefois jouaient ce rôle, à travers l’étude des textes antiques et classiques. Car il s’agit de « devenir un homme » ou « devenir un meilleur être humain ».
C’est chez Érasme que l’on trouvera l’idée intéressante selon laquelle « On ne naît pas homme, on le devient ».
Pour autant, et même si j’adhère personnellement à « l’idée que l’éducation, la morale, la culture, doivent avoir pour premier objet de nous aider à approfondir notre humanité, à nous humaniser en cultivant et améliorant nos qualités humaines », ce à quoi nos écoles ne nous forment en effet probablement plus suffisamment, doit-on voir, comme l’auteur, une contradiction entre cette conception et celle de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (« tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ») ?
Abdennour Bidar rêve ainsi de rajouter à la Déclaration des droits de l’Homme un devoir ; celui de « travailler à devenir un meilleur être humain ».
Je ne suis pas hostile aux devoirs, bien au contraire. Mais il me semble que l’objet de la Déclaration consistait à défendre l’être humain et ses droits fondamentaux. Rien de plus (et certainement pas les « droits à », au sujet desquels il y aurait en revanche beaucoup à dire). Curieux mélange des sujets, donc (d’autant que l’un se décrète, l’autre non).
Selon l’humanisme de la Renaissance, il s’agit donc de s’élever de notre microcosme corporel vers notre macrocosme (« l’homme parvenu à la connaissance complète de soi »), si l’on s’inspire par exemple de l’humanisme mystique d’un Giordano Bruno.
C’est aussi l’époque des prémisses de la science moderne, où les théories abstraites vont donner accès aux lois cachées de la nature. Là encore, suivent des développements très intéressants de l’auteur, qu’il vient tempérer par des préoccupations actuelles en matière d’écologie très « dans l’air du temps »…
Un anthropocentrisme dont notre auteur déplore toutefois qu’il ait été remplacé depuis deux siècles par une représentation d’un univers totalement désenchanté, alors qu’il constituait selon lui le « pic de l’humanisme occidental », en référence au thème de l’illimitation de l’Homme, qui trouve son expression la plus développée chez Pic de la Mirandole, au XVe siècle, selon lequel (dans une citation extraordinaire mais trop longue pour que je la reprenne, représentant Dieu s’adressant à Adam) l’Homme n’aurait pas vraiment de nature prédéterminée et serait amené à se façonner lui-même.
Aimer et créer seraient ainsi les deux mamelles de la divinisation de l’Homme par lui-même.
On trouve là l’explication de la réticence d’Abdennour Bidar à traiter du Moyen Âge.
S’inscrivant dans les traces de Georg Voigt au XIXe siècle, il semble approuver l’idée que « la Renaissance aurait hypertrophié la figure de l’individu libre, et de la liberté humaine, en réaction à un Moyen-Age où elles étaient étouffées dans les castes sociales médiévales et les lois toutes-puissantes de l’Église catholique en matière de dogme et de mœurs. »
Le holisme du Moyen Âge aurait laissé place, dès Pétrarque au XIVe siècle, à la grandeur de l’individualité. Mais d’une « individualité remarquable », car Abdennour Bidar est moins indulgent avec Montaigne, qu’il assimile au « déclin de l’humanisme de la Renaissance », mettant en scène une « individualité basique », un « je ordinaire » et qu’il range, de fait, en précurseur de l’anti-humanisme de la modernité, ne croyant plus en la possibilité de s’élever au-dessus de soi-même.
Intransigeant avec Montaigne, l’auteur, toujours emporté par son exécration de la « société des loisirs et de la consommation », l’assimile sans réserve à celui qui renonce au projet de quête intérieure pour lui substituer un individu centré sur « l’assouvissement de ses pulsions les plus superficielles, les plus animales, de consommation ». En quelque sorte, à une vision restrictive du type « Éclatez-vous, il n’y a que cela qui compte », correspondant à l’Homme conditionné par ses plaisirs les plus primaires.
C’est pour cette raison qu’il s’inscrit de nouveau en accord avec Érasme lorsque celui-ci, dans le contexte des guerres de religions entre catholicisme et protestantisme, en appelle à la réconciliation et à l’amour de la paix, la guerre n’engendrant que la guerre.
Là où, en revanche, on peut une nouvelle fois désapprouver l’analyse d’Abdennour Bidar, c’est lorsqu’il assimile l’idée que « l’homme est un loup pour l’homme » à celle de sociétés bâties de ce fait sur la concurrence et la compétition, comme résignation de cet état de fait.
Comme on le sait, la célèbre formule vient de Hobbes, qui en tire argument pour fonder sa justification de l’absolutisme autoritaire. Rien à voir, donc, avec la concurrence, bien au contraire. Et si compétition il y a, elle se faisait entre puissance royales, à une époque où on tuait la concurrence pour lui préférer les principes mercantilistes.
On peut donc pleinement approuver Érasme tout en prônant la saine concurrence. Et on sait aussi que le commerce est un facteur de paix. Sa restriction à l’époque mercantiliste coïncidait, à l’inverse, avec les guerres de conquête.
On appréciera aussi la référence à Rabelais, qui défend lui aussi ardemment l’importance de la culture, qui est également culture de l’âme (Cicéron) contre les dangers de l’ignorance, et celle de s’affranchir de tout ce qui veut nous contraindre.
Idées qu’Abdennour Bidar résume ainsi :
« Humanisme et combat pour la liberté sont inséparables. Même si l’objet dont il faut s’affranchir change, la définition du progrès humain demeure : grandir en humanité passe par la libération vis-à-vis de ce qui voudrait nous rendre perpétuellement esclave. »
Le foyer de l’humanisme moderne
Les formes d’humanisme précédentes finissent par déboucher sur les principes que nous connaissons aujourd’hui, à travers les droits de l’Homme, la démocratie et l’esprit critique.
Ce que l’on a appelé Les Lumières va jouer un rôle important en la matière, à travers les écrits de Rousseau, Kant, La Boétie, Diderot ou Voltaire (on pourrait y ajouter, un peu plus tard, Tocqueville), entre autres, qui chacun à sa manière déplore la servitude volontaire dans laquelle les hommes ont tendance à se plonger.
Ce que notre auteur résume ainsi :
« L’humanisme des Lumières est un double procès : celui de l’irresponsabilité de l’être humain vis-à-vis de lui-même lorsqu’il n’ose pas faire d’esprit critique et se laisse dominer par l’autorité ou la vérité d’autrui, celui des puissances de l’époque, État et Église, qui exploitent cette irresponsabilité naturelle ou primitive par l’asservissement des corps et des consciences. »
Dès lors, c’est un humanisme de la liberté qui se développe.
Cependant, comme le souligne à juste titre l’auteur, il ne suffit pas de vivre dans une démocratie pour être réellement libre. En revanche, une nouvelle fois, l’exemple qu’il choisit pour l’illustrer me semble à la fois quelque peu anecdotique et surtout obsessionnelle, s’en prenant à la « multitude de publicités idéologiques ou commerciales qui nous conditionnent à faire tel ou tel choix, à développer tel ou tel désir… en nous inculquant la conviction ferme que ce sont bien les nôtres ! »
Au déisme et au rôle de la conscience chez les philosophes des Lumières, Abdennour Bidar oppose ensuite ce qu’il appelle la trahison de ces idées par la modernité ultérieure, en mettant notamment en avant la pensée de Nietzsche, qui constituerait une inversion du sens de l’humanisme.
La théorie des droits naturels est, également, brièvement abordée, mais notre auteur s’intéresse surtout ensuite à la Déclaration d’indépendance des États-Unis et à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui sacralisent véritablement les droits de la personne humaine. Tout en rappelant qu’il a fallu du temps pour que ces principes soient pleinement appliqués dans les faits, l’abolition de l’esclavage ne datant, en France, que de 1848, par exemple. Avec un bel hommage, au passage, à l’avant-gardisme de Condorcet en la matière et, avec raison, le rappel opportun de toutes les situations encore existantes où la vie humaine se trouve bafouée (trafic d’organes, entre autres).
On en arrive ensuite à un passage sur Karl Marx et la lutte des classes, présenté comme « un moment majeur de l’humanisme moderne », qui confirme ainsi les impressions que j’avais pu avoir auparavant au cours de la lecture concernant l’auteur du livre, dressant au passage un véritable réquisitoire en règle contre le capitalisme (et dont je me garderai de relever les citations ou même tout autre contenu, ayant beaucoup de mal à admettre la figuration de l’auteur de La dictature du prolétariat parmi les grands humanistes de notre histoire).
Un peu dans le même ton, malheureusement car il y aussi beaucoup de choses justes dans le raisonnement, l’auteur dresse une sorte de panorama des combats du XXe siècle pour l’égalité, avec moult références à « l’horreur économique », la « fabrique de la pauvreté » et autres mouvements d’indignés.
Beaucoup de références, que je ne reprendrai pas ici, certes utiles dans une certaine mesure (il s’agit d’une histoire), mais ce n’est pas, à mon avis, le meilleur passage du livre.
Les enjeux de l’humanisme contemporain
L’ouvrage s’achève sur une véritable apologie de « l’humanisme socialiste », pour poser, entre autres, la question « le libéralisme est-il un humanisme ? » et chanter son couplet sur « la dégénérescence du capitalisme ».
Une fin d’ouvrage totalement partisane dont je vous passe le contenu et qui vient totalement gâcher un livre et un auteur qui s’annonçaient pourtant si passionnants et prometteurs dans un premier temps.
- Abdennour Bidar, Histoire de l’humanisme en occident, Armand Colin, août 2014, 288 pages.

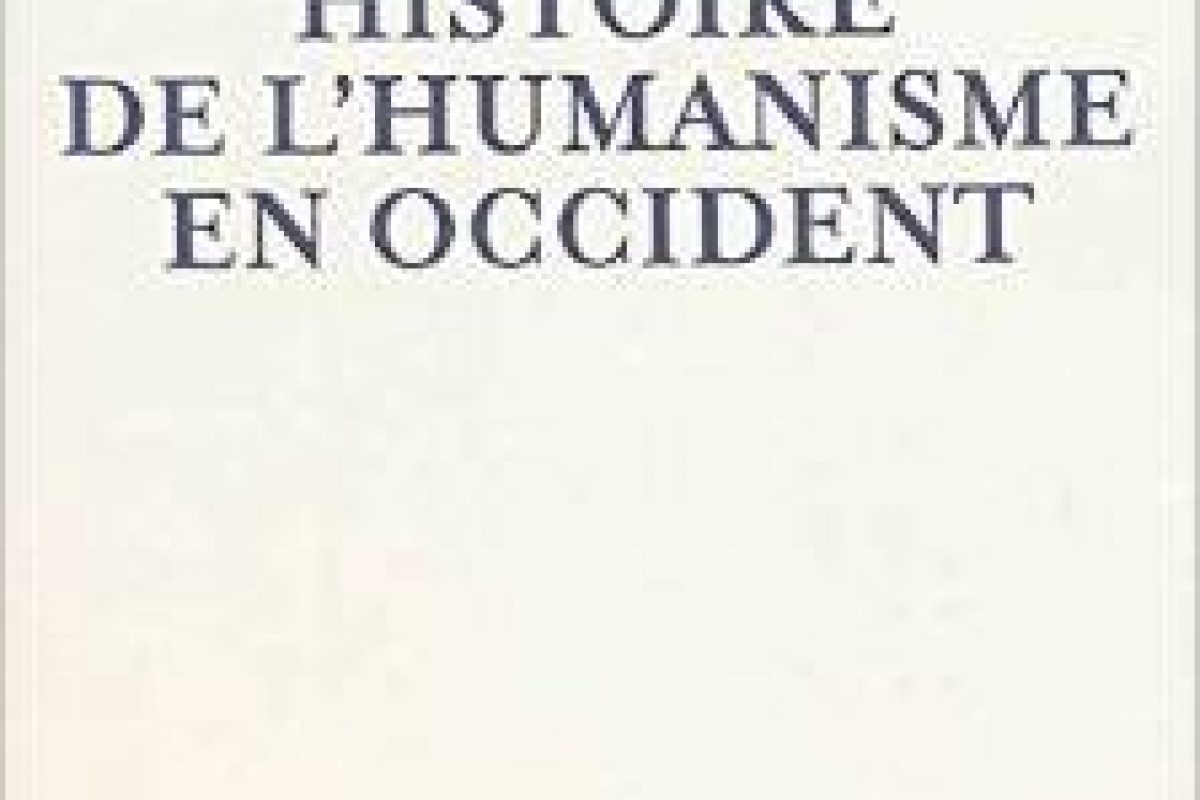



L’humanisme (le bonheur, l’amour, la liberté …) suit le principe d’incertitude d’Heisenberg : au plus on s’en approche pour l’observer, au plus on y voit flou…
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus_est
L’homme est un loup pour l’homme n’est PAS de Hobbes.
Je viens de lire l’article. Intéressant.
Merci pour cette précision !