Par Fabrice Copeau.
« Plus vous étendez la sphère du pouvoir, plus il se trouve de gens qui y aspirent. La vie va où est la vie. » — Odilon Barrot
On ne s’aperçoit pas qu’aucune révolution n’aboutit pas à l’appesantissement du pouvoir. Hélas, dit-on, la Révolution est sortie de son lit naturel. Pitoyable incompréhension ! C’est le terme fatal auquel tout le bouleversement s’acheminait de façon nécessaire.
Les Cromwell ou les Staline ne sont pas conséquences fortuites, mais bien le terme fatal des révolutions. Les débuts des révolutions offrent un charme inexplicable : l’événement va tout réparer, tout exaucer et tout accomplir.
La Révolution française affranchit les paysans mais les force à porter un fusil, elle supprime les lettres de cachet mais élève la guillotine. Par la révolution de 1917, un pouvoir bien plus étendu que celui du tsar permet de regagner et au-delà le terrain que l’Empire avait perdu. On ne peut citer aucune révolution qui ait renversé un despote véritable (Charles 1er et non Henri VIII, Louis XVI et non Louis XIV, Nicolas II et non Pierre le Grand). Ils sont morts, non de leur tyrannie mais de leur faiblesse.
La révolution établit une tyrannie d’autant plus complète que la liquidation aristocratique a été plus poussée. Les populations ne voulaient plus d’intendants royaux mais s’administrer elles-mêmes sur le plan local, mais la Constituante détruit les unités historiques qui avaient la capacité et la volonté de gouverner. La Révolution a écrasé les droits qu’elle prétendait exalter.
Dès janvier 1790, tout acte des tribunaux tendant à contrarier le mouvement de l’administration est déclaré inconstitutionnel. Ce sont des élections renouvelées pour choisir les juges, mais le peuple ne choisit jamais assez au gré du pouvoir, et ses choix sont épurés a posteriori. En l’an VIII, le pouvoir s’attribue la nomination des juges. Lénine déclare l’État foncièrement mauvais, et il édifie un formidable appareil de contrainte en Russie.
1789 restaurateur de la monarchie absolue
Les révolutions ne sont pas des réactions de l’esprit de liberté : on n’en peut citer aucune qui ait renversé un despote véritable. Louis XVI n’a même pas su laisser tirer ses Suisses ; Nicolas II n’osa même pas venger son cher Raspoutine ; Charles Ier vivotait sans menacer personne. En 1788, la monarchie est tellement en recul qu’elle devait sacrifier au cri général ses intendants de province, exécutants de la volonté centrale, qui cédaient la place aux assemblées provinciales : c’était le mouvement inverse de toute notre histoire.
L’œuvre révolutionnaire, c’est la restauration de la monarchie absolue. La constituante sacrifie d’entrée les intérêts de ces mêmes privilégiés qui avaient réclamé la convocation des États. Les biens immenses du clergé sont aussi rapidement livrés au pouvoir, et les Parlements reçoivent un congé décisif. Le roi ne devient plus qu’un simple fonctionnaire de la volonté générale : alors pourquoi inamovible ? Les circonstances aidant, on le supprime, et le pouvoir exécutif se réunit au législatif dans les mains de la Convention.
La Constituante reconstruit la justice sur des bases nouvelles, de façon qu’elle soit « toute-puissante pour secourir tous les droits et tous les individus ». Elle sera parfaitement indépendante du pouvoir. Mais ce dernier très vite prétend que les juges s’inspirent non pas des lois dignes de ce nom que la Constituante a d’abord formulé, mais de mesures de circonstances, dirigées contre telles ou telles catégories de citoyens, et décorées du nom de lois. Il leur reproche trop de mollesse. Il fallait des tribunaux extraordinaires dont le modèle fut le Tribunal révolutionnaire de Paris. Puis en l’an VIII, le pouvoir s’attribue la nomination des juges et leur avancement. Ainsi la Révolution a enlevé à la justice la fonction qu’elle exerçait auparavant, de défendre l’individu contre les entreprises du pouvoir. Cette œuvre fut celle non de la Terreur, mais de la Constituante. Et ces principes sont restés en vigueur.
Les initiateurs de la doctrine démocratique ont pris la liberté de l’homme comme base philosophique. Ils se sont proposés de la retrouver comme résultat politique de leur effort. L’homme entrant en association a par là même accepté certaines règles de conduite nécessaires au maintien de l’association. Mais il n’est obligé d’obéir qu’à elles, n’a de maître et de souverain terrestre que la loi.
« Un peuple libre, dit Rousseau, obéit aux lois mais il n’obéit qu’aux lois et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes ».
Ces postulats justifient immédiatement l’abaissement, la subordination du pouvoir. Il n’a d’autre raison d’être et d’autre droit que d’exécuter la loi. La question capitale est de décider d’où viendra la loi. En Angleterre, les assemblées étaient des congrès de privilégiés. En face du pouvoir demandeur, les représentants disposaient de mandats impératifs. Mais lorsque la préférence donnée à l’Assemblée sur le souverain l’a fait investir, elle seule, de la puissance législative, comme seul représentant de la nation, on n’a point vu qu’on changeait par là son caractère, et que son attitude devait changer.
Au lieu d’être juxtaposition d’intérêts divers, elle devenait représentation totale de la totalité nationale. Le parlement ne trouvait plus, lui, de représentants de la diversité, de mandataires des intérêts particuliers, dont il eût à tenir compte ! Ce n’est pas le roi qui a disparu : le pouvoir législateur représentant de l’intérêt national est son successeur ; mais ce qui a disparu, c’est la représentation des intérêts qui sont dans la nation. L’aristocratie parlementaire constitue alors « Le Prince », un prince plus puissant que n’était un roi non maître des lois. Ou bien ce prince réussit à s’affranchir de ses mandants ; il est alors absolu. Ou bien, au contraire, les membres de l’assemblée deviennent les instruments de partis, ou les jouets de mouvements extérieurs à l’Assemblée. La bataille s’instaure, dont l’enjeu n’est plus seulement le pouvoir, mais les lois elles-mêmes, qui ne seront plus le reflet de vérités supérieures, mais varieront au gré des fluctuations du combat.
Si l’on institue un corps législateur, il se subordonnera et s’intégrera la puissance législative. Rousseau l’a bien vu, car son système tendait à restreindre le nombre de lois, l’étendue des obligations imposées aux sujets, et des pouvoirs conférés aux magistrats. Il ne lui est pas venu à l’esprit que le peuple pût faire des lois, mais il a voulu lui donner le moyen d’en repousser qui parussent injustifiées. Et c’est en effet un rôle négatif et éliminateur que joue en pratique le référendum, traduction libre du principe rousseauiste.
Rousseau n’a jamais prétendu que le peuple fût qualifié pour choisir la législation « en progrès » d’une société « en progrès » : il ne croyait pas, on le sait, au progrès. Ce qu’il attendait de la législation populaire, dans les petits États, qui seuls l’intéressaient, c’était qu’elle entravât la prolifération des lois et l’habilitation indéfinie du pouvoir. Quel sujet d’étonnement et quelle leçon d’histoire sociale que le retournement prodigieux de la doctrine de Rousseau ! Non plus qu’une loi n’est loi, comme l’avait entendu Rousseau, que par le consentement du peuple, mais tout ce que veut le peuple, ou tout ce qu’on représente comme voulu par lui, est loi.
On est revenu, en changeant simplement l’attribut, à l’adage qui révoltait les philosophes : « Ce qui plaît au prince, cela aura vigueur de loi ».
Comme le répète Clemenceau :
« … si nous attendions de ces majorités d’un jour l’exercice de la puissance qui fut celle de nos anciens rois, nous n’aurions fait que changer de tyrannie. »
Ce qu’on a rêvé, c’est que la garantie de la liberté résidait dans la souveraineté de la règle de droit, de la loi. On a réclamé de plus en plus bruyamment la mise en œuvre de la souveraineté populaire et son absolutisme. On n’a pas compris que c’était renoncer à la difficile souveraineté des lois et quitter les garanties de la liberté ; qu’enfin on reconstituait un Imperium césarien qui devait dès lors trouver ses Césars.
Pouvoir au peuple ?
Il n’y a point d’institutions qui permettent de faire concourir chaque personne à l’exercice du pouvoir, car celui-ci est commandement, et tous ne peuvent commander. La souveraineté du peuple n’est donc qu’une fiction qui ne peut être à la longue que destructrice des libertés individuelles.
Le pouvoir démocratique se présente comme venant libérer l’homme des contraintes que faisaient peser sur lui l’ancien pouvoir. Cette hostilité à la formation de communautés plus petites ne se concilie pas avec la prétention d’instaurer le gouvernement du peuple par lui-même, puisque manifestement ce gouvernement est d’autant plus une réalité qu’il s’exerce dans des communautés plus petites.
Tandis qu’il proclame la souveraineté du peuple, le pouvoir démocratique la resserre exclusivement au choix de délégués qui en auront l’exercice plénier. Ainsi le prétendu « pouvoir du peuple » n’est relié au peuple que par le cordon ombilical très lâche des élections générales ; il n’est effectivement qu’un « pouvoir sur le peuple ». On a vu les corps représentatifs se développer en dépit de toutes les interdictions et de toutes les poursuites. Cette formation spontanée est un phénomène naturel qui corrige la fausse conception totalitaire de l’intérêt général. Or, faute d’avoir ménagé aux intérêts particuliers des moyens de défense, on les condamne à une activité offensive, qui les mène à l’oppression d’autres intérêts. Et ceux-ci se trouvent excités à stopper, pousser ou conquérir le Pouvoir par des procédés semblables. L’autorité n’est plus alors qu’un enjeu, elle perd toute stabilité, toute considération.
Tant que le peuple assemblé par circonscriptions regarde au mérite personnel et non à l’opinion affichée, l’assemblée est constituée par une élite de personnalités indépendantes. On a donc une Assemblée vivante où les opinions toujours libres s’affrontent pour le bien de la patrie et l’instruction du public. Mais dès que l’Assemblée représentative dispose du pouvoir, comme il arrive en démocratie, l’appétit de commandement porte les membres à s’ordonner en fractions permanentes. Le groupe fait triompher des candidats qu’il a choisis moins en raison de leur valeur propre que de l’obéissance qu’ils promettent. Il faut alors arracher par n’importe quel moyen la voix dont l’électeur dispose. Se formeront alors des syndicats d’intérêts et d’ambitions, qui s’ingénieront à capter les suffrages pour investir des députés dociles.
Les initiateurs de la démocratie entendaient que la campagne électorale fût une saison d’éducation populaire par l’exposition complète des thèses opposées. Mais les modernes, en gens avisés, ont compris que former l’esprit des électeurs c’est aussi bien l’ouvrir aux arguments adverses qu’aux leurs propres et donc peine inutile. C’est sur les émotions qu’il faut agir. Loin d’éveiller la capacité citoyenne chez ceux qui ne la possèdent pas encore, on l’éteint chez ceux qui l’ont acquise. On fait vibrer la corde du loyalisme, tant on a transformé les électeurs en soldats, en « militants ». C’est que leurs meneurs sont les conquérants du pouvoir.
Plus la « machine » est puissante, plus les votes sont disciplinés, et moins la discussion a d’importance : elle n’affecte plus le scrutin. La puissance effective quitte d’ailleurs l’assemblée à mesure que les partis gagnent en consistance et en discipline. Les consultations électorales prenant le caractère de luttes entre « machines », celle qui l’emporte peut mettre son chef au gouvernement et il n’aura presque point à tenir compte de l’assemblée où les whips lui assureront une majorité stable.
Ces compétitions aboutissent à la dictature d’un parti, c’est-à-dire d’une équipe, et d’un homme, son chef. Voilà le totalitarisme.
Ils disposent de ressources immenses accumulées dans l’arsenal du pouvoir. Il n’existe dans la société aucune contre-force capable d’arrêter le pouvoir. On a tout d’abord pensé la liberté comme fin. Dans ce but, on a proclamé la souveraineté des lois. Ces lois, on les mettait au-dessus de l’homme. Il n’aurait point à trembler devant un particulier plus puissant, devant un groupe menaçant par son nombre, car entre ce puissant et lui, c’est la justice impassible qui trancherait, selon les lois établies. Il n’aurait rien non plus à redouter des gouvernants, serviteurs des lois. Il fallait que l’on crût au caractère de nécessité des lois, qu’on les regardât comme inscrites dans la nature des choses, et non pas comme un produit de la volonté humaine. Or précisément, on se mettait à considérer les lois comme des règlements toujours susceptibles de critique et de révision. En fait, les règles suprêmes de la vie sociale sont devenues l’objet de querelles politiques. Dès lors les volontés particulières se trouvaient déchaînées, puisque capables de faire ou défaire les lois.
La loi est devenue l’expression des passions du moment. Comme on ne peut plus conquérir la puissance législative, à laquelle l’exécutive est réunie, que par le moyen d’une faction bien organisée, les factions vont gagnant en cohésion et en violence. L’incertitude en tout cas devient telle, les conditions nécessaires de la vie sociale sont à ce point ruinées, que les peuple enfin, las de l’impuissance d’un Imperium toujours plus disputé, aspirent à stabiliser ce poids écrasant du Pouvoir qui roule au hasard de main en main, et finissent par trouver un honteux soulagement dans la paix du despotisme.
Les limites du pouvoir
 À la faveur du déchirement de l’Église, le monarque temporel a prétendu communiquer directement avec le suzerain céleste, et il a justifié ainsi l’assomption d’une certaine puissance législatrice.
À la faveur du déchirement de l’Église, le monarque temporel a prétendu communiquer directement avec le suzerain céleste, et il a justifié ainsi l’assomption d’une certaine puissance législatrice.
Ainsi le pouvoir qui avait été auprès des autres pouvoirs et dans le droit, tendait à faire entrer en lui les pouvoirs sociaux et le droit même. Toutes autres étaient les républiques de l’Antiquité, Rome particulièrement. Les différentes magistratures étant indépendantes, le pouvoir, l’imperium n’était concentré nulle part, sinon, quand les circonstances l’exigeaient, chez le dictateur temporaire. Et chaque autorité avait son pouvoir propre, potestas. De sorte que ces pouvoirs pouvaient entrer en conflit et l’un d’eux arrêter l’autre. Même à l’intérieur d’une même autorité la pluralité de ses détenteurs permettait à l’un d’eux de paralyser son collègue ou ses collègues. Qu’est-ce qu’un contre-pouvoir ? Évidemment une puissance sociale, un intérêt fractionnaire constitué. Leur self-defense, pour égoïste qu’en puisse être le principe, contribue à la création d’un équilibre social.
Ces corps, Montesquieu les trouvait partout dans la société de son temps : noblesse, clergé, assemblées d’États de provinces, corporations. Le séisme fut politique bien sûr, mais aussi intellectuel (Rousseau, Mably) : contre la souveraineté du roi fut affirmée et triompha la souveraineté du peuple. Le problème de la limitation du pouvoir, pense-t-on, ne se trouvait posé que par la solution vicieuse autrefois donnée au problème de la formation du pouvoir.
Si le gouvernement émane d’une source pure, ce n’est plus sa faiblesse mais sa force qui fait la liberté, ce n’est plus son étendue, mais toute borne qu’on voudrait apporter à son action, qui serait antisociale ! Royer-Collard le dit fort bien :
« La Révolution n’a laissé debout que les individus. […] La centralisation a pénétré modestement, comme une conséquence, une nécessité. En effet, là où il n’y a que des individus, toutes les affaires qui ne sont pas les leurs sont des affaires publiques, les affaires de l’État ».
Sans doute l’intention primitive des constituants avait été restrictive : ils entendaient qu’aucun acte de gouvernement ne pût être fait qu’en vertu d’une loi, et qu’aucune loi ne pût être faite qu’en vertu d’un consensus populi. Mais leur système devait logiquement aboutir à rendre possible n’importe quel acte de gouvernement pourvu qu’une loi l’autorisât et à rendre possible n’importe quelle loi pourvu que le Parlement la votât. Aucun despote ne peut se permettre d’aller aussi loin que ceux qui se réclament de la souveraineté populaire.
Citons Constant :
« La tyrannie n’aura besoin que de proclamer la toute-puissance de ce peuple en le menaçant, et de parler en son nom en lui imposant silence » (Cours de politique constitutionnelle, ed. 1872).
En Angleterre, l’omnipotence s’était élevée en détruisant au nom de la masse qu’elle prétendait représenter les groupes animés d’une vie réelle. Mais les deux chambres sont l’organe des puissances sociales de fait. De là leur force, qu’elles n’empruntaient à aucune constitution. De là aussi leur prudence. Elles équilibrent bien moins le pouvoir qu’elles ne le cernent. Mais à chaque fois qu’elles le veulent, les puissances sociales font agir le pouvoir, comme il se voit déjà en 1749 quand elles forcent Walpole à la guerre. Ainsi la séparation des pouvoirs qu’on observe en Angleterre est à la vérité le résultat d’un processus de refoulement de l’Imperium royal par les puissances sociales.
Triomphe de la souveraineté “populaire”
 Rien de comparable en France où règne la solitude victorieuse de la Centralité. On découpe dans l’imperium des tranches qu’on répartit entre le Roi, la chambre basse, une chambre haute.
Rien de comparable en France où règne la solitude victorieuse de la Centralité. On découpe dans l’imperium des tranches qu’on répartit entre le Roi, la chambre basse, une chambre haute.
Mais chaque tronçon du serpent tend à régénérer le serpent tout entier. Le Roi se tient pour héritier d’un roi qui fut absolu, et l’assemblée d’une assemblée qui fut absolue. Puis en 1848 triomphait la souveraineté populaire. Et l’on vit alors reparaître l’erreur fondamentale de la première révolution, l’illusion qu’un pouvoir formé à partir du bon principe est indéfiniment bénéfique. Opposer, comme l’a fait la Deuxième République, à un président élu par le peuple, une Assemblée élue par le peuple, ce n’est pas organiser un équilibre d’éléments sociaux, mais seulement instaurer une dispute d’hommes investis par la même source.
Si la souveraineté réside dans un roi ou une aristocratie, appartient à un seul ou à quelques-uns, elle ne peut s’étaler exagérément sans choquer les intérêts du grand nombre, et il suffit de fournir à ces intérêts un organe, pour que les forces immenses qui s’expriment par ce moyen distendent peu à peu cet organe. Tandis qu’au contraire un organe de résistance accordé à une minorité contre le pouvoir de la multitude ne peut que s’atrophier progressivement, comme se resserre une tête de pont tenue par une armée très inférieure en nombre. De sorte que le pouvoir n’éveillerait de résistances assez fortes pour le limiter que s’il est de caractère minoritaire. Tandis qu’étant de caractère majoritaire il peut aller jusqu’à l’absolutisme, dont le règne seul relève le mensonge de son principe et que, se disant peuple, il n’est toujours que pouvoir.
Ce que nous appelons de nos vœux est une suprématie par le droit. Un droit aîné et mentor de l’État. Or le doit a perdu son autonomie. Comme le dit le Code justinien : nous avons chacun des droits, subjectifs, qui se situent et se concilient dans un droit objectif, élaboration d’une règle morale s’imposant à tous, que le Pouvoir doit respecter et faire respecter. N’importe l’origine du pouvoir : il se légitime lorsqu’il s’exerce conformément au droit.
De nos jours, rien de semblable : le droit n’est, nous dit-on, que l’ensemble des règles édictées par l’autorité politique. L’autorité faiseuse de lois est donc toujours juste, par définition.
Citons la Métaphysique des mœurs de Kant :
« Il n’y a contre le suprême législateur de l’État aucune résistance légitime de la part du peuple ; car il n’y a d’état juridique possible que grâce à la soumission à la volonté législative pour tous. […] Pour que le peuple fût autorisé à la résistance, il faudrait préalablement une loi publique qui la permit. »
Carré de Malberg ajoute :
« L’essence de la règle de règle de droit est d’être sanctionnée par des moyens de coercition immédiate […] Il ne peut se concevoir, en fait de droit, que du droit positif. »
Or l’Histoire ne nous montre-t-elle pas un droit d’une bien autre dignité, fondé sur la loi divine et la coutume ? Mais encore faut-il distinguer le cas de Hobbes, qui imagine un pouvoir total, et celui de Rousseau et Kant, qui se gardent bien de confier cette puissance législative illimitée à un monarque ou à une Assemblée. Elle ne saurait appartenir pour eux qu’à tout le peuple. Mais ces grands penseurs, dans l’esprit de leurs temps, ne voyaient d’autre réalité que l’homme. Ils proclamaient sa dignité et les droits qu’il possède en tant qu’homme. Ils n’ont pas assez vu que ces droits pouvaient être en conflit avec la puissance législative illimitée. Cela revient à dire que les Déclarations des droits ont joué en fait le rôle d’un droit placé au-dessus de la loi.
Ce n’est pas un hasard si l’on a vu s’avancer le pouvoir à l’époque où la foi catholique a été ébranlée. C’est ainsi qu’on le voit de nouveau s’avancer du fait de l’ébranlement des principes individualistes de 1789.
Mais c’est Léon Duguit, autre grand constitutionnaliste, qui énonce la vraie doctrine du droit :
« L’activité de l’État dans toutes ses manifestations est limités par un droit supérieur à lui […] cette limitation ne s’impose pas seulement à tel ou tel organe, elle s’impose à l’État lui-même. »
Le juriste américain Marshall, en 1803, a su faire accepter aux États-Unis un système formulant expressément les règles suprêmes du droit, et instituant une autorité confrontant les lois au droit et rejetant celles qui l’offensent. Ces droits de la justice ne s’étendent pas seulement aux gestes d’un homme privé à l’égard d’un homme privé, mais aussi aux gestes d’un agent du pouvoir à l’égard de quiconque. Ces garanties, comme en Angleterre, sont moins efficaces par les sanctions qu’elles comportent que par l’état d’esprit qu’elles entretiennent.
Mais progressivement la « législation judiciaire » anglaise n’a plus été épargnée par le flot des lois nouvelles ; la Cour suprême américaine s’est trouvée en butte au sentiment du public et a dû se mettre en veilleuse : c’est un reflet parmi d’autres du sentiment moderne que peut nulle part souffrir que l’opinion de quelques hommes arrête à elle seule ce que réclame l’opinion de toute la société. Mais il ne s’agit ni d’un côté ni de l’autre d’opinions. On a d’une part une émotion momentanée que des méthodes d’agitation permettent de créer facilement ; de l’autre des vérités juridiques dont le respect s’impose absolument. À rebours, ce dont la Cour suprême a souffert, c’est d’avoir défendu contre l’opportunité politique des principes qui avaient été eux aussi d’opportunité politique.
Les racines aristocratiques de la liberté
La liberté est la souveraineté concrète de l’homme sur soi-même. La liberté n’est pas une invention moderne. Nous concevons à peine qu’une société puisse vivre où chacun est juge et maître de ses actions. Le Romain est libre de tout faire mais il doit en supporter toutes les conséquences. Tout peut se faire mais il faut y mettre les formes, formes d’une extrême rigueur.
Le plein droit civil n’a d’abord été le lot que des eupatrides ou patriciens. Puis les familles énergiques de la plèbe accèdent aux magistratures et forment avec le patriciat la nobilitas. La plèbe juridique disparaît mais il y a une plèbe de fait. Les hommes de la masse en viennent à priser moins leur liberté juridique que leur participation à la puissance publique. Le Sénat souffre que les tribuns réunissent la plèbe pour voter des résolutions, plebiscita. Le tribunat accoutume le peuple à l’idée du sauveur. T. Gracchus voulait que tout citoyen redevienne propriétaire, que chaque citoyen ait sa ration de blé à bas prix (bientôt gratuite). Au lieu que se généralise l’indépendance concrète des membres de la société, ils deviennent les clients de la puissance publique.
Il y a un pouvoir, un État dès que le divorce des intérêts individuels est assez profond pour qu’il faille un tuteur permanent compensant la faiblesse du grand nombre. En Angleterre, le système de la liberté est progressivement étendu à tous : la plèbe est appelée aux droits de l’aristocratie ou extension à tous d’une liberté individuelle. En France, le système de l’autorité, la machine construite par la monarchie tombe aux mains du peuple pris en masse ou attribution à tous d’une Souveraineté armée.
Dès que le peuple politique comprend une majorité de personnes qui n’ont rien ou croient ne rien avoir à défendre, le peuple se livre au messianisme du pouvoir. Trois choses importent au césarisme : perte du crédit moral des membres les plus anciennement libres, élévation d’une classe nouvelle de capitalistes séparée par sa richesse du reste des citoyens, réunion de la force politique avec la faiblesse sociale.
L’objet de la démocratie est de transformer le maître suprême de la société, l’État, en son serviteur. La liberté n’est qu’un besoin secondaire par rapport au besoin primaire de sécurité. À tout instant, il existe dans n’importe quelle société des individus qui ne se sentent pas assez protégés (sécuritaires), et d’autres qui ne sentent pas assez libres (libertaires). Le roi s’appuyant sur les classes inférieures, il y a versement progressif dans les hautes couches sociales d’éléments puisés en bas, montés par le canal étatique. La dégénérescence intérieure transforme l’aristocratie. Les privilégiés cherchent à être protégés par l’État. N’ayant plus de force propre, ils sont devenus incapables de limiter le pouvoir : les aspirations libertaires résident alors dans la classe moyenne, alliée du pouvoir s’il faut discipliner une aristocratie désordonnée, alliée de l’aristocratie lorsque l’État veut étouffer la liberté. Tous les individus, toutes les classes tâchent d’appuyer leur existence individuelle à l’État et les nouveaux droits de l’Homme contredisent et abrogent ceux qu’avait proclamés le XVIIIe siècle : la plénitude de la liberté implique la plénitude du risque. Dès qu’on attend de l’État une protection, une sécurité, il lui suffit de justifier ses envahissements par les nécessités de son protectorat. L’aspiration religieuse est naturelle à l’homme, on a vainement chassé la foi de la scène politique : le Pouvoir revêt un caractère de théocratie.
Une puissance bienfaisante veillera sur chaque homme, depuis le berceau jusqu’à la tombe, dirigeant son développement individuel et l’orientant vers l’emploi le plus approprié de son activité. Le jeu des lois positives laisse beaucoup de place à quantité de misères et de malheurs individuels. Les victimes réclament une intervention providentielle qui corrige ces conséquences. Le trouble social n’est pas imaginaire mais le pouvoir procède par décisions arbitraires. L’homme concret agit sous l’empire de sentiments et de croyances. Nous sommes dirigés par des images de comportement : nous n’avons qu’à imiter, qu’à répéter. L’harmonie est menacée quand les images de comportement sont troublées. Le faux dogme de l’égalité, flatteur aux faibles, aboutit en réalité à la licence infinie des puissants. Aucun ordre social ne saurait se maintenir ou se rétablir si les dirigeants des groupes des groupes et les aînés des collèges ne remplissent pas leur mission. Le trouble des images de comportement se répand de haut en bas. La cohérence sociale ne peut alors être rétablie que par le pouvoir, usant des méthodes grossières de la suggestion collective et de la propagande. C’est la solution totalitaire, mal appelé par le mal individualiste. Une métaphysique destructrice n’a voulu voir dans la société que l’État et l’Individu. Elle a méconnu le rôle des autorités morales et de tous ces pouvoirs sociaux intermédiaires qui encadrent et protègent l’homme de l’intervention du pouvoir.




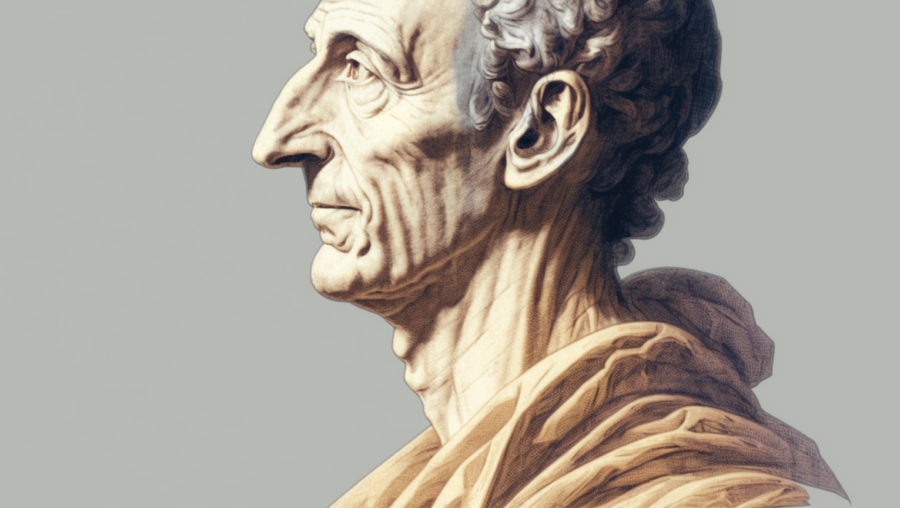
Très bon rappel historique.
Bel article, bravo (quoi qu’un peu long… mais bon, il faut ce qu’il faut… )