Par Fabrice Copeau.
De la souveraineté est un livre de la maturité de Bertrand de Jouvenel, qui gagne à être relu.
Dans un Avertissement plein de modestie, l’auteur de Du Pouvoir, dont le présent ouvrage est la suite directe, indique qu’il lui a coûté beaucoup de peines et craint qu’il n’en coûte aussi au lecteur. C’est exact que Bertrand de Jouvenel s’est engagé dans une exploration d’une extrême difficulté (« exploration » est son propre terme), la plus difficile assurément qui puisse de nos jours tenter — ou ne pas tenter — un spécialiste de science politique. Exploration renouvelée à partir de plusieurs points de départ, et non point, comme Du Pouvoir, « la carte bien clairement tracée d’un pays bien connu ». Exploration, enquête (sur l’autorité souveraine), recherche (du bien politique) : en aucune façon un Traité de souveraineté, tel que Jean Bodin en a laissé voici bientôt quatre siècles le magistral monument : mais, pour reprendre une expression du fameux juriste angevin, l’auteur ici a « pris la mire plus haut ».
Si haut que le lecteur moyen, s’il en est à cet ouvrage d’une extrême intensité intellectuelle — et morale — risque d’être plus d’une fois déconcerté, ne serait-ce que par le vocabulaire souvent original par sa rigueur même. Mais où commence et où finit, en pareille matière qui fourmille de fausses évidences, le lecteur moyen ? Je pense donc que la « clef » livrée par l’auteur dans cette étonnante page 23 pour faciliter précisément l’intelligence de son ouvrage sera précieuse à tout lecteur. Bertrand de Jouvenel s’y avoue essentiellement préoccupé des bienfaits que les hommes se procurent mutuellement par la coopération sociale, cette coopération par laquelle, dit-il ailleurs, « l’homme se fait ». En conséquence tout ce qui maintient et tout ce qui enrichit cette coopération — soulignons : enrichit — le trouve attentif. Mais cet enrichissement lui semble dû à l’incessant jaillissement d’initiatives dispersées, tel que l’esprit le plus fort est impuissant à former « une image prévisionnelle épuisant les possibilités futures» de la coopération ; il faut donc écarter l’idée, désormais si chère à tant d’esprits pour des raisons multiples, que cette coopération doive être successivement édifiée à partir d’ « un seul centre organisateur ». Certes, pour que puissent fructifier tous les germes lancés, certaines conditions de stabilité sont nécessaires, et « un immense complexe d’agents de modification et d’agents de régularité », mais l’autorité publique ou souveraine, comme on l’appelle, n’y est qu’un agent « parmi d’autres », le plus puissant mais qui ne doit pas se prendre pour « le seul ». L’auteur préfère la considérer comme le grand complémentaire. Si bien que l’ouvrage, malgré son titre, est beaucoup moins consacré à l’histoire du concept de souveraineté qu’à développer et justifier, étayer cette conception de l’autorité souveraine, simple servante des rapports sociaux, pour le service de l’homme.
Le déroulement de l’oeuvre
La première partie, intitulée « De l’Autorité », développe expressément la conception originale dont il s’agit. La seconde, intitulée « Du Bien politique », et qui correspond spécialement au sous-titre de l’ouvrage, explore le problème de l’emploi légitime du Pouvoir, ou du Bien commun, ou problème du Quoi par opposition au problème du Qui (c’est-à-dire de la source légitime du Pouvoir, lequel a trop éclipsé le premier dans les recherches de la science politique contemporaine). Le même souci la domine de raisonner sur un « réseau social ouvert », où les rapports sociaux sont étendus et diversifiés. La troisième partie, intitulée « Du Souverain », étudie à la lumière de l’histoire, Moyen âge et Ancien régime, le problème d’une bonne régulation de la volonté dominante (c’est ici le reliquat de l’histoire du concept de souveraineté que l’auteur avait eu, pour commencer, dessein d’écrire, avant de s’apercevoir que son étude risquait de faire double emploi avec certains chapitres de Du Pouvoir). Cette bonne régulation, par le jeu de « butoirs sensibles », d’un souverain dont la puissance a pris de plus en plus de plénitude, dont le pouvoir de décision est devenu de plus en plus compréhensif, fait corps avec le souci du bon contenu, de la bonne consistance de la décision revêtue de la forme impérative, autrement dit de « la bonté dans la volonté souveraine », ou Bien politique. Enfin la quatrième partie, « De la Liberté », qui part de Descartes et de Hobbes, qui passe par Rousseau pour aboutir à de fulgurantes considérations sur la liberté d’opinion et la lumière naturelle, don direct de Dieu, semble apporter à deux siècles de distance une vérification singulièrement étoffée à la fameuse phrase de L’Esprit des lois : « II n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières que celui de liberté ». Et ce Montesquieu qui écrivait quelques lignes plus loin qu’il fallait éviter de confondre le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple eût reconnu sa pensée, enrichie des résonances de deux siècles tumultueux, dans la cinglante conclusion des pages de Bertrand de Jouvenel consacrées à la liberté comme pouvoir : « Tout cela est important, mais c’est l’histoire de l’impérialisme humain, et non pas l’histoire de la liberté. Et quiconque croit voir la liberté essentiellement dans le pouvoir de l’homme est dénué du vrai sentiment de la liberté ».
Rêves polytechniciens
Le hasard a voulu que, pendant l’assez long temps où ce livre — qu’il faut lire et relire, quitter et reprendre pour en laisser reposer et fructifier en soi les semences — est resté sur ma table, je fus amené à étudier d’assez près d’une part les saint-simoniens, d’autre part Tocqueville, soit le jour et la nuit ou la nuit et le jour si l’on préfère (je n’entends pas par cette image banale porter un jugement de valeur ! ) Les saint-simoniens, sur les traces de leur maître extraordinaire, prophète de l’industrialisme, furent sans doute les premiers à organiser contre la thèse de « l’incessant jaillissement d’initiatives dispersées », l’idée futurement chère à tant d’esprits de la coopération sociale successivement édifiée à partir « d’un seul centre » producteur et distributeur. Rêve « polytechnicien » selon une expression de Raymond Aron, rêve technocratique, rêve marxiste aussi et apparemment du même fond saint-simonien. Rêve dont il n’y a pas ici à discuter s’il est réalisable ou non et à quelle échelle, s’il a été ou non réalisé et à quel prix. Ce qui nous intéresse est de mettre en regard ce texte étonnant, trop peu connu, de Tocqueville dans La Démocratie en Amérique : « Les hommes mettent la grandeur de l’idée d’unité dans les moyens, Dieu dans la fin : de là vient que cette idée de grandeur nous mène à mille petitesses. Forcer tous les hommes à marcher de la même marche vers le même objet, voilà une idée humaine. Introduire une variété infinie dans les actes, mais les combiner de manière à ce que tous ces actes conduisent par mille voies diverses vers l’accomplissement d’un grand dessein, voilà une idée divine — l’idée humaine de l’unité est presque toujours stérile, celle de Dieu immensément féconde ».
Sur quoi renchérit le distingué commentateur de l’édition M. -Th. Génin de l’ouvrage, André Gain : « C’est bien par la convergence que se réalisent les grandes œuvres, non par l’identité des volontés contraintes ». Voire : l’affirmation mérite une discussion véritablement scientifique, véritablement de science politique. Mais entre ce texte de Tocqueville et la prédication saint-simonienne, voilà le débat remarquablement situé. Que Bertrand de Jouvenel vienne, à plus de cent ans d’intervalle, relayer ici Tocqueville avec la profondeur d’une pensée sûre d’elle-même et l’éclat d’un talent aujourd’hui consacré qui lui permettent de n’être pas écrasé par la comparaison, c’est ce qui saute aux yeux.
Mais la convergence, la combinaison vers un grand dessein à accomplir d’actes infiniment variés ne peuvent résulter d’un miracle. Idée divine, soit, acceptons-en l’hypothèse. Il reste que pour la réaliser Dieu a besoin des hommes. Bertrand de Jouvenel, creusant la notion d’autorité, propose le thème de l’entraîneur, par lui distingué de l’ajusteur : la source chaude, principe de mouvement, distinguée de la source froide, principe d’ordre, la forme essentiellement excitatrice de l’autorité distinguée de sa forme essentiellement calmante. Est libérale une société qui voit d’un œil favorable se déployer les autorités entraîneuses. Mais il reste que c’est l’autorité mainteneuse, et ajusteuse pour maintenir, qui fait le fond de la société.
Les modes de l’autorité
 L’autorité entraîneuse n’est à la tête de la société que par intermittences, et sous réserve des ajustements nécessaires pour compenser le trouble croissant apporté par les innovations. À plus forte raison quand la société se fait elle-même entraîneuse, se réserve « le monopole de l’entraînement » afin d’assurer une direction centrale de tous les changements jugés bons : cela introduit une incertitude sociale qui doit être compensée, ajustée d’une façon ou d’une autre, pour que soit réalisé ce que l’auteur appelle le Bien politique. Nous voici loin du rêve grandiose et sommaire, du mythe d’ailleurs puissamment stimulant de l’unité « dans les moyens ». L’auteur prône ardemment, en tant que caractérisant une société progressive, un pullulement de « groupes d’action » très divers en grandeur et en nature ; il admet que « le genre humain progresse par des actions combinées qui exigent l’impulsion d’un entraîneur et la discipline » à laquelle, dux, il préside ; mais il refuse de faire de la société une grande famille, « comme le socialisme sentimental », ou une grande équipe, « comme le socialisme positiviste ». Ces groupes d’action multipliés, il sait bien qu’ils multiplient aussi les frictions et les tensions ; mais que, pour éliminer frictions et tensions, et arbitrages correspondants, la société entière soit « réduite en un seul groupe d’action, à la discipline duquel l’individu est soumis complètement et de façon permanente », c’est ce qu’il rejette absolument. Le rôle de Grand Aligneur que les goûts intellectuels actuellement régnants ou peut-être même une tendance constante de l’esprit humain au nom du « rationnel » assignent volontiers au gouvernement — ce rôle lui paraît le comble de l’irrationnel et du défi à la nature des choses. Rationnelle et naturelle, à ses yeux, est la structure sociale non qui répond au goût de l’esprit mais qui est dans le sens du « travail de la Vie, de l’œuvre de l’homme en tant que cause individuelle », au lieu d’être précisément en conflit avec ce travail et cette œuvre. Foin d’un ordre immédiatement perceptible certes à l’esprit le plus grossier mais dont tout « foyer autonome d’autorité » risquerait de déranger l’ordonnance géométrique, si bien qu’il faudrait empêcher de se former de tels foyers — ce qui est proprement faire « violence aux processus naturels ».
L’autorité entraîneuse n’est à la tête de la société que par intermittences, et sous réserve des ajustements nécessaires pour compenser le trouble croissant apporté par les innovations. À plus forte raison quand la société se fait elle-même entraîneuse, se réserve « le monopole de l’entraînement » afin d’assurer une direction centrale de tous les changements jugés bons : cela introduit une incertitude sociale qui doit être compensée, ajustée d’une façon ou d’une autre, pour que soit réalisé ce que l’auteur appelle le Bien politique. Nous voici loin du rêve grandiose et sommaire, du mythe d’ailleurs puissamment stimulant de l’unité « dans les moyens ». L’auteur prône ardemment, en tant que caractérisant une société progressive, un pullulement de « groupes d’action » très divers en grandeur et en nature ; il admet que « le genre humain progresse par des actions combinées qui exigent l’impulsion d’un entraîneur et la discipline » à laquelle, dux, il préside ; mais il refuse de faire de la société une grande famille, « comme le socialisme sentimental », ou une grande équipe, « comme le socialisme positiviste ». Ces groupes d’action multipliés, il sait bien qu’ils multiplient aussi les frictions et les tensions ; mais que, pour éliminer frictions et tensions, et arbitrages correspondants, la société entière soit « réduite en un seul groupe d’action, à la discipline duquel l’individu est soumis complètement et de façon permanente », c’est ce qu’il rejette absolument. Le rôle de Grand Aligneur que les goûts intellectuels actuellement régnants ou peut-être même une tendance constante de l’esprit humain au nom du « rationnel » assignent volontiers au gouvernement — ce rôle lui paraît le comble de l’irrationnel et du défi à la nature des choses. Rationnelle et naturelle, à ses yeux, est la structure sociale non qui répond au goût de l’esprit mais qui est dans le sens du « travail de la Vie, de l’œuvre de l’homme en tant que cause individuelle », au lieu d’être précisément en conflit avec ce travail et cette œuvre. Foin d’un ordre immédiatement perceptible certes à l’esprit le plus grossier mais dont tout « foyer autonome d’autorité » risquerait de déranger l’ordonnance géométrique, si bien qu’il faudrait empêcher de se former de tels foyers — ce qui est proprement faire « violence aux processus naturels ».
Ce refus et ce réquisitoire, le lecteur averti les reconnaît : il les a lus, à l’état brut, non élaborés, intuitions passionnées, chez Burke, ce relais intellectuel formidable entre Montesquieu et Tocqueville. L’auteur de De la Souveraineté suit en plein XXe siècle, en pleine collectivisation de la politique, la route royale trop désertée de ces trois grands Aînés. En même temps il apporte au néo-libéralisme contemporain une contribution d’une exceptionnelle qualité.
Justice, Liberté, ces mots que l’homme adore…
Bertrand de Jouvenel les soumet — ces mots que l’homme adore — à un traitement sévère, strictement scientifique même quand il fait appel à l’idée divine, et exclusif de toute adoration, de tout romantisme social, de toute « mystification » (comme on dit volontiers de nos jours, et à l’occasion pour mystifier… autrement !)
« II est impossible d’établir un ordre social juste … Rien n’est plus absurde que la défense d’un ordre social existant comme juste… le règne de la justice est impossible, conçu comme la coïncidence établie et continuellement maintenue de l’arrangement social avec une vue de l’esprit » : que de telles propositions soient de nature à scandaliser profondément des lecteurs de 1956, l’auteur s’en rend parfaitement compte ! Elles ne procèdent pourtant ni d’un défi ni d’une bravade. La page qui les rassemble (p. 212) ne fait que tirer paisiblement les conclusions de trente pages serrées et difficiles où la notion même de Justice est, pour citer l’auteur, « péniblement élucidée ». Qu’est-ce que faire justice, sinon appliquer dans une répartition l’ordre sériel pertinent ? Cette notion de pertinence, si rarement dégagée dans les discussions plus passionnées que justes (au double sens du mot) que le mot Justice déchaîne de nos jours, est fondamentale, et B. de Jouvenel l’éclairé par des exemples saisissants. Rien de plus difficile que le choix du critère pertinent, car il est lié à tel ou tel impératif de la fin. Et toute question de fins implique de graves divorces de jugements : fins proches ou fins lointaines, fins d’action ou simplement d’existence, etc. Comment répartir des ressources, qui sont des fruits, sans mettre en mouvement une horde de concepts et d’intérêts ? Il y a une « tension immanente à tout processus de répartition », et cette tension est d’autant plus grave que le processus est plus global : ce pourquoi « il convient que le processus général de répartition soit fragmenté en autant de petits processus autonomes qu’il est possible » (reconnaissons ici sous un nouvel éclairage, celui du Juste, la méfiance de l’auteur vis-à-vis du centre unique et son goût des foyers autonomes !) Apporter une formule de justice distributive globale relève de la présomption, non du bon sens ni de la science (et l’auteur note en passant que cette présomption s’allie trop souvent avec une désarmante indifférence « aux obligations immédiates de la justice commutative »). Établir un ordre sériel pertinent « à toutes ressources et à tous égards » dépasse les forces de l’esprit humain : un ordre pertinent à l’égard des besoins que les hommes ont à satisfaire ne l’est pas à l’égard des mérites à récompenser ni à l’égard des possibilités à actualiser. Croire que l’autorité juste est celle qui instaure un ordre juste en tous points « est le chemin des plus dangereuses folies ». Se représenter la justice distributive comme le fait d’un suprême dispensateur est d’ailleurs le fait d’une pensée « pauvre et paresseuse ».
Le sens de la justice
B. de Jouvenel nie-t-il donc la Justice, à la suite des vieux Sophistes, de Carnéade, de Hobbes (ramenant tout au Pouvoir), et en un sens de Pascal ? Non point. Ce contre quoi il s’acharne, c’est ce qui lui paraît être la conception actuelle de cette Justice, à savoir non plus une vertu des âmes, des hommes qualifiés précisément de « justes » à cause d’une certaine manière d’être, mais un certain arrangement des choses, un certain aménagement collectif, une certaine « configuration de la société, de la géométrie sociale » — coïncidant avec une vue quelconque de l’esprit. Ce qui l’enrage, c’est « l’absurdité d’une société où tout serait juste sans que personne eût à l’être » : et il lui paraît que les illusions nourries de nos jours débouchent logiquement là-dessus. Le règne de la Justice, il le croît possible seulement dans la mesure où « l’esprit de justice préside à toute décision impliquant un partage ». Justice distributive, si chacun opère le partage avec le souci de sa responsabilité et en comparant les co-partageants « sous le rapport pertinent à l’occasion » (cependant que chacun s’applique à rendre l’équivalent de ce qu’il a reçu : justice commutative).
Cette justice distributive, bien loin d’être le fait d’un suprême dispensateur est le devoir de chacun, « ne se trouvant aucun être libre qui n’ait à prendre des décisions de partage entre autres ». Si grande que puisse être l’autorité de quelqu’un et si haute sa place dans une société, il n’a jamais à répartir « toutes choses entre tous », mais uniquement certaines choses entre certains à un moment donné : si alors il cherche et applique « l’ordre sériel pertinent à cette occasion », il a agi avec justice, iî a manifesté cette qualité de l’âme — et non des choses — qui est la vertu de justice, il a été « un juste », et c’est tout ce qu’on peut lui demander.
Quant à la Liberté, le seul résumé des soixante pages où l’auteur l’explore patiemment, et passionnément, nous mènerait trop loin. D’autant qu’elles vont loin, ces pages, et provoquent — dans toute la force du verbe — la discussion. Ce mot de Liberté — même s’agissant seulement, comme c’est ici le cas de la liberté de l’homme en société et non du libre-arbitre, bien que le libre-arbitre y soit lié, et qu’un Tocqueville l’y ait lié avec ferveur — ce mot sacré « inscrit sur les étendards de l’Occident », et pas seulement de l’Occident, on a tant joué sur lui, on a tant joué de lui, je serais tenté de dire : on s’est tant joué de lui depuis les Jacobins avec leur « despotisme de la liberté » se réclamant de Rousseau, depuis Hegel avec sa liberté objective ou vraie liberté jusqu’à nos jours ivres de confusion ! Contentons-nous de dire comment B. de Jouvenel prend son sujet, l’un des plus grands et des plus désespérants de la science politique.
Il part de Rousseau, du méconnu Rousseau (méconnu surtout par qui se réclame le plus de lui). « L’homme est né libre et partout il est dans les fers ». Les fers sont une gêne, un obstacle à l’exercice du pouvoir de l’homme : la liberté consiste à les enlever, c’est la liberté comme pouvoir : on sait déjà ce que l’auteur en pense. Les fers sont une honte, une indignité : la liberté consiste à accroître la dignité, c’est la liberté comme dignité. Elle n’exclut pas les obligations, qui dans une certaine mesure sont des fers, mais il y a des obligations dont l’homme est « lui-même l’appréciateur et il en est d’autres qui sont appréciées par un supérieur en puissance » ; et c’est justement dans la dignité d’appréciateur que réside la liberté de l’homme. « On est libre au moment et dans la mesure où l’on juge soi-même ses obligations et où seul on se contraint à les remplir ». Mais alors le conflit entre le jugement propre et le jugement d’autrui, et spécialement le jugement de l’autorité publique, met en péril cette liberté. Or ce conflit est inhérent aux époques (que les saint-simoniens eussent appelées critiques) de dispersion des croyances. Ce pourquoi l’aspiration à la liberté prend alors la forme d’un rêve utopique de retour à l’unité — rêve caressé par d’étroites sectes, d’ailleurs prêtes à tyranniser pour le réaliser contre les résistances.
C’est par ce biais que l’auteur est amené à étudier de façon très serrée et très subtile l’évolution des croyances dans une société. Évolution convergente ou divergente ou alternativement l’une et l’autre ou encore convergente à certains égards et divergente à d’autres. Il dégage un « postulat de convergence » qu’il montre lié à l’idée de lumière naturelle, elle-même liée à la conviction chrétienne de la participation humaine à l’intelligence du Créateur. La lumière naturelle qui éclaire les esprits les défend ou les guérit des opinions erronées, simples « déviations de l’esprit par rapport à la vérité dont il à l’appétit naturel », aberrations sans portée sérieuse. D’où la justification de la décision majoritaire des démocraties par tout autre chose qu’un droit des plus nombreux c’est-à-dire de la force : par son caractère de recherche du vrai et du juste grâce au recours « à la lumière naturelle dans tous les esprits ». Le postulat inverse, celui de divergence, l’auteur le montre fondé sur une philosophie toute différente, matérialiste et relativiste : la raison qui attaque les croyances et normes sociales existantes en tant que coutumières et arbitraires manque de toute règle certaine pour en établir d’autres, « car il n’y en a point de vraies ni justes en soi ». Et de la diversité des situations et des intérêts, plus grande à mesure qu’une société progresse et se complique, naît une diversité toujours plus étendue des jugements. Comment redresser cette divergence sinon par une convergence artificiellement assurée et qui ne peut d’ailleurs porter que sur un utile (toute convergence sur un « juste » étant exclue) ? En éclairant les individus, le plus grand nombre possible d’individus, répondent les libéraux utilitaires du style James Mill. En établissant l’uniformité des situations, répondent les marxistes : tous étant dans la même situation, disons prolétarienne, voudront les mêmes règles.
À quoi l’auteur objecte que le libéralisme utilitaire a été démenti par les faits et le marxisme aussi. Le premier parce qu’on n’a vu dans les démocraties libérales de larges accords que « lorsque des sentiments moraux étaient en jeu », alors que « dans tout ce qui est de l’ordre des intérêts l’accord des esprits n’a jamais pu se faire ». Le second parce que, contrôlant étroitement les situations, il n’en a pas été moins obligé de contrôler étroitement les esprits.
Conclusion qui soulèvera une tempête d’objections, tout comme l’affirmation incidente que le libéralisme moral ne saurait mener à la tolérance : « La confiance montrée dans la sélection naturelle du juste et du vrai (postulat de convergence) tient étroitement à l’idée de lumière naturelle, à l’idée d’une participation humaine à l’essence divine. Laquelle n’étant plus crue, tout l’édifice s’écroule ».
Sur cet avertissement, ou ce constat pessimiste, l’ouvrage s’achève ; on est tenté de dire : tourne court. L’exploration est non pas terminée, mais interrompue. L’explorateur n’est pas à bout de course, mais après ce dur défrichement, ayant tracé quelques avenues lumineuses dans une forêt en partie vierge, il a besoin de reprendre haleine. De faire en quelque sorte le point avec lui-même.
Il nous a obligés à le faire avec nous-mêmes ses lecteurs sur quelques-uns des concepts les plus importants, et parfois les plus faussement clairs, de la science politique. Partis avec lui à la recherche du Bien politique, nous avons participé à ses tâtonnements, à ses lentes et subtiles démarches, nous avons buté avec lui sur mille difficultés méconnues que sa lucidité persuasive nous a forcés de connaître. Nous savons maintenant que le « bien commun se trouve dans la force du nœud social, dans la chaleur de l’amitié entre citoyens, dans la solidité des certitudes qu’ils se donnent, toutes conditions du bien que les hommes peuvent se faire mutuellement par l’existence de la société » ; nous savons que la fonction essentielle des autorités est « l’augmentation de la confiance régnant au sein de l’ensemble ». Mais nous savons également que l’extension des sociétés, l’agrégation de populations disparates, la contagion des cultures, le jaillissement des nouveautés, en somme tout ce qui caractérise précisément le processus de l’histoire, se trouve être en contradiction directe avec les conditions précédemment dégagées.
Le Bien commun d’une Grande Société, trop grande pour qu’elle soit vraiment représentée dans les esprits et chérie par les cœurs, et pour qu’elle n’apparaisse pas « comme quelque chose de lourd et de confus, sans forme et sans visage ». Comment éviter que la plus large partie des membres de cette Société ne s’en désintéresse ? Nous savons aussi bien d’autres choses que nos réflexions en ces pages ont dû négliger mais dont le lecteur de l’ouvrage s’enrichira. Celle-ci notamment : que parler des rapports de l’Individu et de la Société est une façon commode de parler, mais qui amène à sous-estimer dangereusement « les assemblages fondamentaux » ; si chaque personne est unique, aucune n’est capable d’existence séparée ; les ensembles ne résultent pas, à titre de phénomènes secondaires, de synthèse d’individus, ce sont des phénomènes primaires de l’existence humaine ; inversement la Société en tant qu’extension et complexité maxima d’assemblage humain n’existe pas nécessairement ; le vrai point de départ d’une étude scientifique est donc dans les formations sociales élémentaires, à savoir l’unité domestique (le « feu » ) , le milieu d’existence, l’équipe d’action. Rétrécir à l’individu, distendre à la Société (qualifiée de « grande famille » ou de « grande équipe » abusivement, comme on a vu) égarent également l’esprit, substituent des vues de l’esprit à l’analyse exacte du réel observable, conduisent à une fausse science politique, au plus grand dam et de la science… et de la politique.
—
Lire aussi sur Contrepoints :
- La métaphysique du Pouvoir
- Le « Pouvoir pur », né sur les cendres de la féodalité
- L’État comme révolution permanente
- Le credo de la liberté
—



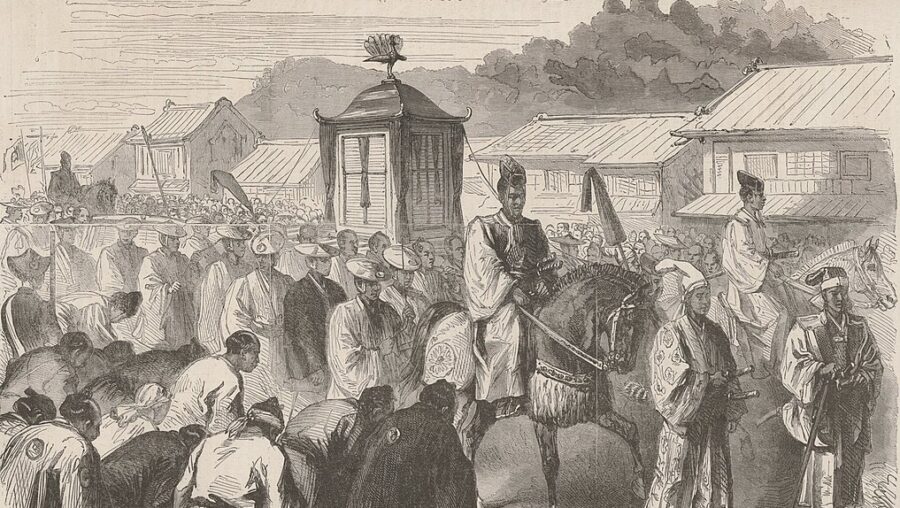


Pour que le peuple soit le Souverain. Il doit disposer du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières y compris constitutionnelle et de traités. 82 à 88 % des Français y sont favorables , Voir http://www.article3.fr
. Mais pas la direction de ” Contrepoints” et pas non plus bon nombre de ” libéraux”…
Ils ne souhaitent pas que les citoyens puissent entre deux scrutins de même niveaux reprendre la parole pour décider de ce qui les regarde.. Chacun son truc
” les hommes naissent libre et égaux en droit , et quand ils sont adultes, ils vont au bistrot … “
Personnellement je suis venu ici surtout pour apprendre , certains citent Tocqueville ” la démocr c’ est : la dictature de la majorité ”
On peut contester cette formule magique de ce maitre à penser il faudrait déja définir ce qu’ est EXACTEMENT démocratie en effet ce mot ne semble pas encadré de guillemets dans son ouvrage ” d…en Amérique ” le titre est de plus erroné puique il s’ agit des Etats Unis 1776
Il y aurait tant à écrire la nuit y passerait …
excellent article !