Par Jean-Daniel Thumser.
 Le dernier ouvrage de Michel Houellebecq, décrié bien avant sa sortie du simple fait des thèmes qu’il aborde, n’a toutefois qu’une mince importance littéraire dit-on.
Le dernier ouvrage de Michel Houellebecq, décrié bien avant sa sortie du simple fait des thèmes qu’il aborde, n’a toutefois qu’une mince importance littéraire dit-on.
La légèreté déconcertante de ses propos et de son style est-elle assimilable à une maestria ou à de l’oisiveté intellectuelle ? Nul besoin de réitérer les multiples critiques, concédant à la fois une « paresseuse désinvolture » de l’auteur ou, a contrario, « une extraordinaire consistance romanesque »1.
La critique est polymorphe mais consent à qualifier cette dernière publication comme une réussite pour autant qu’elle embrasse des sujets pour le moins difficiles à traiter : l’incompréhension bilatérale de la pensée islamique, un système universitaire clos, l’immobilisme supposé du peuple français et plus généralement de l’Europe, les relations sexuelles, et enfin le statut social de l’homme et de la femme.
L’art du rhéteur
Nous faisons le pari que Houellebecq reprend à ses frais une tradition qui veut que l’art consiste à dissimuler l’art (Ars (est) celare artem).
En d’autres termes, l’auteur tend à la simplicité et à l’ironie sous toutes ses formes, y compris dans la passivité et l’absolu nihilisme de son personnage, François. Le choix d’un tel prénom est lui-même une moquerie, une blague potache qui nous évoquera sans doute François le Français. Ce dernier incarne une France que l’auteur aime à illustrer selon son inefficacité, son errance et son effacement. Ce parallèle est d’autant plus troublant que son prénom n’apparaît qu’à six reprises dans le roman, ce qui n’est pas sans surprise tant il s’éloigne progressivement de la scène politique et sociale. François est un Meursault dont le paysage mental est celui d’une France languissante et irrésolue qui ne cesse de s’effacer pour laisser place à une république islamique – aux antipodes des paradigmes que nous ont légué les Lumières.
La soumission dont il est ici question est ambivalente et ne doit pas être prise en un sens littéral. Maints commentateurs comprennent ce titre comme une traduction pour le moins engagée du terme Islam, or la soumission qu’illustre ici Houellebecq n’est pas celle des croyants musulmans, mais celle des citoyens français et de leurs institutions. Il s’agit bien plus d’une critique ténue mais néanmoins radicale d’un laisser-aller quotidien dont nous retrouvons les traces dans les textes qui ont assurément inspiré Houellebecq. Lovecraft par exemple, avec la crainte d’une décadence de l’ère technologique, la critique acerbe d’un libéralisme qui s’illustre dans les détails les plus insignifiants de la vie ; ou bien Camus et Céline chez lesquels nous retrouvons des personnages dont la passivité est telle qu’ils sont lestés de toute capacité à être les agents de leur propre existence.
Ainsi ce n’est pas uniquement l’antihéros qui ne cesse de nous interpeller par son absence de prise de position. La totalité des instances économiques, éducationnelles et politiques semblent indifférentes aux changements qui émergent peu à peu dans la société.
Houellebecq insiste sur ce point à de multiples reprises. L’unique occurrence d’une libération est celle de la fuite, celle des juifs de France vers Israël. Les services secrets, les partis politiques et les mouvements identitaires ne font que s’arranger du mieux possible pour sauvegarder leurs acquis, ce jusqu’à l’inévitable conversion à l’Islam ordonnée par la Fraternité musulmane une fois le pouvoir obtenu. Cela ne dérange guère le protagoniste du roman, du moins en deuxième instance, une fois qu’il a pris conscience des atouts sociaux qui lui étaient possible d’acquérir à lui et aux autres : une retraite anticipée avec un solde conséquent pour les uns, une carrière au sommet de l’État pour les autres, ainsi que plusieurs femmes dont les tâches sont aussi variées qu’avilissantes.
Illustration d’un immobilisme
Houellebecq met le doigt sur des sujets qui fâchent avec une légèreté pour le moins irritante pour qui ne distingue pas l’ironie directrice de ce texte.
C’est ainsi qu’il produit un sentiment de frustration tout au long du roman, passant de descriptions quasi cliniques du milieu universitaire et des relations sexuelles entre hommes et femmes – descriptions dont il possède la maîtrise, jusqu’aux clichés les plus grossiers concernant la politique ou la religion musulmane. Le lecteur ne peut qu’être déboussolé face à une somme aussi conséquente de paradoxes au sein d’un même texte. Comment appréhender de telles contradictions dans le style de Houellebecq ? Nous doutons qu’il puisse s’agir d’une simple paresse de l’auteur. La posture qu’il emprunte dès ses premiers écrits illustre un écrivain qui n’a eu de cesse de rester critique et acerbe face aux « avancées » de toutes sortes. Aussi n’est-il pas simplement réactionnaire, tel qu’il est souvent dit, mais sévère et complexe. Ce dernier roman en est la preuve.
Une première lecture peut nous induire en erreur, nous pousser à croire naïvement que ce n’est qu’un pamphlet rédigé dans l’intention d’échauffer les masses sans pour autant qu’il y ait quelque fond que ce soit. Houellebecq se fait maître d’un courant littéraire aujourd’hui présent aux États-Unis dont Bret Easton Ellis est un des plus éminents représentants. Ces auteurs utilisent la dystopie afin de mettre en exergue un monde qui n’a de cesse de se disloquer dans sa quête perpétuelle du bonheur.
Les exemples sont nombreux : Le meilleur des mondes, 1984, Fahrenheit 451, pour ne citer que les plus célèbres. Or la singularité du texte de Houellebecq tient en ce qu’il met en scène une France proche de nous, mais dont les politiques actuelles nous font encourir des risques majeurs : perte d’identité, perte d’unité de la chose publique (res publica), indifférence et enfin soumission au sens de nihilisme. L’Islam n’est pas ainsi le cœur problématique du roman, mais un prétexte afin d’analyser une société du spectacle qui se consolide sur ses propres fragilités.
L’art consiste à dissimuler l’art
Il est somme toute essentiel de distinguer dans ce roman, et plus encore dans les réactions qu’il engendre, une preuve du malaise ambiant et de la sclérose du langage qui nous mènent vers le cauchemar qu’envisageaient déjà avec horreur des auteurs comme Tocqueville, Huxley, ou plus récemment Lipovetsky. Loin d’une apologie du néant, l’auteur sait se jouer de nous, et c’est en ce sens qu’il sait attirer toute notre attention.
Soumission de Michel Houellebecq n’est ni l’œuvre maîtresse de l’auteur, ni une œuvre qui marquera indéfectiblement le lecteur, mais elle possède malgré tout une dimension qui nous rappellera sans nul doute Voyage au bout de la nuit de Céline tant elle arrive à nous décontenancer.
- Michel Houellebecq, Soumission, Flammarion, janvier 2015, 320 pages.
—
Jean-Daniel Thumser est doctorant à l’École Normale Supérieure (Paris).
- Dossier consacré à l’ouvrage dans Le Monde des Livres (09/01/2015), pp.2-3 ↩

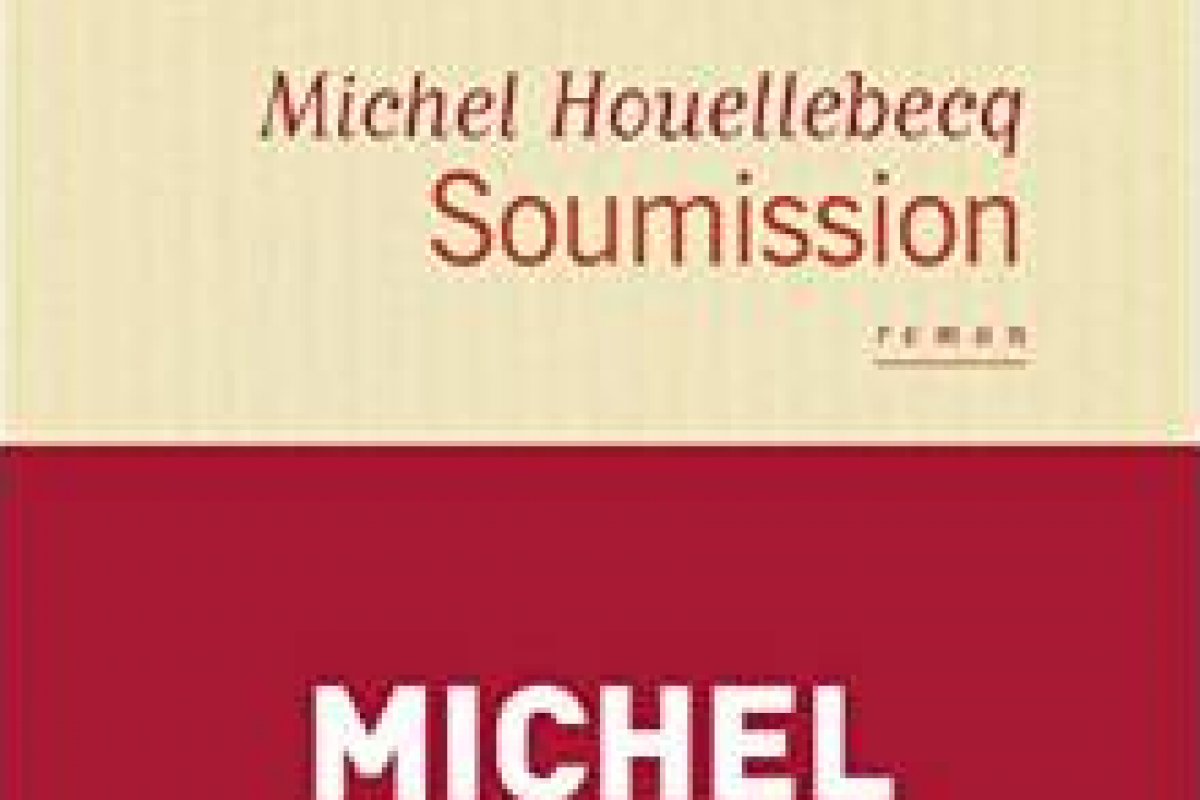



“Nous faisons le pari que Houellebecq reprend à ses frais une tradition […]” -> à son compte ?
Veuillez m’excuser, Bigfin, c’est bien une erreur de ma part.