Par Gérard-Michel Thermeau.
 Talleyrand ? « De la merde dans un bas de soie », selon un mot d’autant plus fameux qu’il est apocryphe. À qui m’avait demandé, un jour, qui était le plus grand homme politique libéral français du XIXème siècle, j’avais répondu, en forme de boutade : Talleyrand, bien sûr. Comme l’a si bien écrit Balzac, qui lui a emprunté bien des traits de son Vautrin : « M. de Talleyrand, l’homme qui se fout de tout et qui est plus haut que les hommes et les circonstances. »
Talleyrand ? « De la merde dans un bas de soie », selon un mot d’autant plus fameux qu’il est apocryphe. À qui m’avait demandé, un jour, qui était le plus grand homme politique libéral français du XIXème siècle, j’avais répondu, en forme de boutade : Talleyrand, bien sûr. Comme l’a si bien écrit Balzac, qui lui a emprunté bien des traits de son Vautrin : « M. de Talleyrand, l’homme qui se fout de tout et qui est plus haut que les hommes et les circonstances. »
Le « Diable boiteux », si bien incarné à l’écran par Sacha Guitry, et dont Emmanuel de Waresquiel a écrit la biographie, une des plus brillantes que j’ai eu l’occasion de lire, n’a cessé de fasciner, de révulser, de scandaliser. Réactionnaires et conservateurs communient avec les progressistes et les révolutionnaires de tous poils dans l’exécration et l’anathème à l’égard de celui qui a eu le toupet de trahir à la fois le Roi et la Révolution. Les adorateurs de l’Incorruptible Robespierre blêmissent devant la corruption bien établie du prince de Bénévent, les grenouilles de bénitier excommunient le spoliateur des biens du clergé, les idolâtres de l’Empereur ne pardonnent pas au grand chambellan d’avoir conspiré contre leur Grand Homme, bref, les fanatiques de toutes obédiences dénoncent celui qui n’a respecté aucun serment et servi tous les régimes.
Oserai-je l’avouer, la simple liste des ennemis de M. de Talleyrand suffirait à me le rendre sympathique. Son seul tort fut, peut-être, de se vouloir de Périgord alors qu’il n’était que du Périgord1.
Un prêtre sans vocation
Boiteux de naissance, devenu prêtre pour succéder un jour à son oncle, archevêque de Reims, il devait étudier en Sorbonne la théologie, excellente formation à la carrière diplomatique qu’il devait tant illustrer. S’il était dépourvu de toute vocation religieuse, à l’image de son modèle le cardinal de Retz, il devait se révéler un excellent agent général du clergé par son sérieux et ses compétences. Ce grand travailleur ne cessera de jouer les paresseux, au rebours de tant d’autres. Sous le masque juvénile de l’abbé de cour amateur de beautés, les filles de Louise de Rohan puis Adélaïde de Flahaut, il fréquente les Lansdowne, grands aristocrates britanniques libéraux, pacifistes et francophiles à Bath, et se montre un brasseur d’affaire avisé. Il noue des relations avec Dupont de Nemours, l’abbé Louis, Mirabeau, Clavière et Isaac Panchaud. Convaincu des bienfaits du libre-échange, il soutient le traité de commerce franco-anglais. Sa connaissance des mécanismes économiques le distinguera de la plupart des hommes politiques de son temps.
Il est enfin évêque d’Autun, si peu et si tard. Mal vu de la reine, il n’obtient sa consécration qu’au début de l’année 1789. Son diocèse n’aura guère l’occasion de jouir de sa présence : il y reste en tout et pour tout, vingt jours. Mais il va inspirer les cahiers de doléances du clergé assemblé à Autun. Son anglophilie s’y manifeste clairement dans le souhait d’une monarchie à l’anglaise : une assemblée périodique et libre dans ses délibérations, investie du droit d’élaborer une « constitution » garantissant les droits de tous, l’égalité devant l’impôt uniforme et consenti, le maintien de la propriété, la tolérance intellectuelle et religieuse, la liberté d’expression, de circulation et les garanties d’une véritable liberté individuelle.
Un révolutionnaire sans passion
Élu aux États généraux, il y montre ce flair politique qui devait toujours le caractériser : il rallie le Tiers le 26 juin, la veille de la capitulation royale, juste à temps. Son attitude face à la Révolution est bien résumée dans une lettre envoyée à la comtesse de Brionne en octobre 1789 : « Une vérité qui doit vous arriver, c’est que la Révolution qui se fait aujourd’hui en France est indispensable dans l’ordre des choses où nous vivons, et cette révolution finira par être utile. »
Peu brillant à la tribune, il est davantage un homme de comité. Il contribue à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme. Son esprit libéral se manifeste par deux prises de position qui sont toutes à son honneur : il réclame les droits politiques en faveur des juifs de France (28 janvier 1790) et n’hésite pas davantage à défendre les prêtres qui refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé (7 mai 1791). Il devait garder de cette première partie de la Révolution, où l’on avait eu beaucoup de mal à accoucher d’une Constitution, une méfiance à l’égard des textes constitutionnels.
Sa grande passion reste les questions économiques et financières. Il n’est pas question de léser les créanciers de l’État. Il faut le rappeler, la Révolution n’est pas le résultat d’un « complot maçonnique » ou de la lecture de l’Encyclopédie mais d’une crise financière majeure de la monarchie. Pour lui, la seule solution consiste à nationaliser les biens du clergé. En effet, le clergé n’est plus un ordre et il a perdu ses dîmes. Son sacrifice le réconciliera avec la nation. En échange, la nation prendra en charge son entretien.
On ne lui pardonnera ni d’avoir trahi le clergé dont il avait été le défenseur, ni d’avoir célébré la messe pour la Fête de la Fédération, ni d’avoir consacré les premiers évêques constitutionnels. Le pape Pie VI furieux l’avait suspendu l’accusant de « parjure » et de « sacrilège » mais il avait déjà démissionné de ses fonctions épiscopales.
Trafiquant et complotant, il constate la dérive radicale de la Révolution, et réussit à quitter la France en toute légalité avant d’être inscrit sur la liste des émigrés fin août 1793. Il fréquente les milieux whigs et francophiles du libéralisme anglais avant d’être expulsé du territoire britannique en mars 1794, étant jugé un homme « profond et dangereux ». Il trouve refuge aux États-Unis avant de rentrer en France sous le Directoire. Habile intrigant, il obtient le portefeuille des Affaires étrangères et s’enrichit scandaleusement. Il rencontre un jeune général ambitieux, le coup de foudre est réciproque : il va aider Bonaparte à partir pour l’Égypte. Il se rapproche aussi de Sieyès qui médite un coup d’État pour établir une nouvelle constitution. Railleur, l’évêque apostat déclare de l’ancien abbé qui passe pour un homme profond : « Profond ? C’est creux, très creux que vous voulez dire ? » Bonaparte réussit à rentrer d’Égypte sain et sauf échappant « miraculeusement » à la flotte anglaise. Le fait que cette flotte soit commandée par Sidney Smith, ami de longue date de Talleyrand, a-t-il contribué au miracle ? Bonaparte, Sieyès et Talleyrand organisent un 18 Brumaire qui se passe à merveille même s’il est suivi par un 19 Brumaire qui faillit tourner mal.
Le ministre de Napoléon
Redevenu ministre des Affaires étrangères, il va contribuer au rétablissement de la paix sur le continent après dix ans de guerre ininterrompue. Face au Premier Consul brutal et tranchant, il temporise : « Il ne faut jamais se presser. Moi, je ne me suis jamais pressé, et je suis toujours arrivé. » Le rétablissement des relations entre l’État français et le Saint-Siège lui permet de porter l’habit séculier mais il ne peut obtenir du pape de pouvoir se marier. Ce qui ne l’empêchera pas d’épouser une étrange aventurière divorcée, mariage doublement illégal.
L’échec de la paix d’Amiens entre la France et l’Angleterre, en raison des ambitions de Napoléon, va contribuer peu à peu à éloigner les deux hommes. L’histoire d’amour est bien terminée. Pourtant ils vont encore commettre ensemble un crime dont Talleyrand rejettera la faute sur tous les autres participants : l’enlèvement et l’exécution du duc d’Enghien après un simulacre de procès (mars 1804). Maître du double jeu, il sera finalement le seul de tous les protagonistes de l’affaire à n’en pas subir les conséquences. Nommé grand chambellan, il se montre courtisan tout en gardant son quant à soi. Le 2 décembre 1804 à Notre-Dame, il est le seul des participants au sacre qui ait été présent au sacre de Louis XVI en juin 1775.
En dépit de ses efforts, Napoléon humilie l’Autriche après Austerlitz et dédaigne l’occasion de faire la paix avec l’Angleterre. Talleyrand dira à Mme de Rémusat : « Tremblez ! Insensés que vous êtes, des succès de l’empereur sur les Anglais. Car, si la constitution anglaise est détruite, mettez-vous bien dans la tête que la civilisation du monde en sera ébranlée jusque dans ses fondements. » Mais il reste l’excellent administrateur qui faisait l’admiration du clergé en 1785 et qui surprend Napoléon en assurant le ravitaillement de la Grande Armée aux prises avec le redoutable hiver 1806-1807. Désapprouvant le rapprochement avec la Russie, Talleyrand quitte le ministère. Il tente en vain de dissuader Napoléon de déposer les Bourbons d’Espagne et se voit contraint de jouer les geôliers des princes espagnols à Valençay.
Napoléon commet la faute de l’emmener à Erfurt où il a réuni les têtes couronnées d’Europe. Il va désormais commencer à trahir Napoléon, incitant le Tsar à lui résister et à se rapprocher de l’Autriche. Napoléon étant parti régler la question espagnole, Talleyrand et Fouché intriguent sur la question de la succession en cas d’accident arrivant à l’Empereur en Espagne. De retour à Paris, Napoléon insulte violemment son ancien Grand Chambellan. Celui-ci ne devait jamais lui pardonner. Il encourage désormais l’Autriche à préparer la guerre. Russes et Autrichiens rétribuent généreusement ses services. Après la désastreuse campagne de Russie, Napoléon réunit un conseil début janvier 1813. « Négociez » conseille Talleyrand, qui ne sera pas davantage entendu. Malgré tout, Napoléon lui conserve une place au pouvoir : il continue à voir en lui le plus capable des ministres qu’il ait eu. Mais Talleyrand n’est pas homme à se jeter à l’eau pour sauver quelqu’un qui se noie.
Le faiseur de constitution
Selon le mot de Vitrolles, il se prêtait à court terme mais il ne se donnait jamais. En 1814, il songe à faire un « 18 Brumaire à l’envers » en restaurant les libertés avec une constitution aussi proche possible du modèle anglais. Le retour des Bourbons ne l’enchante guère : il a trop à se faire pardonner. Et si Napoléon mourait glorieusement sur le champ de bataille ? Une régence avec le petit roi de Rome serait davantage souhaitable. Mais Talleyrand est un réaliste qui sait utiliser les circonstances. Il favorise l’entrée des Russes à Paris, réussit à convaincre le tsar Alexandre de favoriser une restauration des Bourbons entourée de garanties constitutionnelles. L’abdication de Napoléon fait de lui le « vice-roi de France ».
Devenu chef du gouvernement provisoire, Talleyrand, derrière la légèreté insouciante qu’il montre dans son hôtel Saint-Florentin, va droit au but qu’il s’est fixé. Pendant douze jours, il va être le maître de la France. Il imprime une touche libérale qui correspond au fond de son caractère : les conscrits sont rendus à leur famille, les prisonniers politiques libérés, il facilite le retour des princes espagnols et du pape chez eux, maintient les fonctionnaires à leur poste (seul deux préfets sont remplacés).
Talleyrand ne sous-estime pas Louis XVIII et souhaite ne pas lui livrer le pays sans garanties. Pour cela une constitution est nécessaire, à l’anglaise avec deux chambres, l’une héréditaire, l’autre élective. Talleyrand pour mieux combiner l’ancien et le nouveau appelle le texte du 6 avril 1814, « Charte constitutionnelle ». Le gouvernement et le Sénat appellent « librement au trône Louis-Stanislas Xavier, frère du dernier roi ». Talleyrand ne se fait pas d’illusion : « Cette constitution n’est pas bonne mais, après tout, il y a là-dedans de quoi gouverner ». Elle va servir de base, de fait, à la monarchie française jusqu’en 1848. Louis XVIII reprendra le texte pour en faire une Charte octroyée.
Le 12 avril, Talleyrand accueille l’aimable comte d’Artois, le seul Bourbon pour lequel il ait jamais eu de l’affection. Le frère de Louis XVIII, ému de revenir à Paris après 25 ans d’exil, bredouille quelques mots incompréhensibles. Le soir même, Talleyrand charge Beugnot d’inventer un mot susceptible de passer à la postérité : « Plus de divisions, la paix et la France ; je la revois enfin ! Et rien n’y est changé si ce n’est qu’il s’y trouve un Français de plus ! » Avec Louis XVIII les choses se compliquent : les deux hommes se ressemblent et donc se détestent. Pour le roi, il est « Asmodée » le prince des démons. À Compiègne, le 1er mai, il le fait attendre plus de deux heures avant de le recevoir.
Réduit aux Affaires étrangères, il est au centre de la convention d’armistice du 23 avril 1814 qui est très avantageuse pour une France vaincue et occupée ramenée à ses limites de 1792. La paix européenne, signée à Paris le 30 mai est une nouvelle satisfaction pour Talleyrand qui la trouve « très bonne ; faite sur le pied de la plus parfaite égalité ». La France qui a ravagé pendant vingt ans toute l’Europe et humilié les gouvernants des autres pays ne se voit infliger aucune indemnité de guerre, conserve presque toutes ses colonies, se voit reconnaître la possession de toutes les enclaves annexées pendant la Révolution et s’engage à abolir la traite dans les cinq ans.
Louis XVIII a accepté qu’il le représente à Vienne pour le premier et plus grand congrès européen. Talleyrand espère reconquérir ainsi la confiance du roi. Il est soucieux d’établir un « équilibre européen » en empêchant la domination de l’Autriche en Italie et de la Prusse en Allemagne. Or les anciens alliés regrettent d’avoir signé le traité de Paris et ne songent qu’à se partager les dépouilles enlevées au vaincu. Avant même l’ouverture du Congrès les quatre puissances victorieuses ont signé un protocole pour exclure des discussions les autres pays.
Le 22 septembre, invité à une conférence des quatre puissances, il se fait le défenseur de l’intérêt général de l’Europe : « s’il y a des puissances alliées, je suis de trop ici (…) Et cependant si je n’étais pas ici, je vous manquerais essentiellement. Je suis peut-être le seul qui ne demande rien. » Il finit par dissocier Castlereagh et Metternich du tsar Alexandre dont les ambitions inquiètent et à être admis le 8 janvier au sein du comité des Quatre.
Apprenant la fuite de Napoléon de l’île d’Elbe, il y voit la conséquence de la générosité mal placée du Tsar : « Je n’aime pas la politique sentimentale et c’est cette politique sentimentale qui nous replonge dans les malheurs de la Révolution et de la guerre. »
Pendant les Cent Jours, la presse se déchaîne : le Nain Jaune crée un ordre fictif, la Girouette dont le grand maître est « Périgueux, prince de Bienauvent » puis une caricature le présentant comme l’homme aux six têtes.
En attendant, Talleyrand envoie à Louis XVIII, réfugié à Gand, un mémoire où il souligne les fautes de la première Restauration et la nécessité de gouverner en monarque constitutionnel. Devant les excès de la «Terreur blanche », Wellington presse Talleyrand de revenir.
Une nouvelle déclaration à Cambrai affirme la volonté de gouverner constitutionnellement et promet le pardon aux Français égarés. Le roi a été égaré par ses « affections ». Lors de la réunion du Conseil, Monsieur2 se sent visé : « Est-ce moi qu’on veut indirectement désigner ? – Oui, puisque Monsieur a placé la discussion sur ce terrain ; Monsieur a fait beaucoup de mal. – Le prince de Talleyrand s’oublie ! – Je le crains ; mais la vérité m’emporte. » Cette déclaration indigne les Ultras contre le « Méphistophélès de l’Europe ». Chateaubriand, qui avait espéré en vain un portefeuille, devait se venger plus tard dans les Mémoires d’Outre-Tombe décrivant Talleyrand venant prêter serment de fidélité au roi en compagnie de Fouché, « le vice appuyé sur le bras du crime ». Talleyrand, ne ratant jamais l’occasion d’un mot féroce devait dire du grand écrivain : « M. de Chateaubriand se croit sourd depuis qu’il n’entend plus parler de lui. »
Talleyrand fait réviser la Charte pour renforcer le pouvoir législatif des Chambres, abaisser le cens, renforcer la liberté de la presse et de publication et établir l’hérédité des pairs pour assurer leur indépendance vis à vis du roi. Il tente de limiter l’épuration alors que Fouché pousse dans le sens contraire pour plaire aux Ultras et réussit à faire rétablir la censure.
L’ultimatum adressée par les Puissances à la France qui voit ses frontières réduites et astreint à une lourde indemnité de guerre le pousse à la démission, le 21 septembre 1815. Voué à rester dans l’opposition, il tente de se rapprocher des Ultras avant que sa pente naturelle ne le conduise du côté des libéraux. Il défend la liberté de la presse à la Chambre des Pairs et condamne l’intervention en Espagne. Il participe à la création du National, le journal de l’opposition libérale de Thiers et Laffite.
Les dernières fonctions
Les Trois Glorieuses confirme sa fameuse boutade : « Je porte malheur à ceux qui me négligent » Il refuse les Affaires étrangères que lui propose Louis-Philippe mais demande à être envoyé en Angleterre comme ambassadeur. Il est accueilli avec beaucoup d’honneurs à son débarquement le 24 septembre 1830. La presse lui trouve « l’air franc et ouvert » ce qui amuse le vieux renard : « C’est parce que j’avais le mal de mer ».
Il connaît son chant du cygne et va utiliser la crise belge pour favoriser une « cordiale entente » entre la France et le Royaume-Uni. Les longues négociations, où il déploie toute son habileté aboutissent au protocole des 24 articles qui établit le partage de la Hollande et de la Belgique. En lisant la réponse hollandaise, dilatoire, longue et embrouillée, il a cette réaction : « Quand on a raison, on n’écrit pas quarante pages ! »
De retour à Paris il n’a jamais été aussi populaire qu’au moment où il va se retirer de la scène politique. Il démissionne de son poste d’ambassadeur le 13 novembre 1834 par une lettre où il rappelle qu’il a sorti la France de son isolement sans nuire à son indépendance. L’opinion publique néanmoins le réclame parce qu’elle le tient, dit la duchesse de Dino, « pour quelqu’un que le diable emportera un jour, mais, qui en attendant, grâce au pacte qu’ils ont ensemble, ensorcelle à son gré l’univers ».
Sur son lit de mort, après s’être confessé à l’abbé Dupanloup, il reçoit l’extrême onction, la main fermée tournée vers l’extérieur : « N’oubliez pas, monsieur l’abbé, que je suis évêque. »



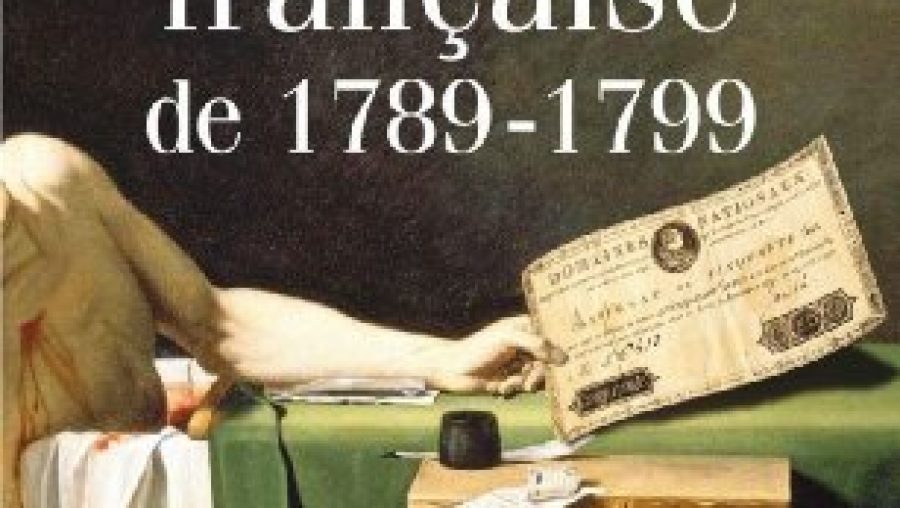

alors ministre des relations extérieur du directoire, talleyrand refuse de recevoir les plénipotentiaires de la jeune république américaine s’ils ne lui versent pas une commission … ces derniers s’en retournent en amériques outré et l’incident aboutira au rapprochement des USA avec l’angleterre et à un quasi statut de guerre avec la france. et également au renvois du diable boiteux …
il s’agit de la rencontre d'” erfurt ” et pas d'” eurfurt “.
on se demande également ou est passé joseph fouché ?
Petite erreur, ce n’est pas les “Trente glorieuses” Mais les Trois glorieuses.
Excellent article néanmoins d’une personnalité historique que j’apprécie ô combien.
Décidément j’étais distrait. Corrigé. Merci de cette lecture attentive.
Talleyrand avait exprimé son adhésion aux fondements de la pensée libérale dans un autre domaine. Son fameux discours sur l’Instruction publique du 10 septembre 1791, prononcé à l’occasion de la présentation d’un Rapport qui reprenait les grandes lignes du plan développé par Condorcet (Cinq Mémoires), revu et corrigé par les circonstances.
Les philosophes des Lumières avaient des vues divergentes sur le principe de la gratuité scolaire mais celle de l’enseignement primaire semblait acquise. Ils auraient de ce fait réfuté la vulgate socialiste (égalitariste, anti-elitiste et anti-méritocratique) qui inspire les réformes scolaires depuis cinquante ans et qui interdit de distinguer le talent pour le récompenser.
Talleyrand conclut sa présentation du projet éducatif de la Commission de l’Assemblée nationale en précisant que, si la Nation ne peut prendre en charge l’intégralité de l’enseignement public et doit partager cette responsabilité avec les citoyens, elle est
“tenue de consacrer une exception honorable que la nature elle-même semble avoir faite, en accordant le talent. Destiné à être un jour le bienfaiteur de la société, il faut que, par une reconnaissance anticipée, il faut qu’il soit encouragé par elle; qu’elle le soigne; qu’elle écarte d’autour de lui tout ce qui pourrait arrêter ou retarder sa marche; il faut que, quelque part qu’il existe, il puisse LIBREMENT parcourir tous les degrés de l’instruction; que l’élève des écoles primaire qui a manifesté des dispositions précieuses qui l’appellent à l’école supérieure y parvienne, aux dépens de la société, s’il est pauvre; que de l’école de district, lorsqu’il s’y distinguera, il puisse s’élever sans obstacle, et encore à titre de récompense, à l’école plus savante du département, et ainsi, de degré en degré, et par un choix toujours plus sévère, jusqu’à lInstitut national.” Il ajoute qu’il “est dangereux de trop encourager les demi-talents.( La majuscule est de mon fait)
De Gaulle déplorait déjà ce tropisme français qui allait devenir une règle de fonctionnement de l’EN dans les années 70 et videra ses écoles d’une proportion grandissante d’éléments talentueux, parmi les élèves ET les professeurs: “La France bride ses cracks pour faire gagner ses tocards”.
Merci de cet intéressant complément. Un article est nécessairement synthétique.
merci pour cet article
Merci pour cet article très averti et les commentaires. Je vous invite à rejoindre le groupe facebook “Les Amis de Talleyrand” où vos publications auront toute la diffusion qu’elles méritent.