Par Hadrien Gournay.
Dans les livres VIII, IX et X de L’esprit des lois Montesquieu étudie les effets des dimensions d’un territoire avec le régime politique d’un pays et avec ses facultés défensives. Il est alors aisé de prévoir les conséquences d’une expansion territoriale.
Les principes énoncés par Montesquieu étaient-ils valables au moment où il les énonçait ? Restent-ils d’actualité ?
Lien entre dimension du territoire et régime politique
Montesquieu distingue trois régimes politiques principaux : le républicain, le monarchique et le despotique.
Le régime républicain est adapté à un petit territoire. Le régime monarchique, où un seul gouverne selon des lois établies, fonctionne sur une étendue moyenne. Le régime despotique où tout est soumis sans limites à la volonté d’une personne unique se développe sur les territoires les plus étendus.
Comment une superficie territoriale donnée détermine-t-elle le régime qui y est adapté ?
Le petit territoire réclame une république à l’exclusion d’autres formes de gouvernement :
« Sans des circonstances particulières, il est difficile que tout autre gouvernement que le républicain puisse subsister dans une seule ville. »
En revanche, les institutions républicaines sont difficiles à conserver sur un territoire plus étendu :
« La république ne peut dominer qu’un territoire d’une petite étendue : dans une grande république, il y a de grandes fortunes et par conséquent, peu de modération dans les esprits : il y a trop de grands dépôts à mettre entre les mains ; les intérêts se particularisent ; un homme sent d’abord qu’il peut être heureux, grand, glorieux, sans sa patrie ; et bientôt, qu’il peut être le seul grand sur les ruines de sa patrie.
Dans une grande république, le bien commun est sacrifié à mille considérations ; il est subordonné à des exceptions ; il dépend des accidents. Dans une petite, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen ; les abus y sont moins étendus, et par conséquent moins protégés. »
Enfin, un territoire immense suppose le despotisme :
« Un grand empire suppose une autorité despotique dans celui qui gouverne. Il faut que la promptitude des résolutions supplée à la distance des lieux où elles sont envoyées ; que la crainte empêche la négligence du gouverneur ou du magistrat éloigné ; que la loi soit dans une seule tête ; et qu’elle change sans cesse, comme les accidents, qui se multiplient toujours dans l’état à proportion de sa grandeur. »
La monarchie se trouve par conséquent réservée aux territoires intermédiaires :
« Un état monarchique doit être d’une grandeur médiocre. S’il était petit, il se formerait en République ; s’il était fort étendu, les principaux de l’État, grands par eux-mêmes, n’étant point sous les yeux du prince, ayant leur cour hors de sa cour, assurés d’ailleurs contre les exécutions promptes par les lois et par les mœurs, pourraient cesser d’obéir ; ils ne craindraient pas une punition trop lente et trop éloignée » .
Alors que l’Inde dépasse aujourd’hui le milliard d’habitants, les États-unis, les trois cents millions, il est tentant d’ironiser sur ces principes qui reçoivent de telles exceptions. Il reste qu’au moment de la rédaction de l’Esprit des lois, les républiques de grandes dimensions étaient rares dans l’histoire. Seule Rome avait dominé un territoire considérable après les guerres puniques et l’expérience se solda par la mise en place des institutions impériales par Auguste. En revanche, on pourrait trouver de petits monarques et de petits despotes.
La différence entre l’époque moderne et le reste de l’histoire concernant les républiques est que la multiplication des moyens de communication facilite une certaine uniformité à l’intérieur d’un territoire de grande étendue et la volonté de former une société commune à une telle échelle.
Lien entre dimension et défense du territoire
Montesquieu établit une relation entre la superficie du territoire qu’il domine et capacité de l’État à en assurer la défense. Il en résulte qu’une dimension intermédiaire est la meilleure configuration possible à cet égard :
« Pour qu’un État soit dans sa force, il faut que sa grandeur soit telle qu’il y ait un rapport de la vitesse avec laquelle on peut exécuter contre lui quelque entreprise et la promptitude qu’il peut employer pour la rendre vaine. Comme celui qui attaque peut d’abord paraître partout, il faut que celui qui défend puisse se montrer partout aussi ; et, par conséquent, que l’étendue de l’État soit médiocre, afin qu’elle soit proportionnée au degré de vitesse que la nature a donné aux hommes pour se transporter d’un lieu à un autre. »
Régime politique et efficacité défensive étant tous deux associés à l’étendue du territoire, il est possible de s’intéresser à la manière dont chaque régime assure sa défense contre les attaques extérieures.
Les républiques trouvent dans le fédéralisme la solution au dilemme entre un accroissement incompatible avec le régime républicain et la conservation d’une superficie modeste les laissant à la merci des puissances étrangères :
« Si une république est petite, elle est détruite par une force étrangère ; si elle est grande, elle se détruit par un vice intérieur.
Ce double inconvénient affecte également les démocraties et les aristocraties, soit qu’elles soient bonnes, soit qu’elles soient mauvaises. Le mal est dans la chose même, il n’y a aucune forme qui puisse y remédier. »
Ainsi, il y a grande apparence que les hommes auraient été obligés à la fin de vivre sous le gouvernement d’un seul, s’ils n’avaient imaginé une manière de constitution qui a tous les avantages intérieurs du gouvernement républicain et la force extérieur du gouvernement monarchique. Je parle de la République fédérative. »
Cette forme de gouvernement est une convention, par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d’un État plus grand qu’ils veulent former. C’est une société de sociétés qui en font une nouvelle qui peut s’agrandir par de nouveaux associés, jusqu’à ce que sa puissance suffise à la sûreté de ceux qui sont unis. »
À l’opposé, les régimes despotiques préfèrent éloigner leur voisinage pour s’en protéger :
« Comme les républiques pourvoient à leur sûreté en s’unissant, les États despotiques le font en se séparant, et en tenant, pour ainsi dire seuls. Ils sacrifient une partie du pays, ravagent les frontières, et les rendent désertes : le corps de l’empire devient inaccessible.
Il est reçu en géométrie que, plus les corps ont d’étendue, plus leur circonférence est relativement petite. »
Enfin, les monarchies se distinguent des États despotiques par leurs stratégies de défense :
« La monarchie ne se détruit pas elle-même comme l’État despotique ; mais un État d’une grandeur médiocre pourrait être d’abord envahi. Elle a donc des places fortes qui défendent ses frontières et des armées pour défendre ses places fortes. Le plus petit terrain s’y dispute avec art avec courage, avec opiniâtreté. Les États despotiques font entre eux des invasions : il n’y a que les monarchies qui fassent la guerre »
L’analyse de Montesquieu semble plus contestable aujourd’hui, dans les sociétés industrielles dont les puissances économique et militaire semblent aller ensemble. Il y aurait de bonnes raisons de penser que la capacité militaire devrait être un mix entre la richesse totale d’un pays et la richesse par habitant. La richesse totale qui multiplie la richesse et la richesse par habitant correspond à la production totale d’un pays.
En supposant deux pays prélevant la même part de leur production pour faire la guerre, celui dont la production globale est la plus abondante aura les meilleures chances de succès. Cette notion de production totale doit être corrigée par celle de production par habitant pour deux raisons principales : le pays dont la production totale est plus importante pourra prélever une part plus importante de ses ressources et bénéficiera d’un avantage technologique certain. C’est ainsi que la Chine fut vaincue au XIXe siècle par un Royaume-Uni dont la richesse par habitant était supérieure mais la richesse totale inférieure.
Cette relation entre économie et puissance militaire qui semble s’appliquer assez bien aux guerres postérieures à la révolution industrielle serait pourtant mise à mal par de nombreux épisodes historiques antérieurs, ceux dont Montesquieu avait connaissance au moment où il écrivait. Il est frappant de voir que des empires immenses ont souvent été défaits par des peuplades moins nombreuses et souvent moins civilisées que celles que l’empire réunissait.
Rappelons-en les expériences les plus mémorables : l’empire romain détruit par les invasions barbares, les vikings malmenant la France occidentale, la Chine envahie par Gengis Khan, les Aztèques et des Incas à la merci des Espagnols, l’empire moghol progressivement conquis par les Anglais.
La fragilité paradoxale de grands empires est un constat récurrent de l’histoire. Elle semble avoir trois explications principales.
La première est la difficulté soulignée par Montesquieu à réagir avec promptitude à une attaque extérieure, surtout lorsque les attaques sont le fait d’initiatives décentralisées comme dans le cas de certains des exemples précédents.
La deuxième est le manque de cohésion des sociétés impériales qui tiennent davantage par la répression et la terreur qu’elles inspirent que par une adhésion des populations.
La dernière est la limite des capacités à nourrir et/ou à faire fonctionner une armée nombreuse avant l’époque moderne. Même si l’empire dispose théoriquement de ressources sans comparaison avec celles du minuscule adversaire qui l’agresse, le différentiel sera bien moins important sur le champ de bataille.
Les politiques de conquêtes et leurs conséquences
L’étendue d’un territoire étant en relation avec régime politique et capacité à en préserver l’intégrité, et la conquête consistant en une extension territoriale, les conséquences d’une telle politique découlent directement de ces principes.
Ainsi, à terme, la conquête peut remettre en cause la forme républicaine ou monarchique du gouvernement :
« Que si la propriété naturelle des petits États est d’être gouvernés en république, celles des médiocres d’être soumis à un monarque, celle des grands empires d’être dominés par un despote : il suit que, pour conserver les principes du gouvernement établi, il faut maintenir l’État dans la grandeur qu’il avait déjà ; et que cet État changera d’esprit, à mesure qu’on rétrécira ou qu’on étendra ses limites. »
Les monarchies conquérantes doivent faire face à deux périls principaux. D’une part, pour préserver leur cohérence interne contre le risque de sécession, elles seront contraintes d’adopter insensiblement des pratiques despotiques seules adaptées à un territoire très étendu comme il a été montré dans la première partie. D’autre part, le territoire intermédiaire qui leur est naturel étant le plus facile à défendre, les monarchies expansionnistes risquent de s’exposer plus facilement aux agressions étrangères :
« Si une monarchie peut agir longtemps avant que l’agrandissement l’ait affaiblie, elle deviendra redoutable, et sa force durera autant qu’elle sera pressée par les monarchies voisines. »
« La vraie puissance d’un prince ne consiste pas tant dans la facilité qu’il y a à conquérir que dans la difficulté qu’il y a à l’attaquer, et si j’ose parler ainsi, dans l’immutabilité de sa condition. Mais l’agrandissement des États leur fait montrer de nouveaux côtés par où on peut les prendre.
« Ainsi, comme les monarques doivent avoir de la sagesse pour augmenter leur puissance, ils ne doivent pas avoir moins de prudence, afin de la borner. En faisant cesser les inconvénients de la petitesse, il faut qu’ils aient toujours l’œil sur les inconvénients de la grandeur. »
Mais aussi :
« Toute grandeur, toute force est relative. Il faut bien prendre garde qu’en cherchant à augmenter la grandeur réelle, on ne diminue la grandeur relative.
Lorsqu’on a pour voisin un État qui est dans sa décadence, on doit bien se garder de hâter sa ruine, parce qu’on est, à cet égard, dans la situation la plus heureuse où l’on puisse être; n’y ayant rien de si commode pour un prince que d’être auprès d’un autre qui reçoit pour lui tous les coups et tous les outrages de la fortune. Et il est rare que, par la conquête d’un pareil État, on augmente autant en puissance réelle qu’on a perdu en puissance relative. »
Outre le fait que l’agrandissement n’est pas compatible à terme avec la démocratie comme indiqué dans la première partie, les démocraties conquérantes sont exposées à un risque spécifique :
« Si une démocratie conquiert un peuple pour le gouverner comme sujet, elle exposera sa propre liberté, parce qu’elle confiera une trop grande puissance aux magistrats qu’elle enverra dans l’État conquis. »
Montesquieu donne l’exemple de Carthage. En effet, au moment des campagnes d’Hannibal contre Rome, le Sénat carthaginois avait refusé tout secours à Hannibal par crainte du danger qu’il représentait pour la République.
De nombreux exemples historiques donnent une leçon comparable.
À Rome, curieusement ignorée par l’écrivain, l’expansion contribua de plusieurs façons à l’écroulement des institutions républicaines. L’arrivée de nombreux esclaves fragilisa d’abord les petits propriétaires incapables de concurrencer les grandes propriétés esclavagistes. Cette paupérisation des masses favorisa à long terme l’opposition entre optimates et populares, terreau des guerres civiles. Plus tard, les victoires de César furent l’appui de sa conquête du pouvoir. Enfin, Octave et Antoine reprirent partiellement au cours de leur affrontement les projets expansionnistes de César avant que la victoire du premier ne scelle définitivement l’expérience républicaine.
Le principat d’Auguste ne serait pas le seul exemple de remplacement d’une république par un empire dirigé par un conquérant dont les exploits resteront dans les mémoires et le premier empire ne serait pas non plus le seul cas dans l’histoire de France où des institutions républicaines seraient mises en péril par des opérations extérieures. Elles le furent par deux fois lors de la guerre d’Algérie : lors de la crise précédant la naissance de la Vème république et moment de la tentative de coup d’État des généraux. La différence est que l’Algérie avait été conquise depuis plus d’un siècle et que le but de guerre était de conserver la colonie mais la menace représentée par le pouvoir militaire n’en était pas moins réelle.
La militarisation du Japon au cours des années 1930 est, dans une certaine mesure, une répétition du phénomène. Compte tenu de la place réservée à l’empereur par la constitution de 1889, le régime n’était certes pas une république et aurait pu être qualifié de démocratie autoritaire. Il reste que la politique du fait accompli adoptée par des militaires japonais au moyen de conquêtes que le pouvoir civil dut couvrir a posteriori, détruisit complètement l’esprit des institutions démocratiques et l’État de droit japonais. Malgré les élections les postes ministériels furent confiés de plus en plus exclusivement à une armée concentrant tous les pouvoirs et soutenue par une population fanatisée par des succès trop faciles.
On aurait tort de ne voir que la recherche d’une érudition gratuite dans l’étude des observations formulées par Montesquieu. Elles peuvent fournir des leçons pour le présent.



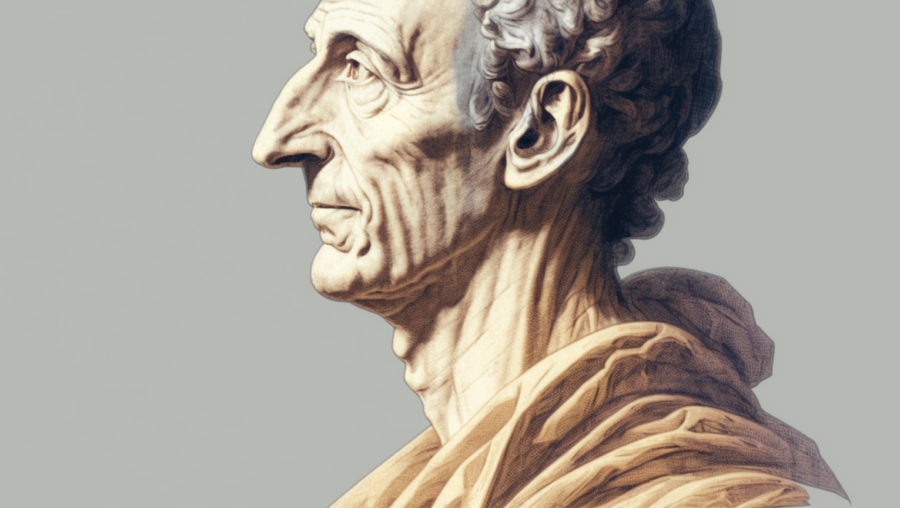
« Si une république est petite, elle est détruite par une force étrangère ; si elle est grande, elle se détruit par un vice intérieur. »
La réflexion sur la taille ne me paraît pas obsolète. Les républiques européennes les plus abouties sont souvent des pays peu peuplés et sans menace extérieure.
Et le vice intérieur (la corruption pour l’Inde, l’oligarchie corporate pour les US) sont effectivement de très dangereuses menaces pour les grands pays.
« Je parle de la République fédérative. Cette forme de gouvernement est une convention, par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d’un État plus grand qu’ils veulent former. C’est une société de sociétés qui en font une nouvelle qui peut s’agrandir par de nouveaux associés (…) »
Les fédéralistes européens feraient bien de s’inspirer de ce texte. L’unité politique élémentaire du nouvel ensemble n’est pas l’individu, d’autant plus isolé, ignoré et méprisé que le nouveau moloch devient monstrueux. Le « citoyen » de cette république fédérative est le corps social, la société. Bref, le « citoyen » dont il est question n’est autre que l’Etat national, médiateur indispensable, dans l’ensemble confédéral, entre les institutions supranationales et les individus.
Les Européens sont très cohérents à ce sujet et leur sagesse populaire est remarquable. Ils plébiscitent les institutions européennes tant qu’elles apparaissent comme des contre-pouvoirs aux pouvoirs nationaux. Ils rejettent fermement les institutions européennes quand elles menacent de devenir de nouveaux pouvoirs sans contrepoids, nouveau despotisme hors de contrôle.
qui peux dire ou informer ce qui se passe au parlement Européen ??
aucun débat. ..nous sommes mis devant le fait accompli…et pourquoi…il faut 10 ans pour mettre en application ..donc quand vous êtes Ministre …vous n’êtes pas concerné, le dossier est mis en dernier..
et puis un beau jour le dossier refait surface…
précipitation ,sinon astreinte financières. .