Par Emmanuel Brunet Bommert.

Un gouvernement est comme un mauvais génie et l’on s’imagine, à tort, qu’il n’écoute jamais ce qu’on lui demande, notamment dans les grandes démocraties. L’idée que nous nous faisons de l’autorité est marquée par nos préjugés : une force politique est tout au contraire particulièrement attentive aux sollicitations. Toutefois, comme toute machine, la façon dont l’information va être interprétée diffèrera grandement de ce que nous voulons, du fait que la plupart des désirs humains sont formés de non-dits.
Le pouvoir est un mécanisme qui se forme par les volontés divergentes, mais justifiables, de ses constituants. En conséquence, même le dirigeant le plus corrompu garde en lui ce naïf espoir d’être reconnu comme un héros populaire, qui a changé le quotidien de ses semblables pour le mieux1. Ce n’est qu’après un long cheminement d’échecs que la naïveté laisse finalement sa place à un certain cynisme quant à la moralité humaine. Comme toute autre personne en de semblables circonstances, le gouvernant ne peut accepter que ses agissements soient rejetés avec autant de fermeté, car il s’estime être bienveillant. C’est, en effet, un trait commun que de considérer nos bonnes actions comme fondamentalement justifiées.
Seulement, même nos actes les plus généreux peuvent, dans nombre de circonstances, s’avérer tout à fait nuisibles. Le rêve d’héroïsme est une drogue, dont le personnage de pouvoir peut difficilement se passer, du fait que l’exercice d’une charge réclame une force de volonté hors du commun. L’illusion d’avoir été utile est un puissant moteur, qui fait barrage au sens commun le plus élémentaire. Pour tout cela, celui qui dispose de puissance peut réaliser l’improbable : il est effectivement semblable au mauvais génie, dont la moralité est au-delà de la raison.
Ceux qui désirent ardemment qu’on exauce un vœu ne connaissent pas, la plupart du temps, le prix qu’il faut payer ni même ce qu’implique sa réalisation. Ils sont semblables à des enfants qui veulent quelque chose sans pouvoir le formuler, mais insistent tout de même à l’obtenir. L’autorité offre un résultat conforme à ce qu’on lui demande, sans prendre en compte les nécessités ni les motivations du demandeur : c’est effectivement une machine, qui agit comme telle.
Si l’on vient pour de la sureté, elle éliminera toutes les causes de danger, y compris celles qui sont nécessaires à la survie. Si l’on recherche une existence confortable, elle réagira en fournissant l’essentiel et dépouillera tout ce qui ne lui semblera pas indispensable à cet effet, pour le financer. Qu’importe le souhait, au final : il sera exécuté mécaniquement, sans profondeur ni nuances. Tous ceux qui ont exercés des demandes s’estiment dès lors floués, lorsqu’ils réalisent finalement. Toutefois, qui est le plus responsable entre celui qui promet d’accomplir toutes les convoitises et celui qui réclame un miracle sans se soucier des conséquences ?
La société n’est qu’un reflet de ses membres : elle reproduit vices et vertus en portant bien haut valeurs comme désirs. Or, il y a chez tout un chacun une volonté de reconnaissance, d’être compris et accepté par le reste de la communauté. C’est moins une soif de gloire qui nous anime, qu’un profond désir de se voir traités selon l’importance que nous estimons détenir. C’est pourquoi il n’est pas anormal que nous représentions nos divinités comme des créatures omniscientes : nous devons exister aux yeux du monde, sans quoi nul jugement n’est possible, autant pour ce que nous faisons de bien que pour ce que nos ennemis font de mal. L’idée même de « karma », de « paradis » ou « d’enfer » implique une surveillance totale de la population humaine.
Il s’en fait beaucoup pour rêver que le chauffard soit immédiatement appréhendé pour son comportement, afin de lui « faire comprendre » comment marche le monde. Une telle chose n’est réalisable que si l’autorité politique peut observer l’immoralité, avant même de pouvoir la condamner. Nos fantasmes nous conduisent à souhaiter pour ceux de notre entourage, qui contrarient nos sentiments, une sanction pour leurs actes. Toutefois, quel jugement sortirait d’une telle requête ?
Pour la nature qui nous entoure, la moralité humaine est un concept indéfinissable, abstrait. Le monde est bâtit sur des lois et ne s’attarde pas sur les complexes moraux d’une espèce particulière : soit la règle est respectée soit elle est enfreinte. Celui qui s’essaye à une conduite contre-nature est pulvérisé dans sa tentative, c’est là l’impitoyable limite morale de notre univers.
La société n’est pas différente, sans être semblable : elle réagit à notre égard avec autant d’indifférence qu’un arbre ou une montagne, du fait qu’il s’agit d’une mécanique et non d’une divinité. Aussi, si nous souhaitons à ce point que nos semblables payent pour leurs fautes et que nous soyons récompensés pour nos actions, le pouvoir répondra à ce vœu. Il s’imagine parfaitement capable de prendre cette place, puisque nous lui en concédons volontiers les attributions d’un dieu. Or, pour qu’une autorité puisse atteindre ce degré de puissance, elle doit avoir un accès illimité au savoir.
C’est ainsi que naît la surveillance de masse : nous l’appelons continuellement de nos vœux et forçons presque la main du gouvernement, en offrant à ses dépositaires un luxe d’héroïsme facile. L’autorité agit tel que nous le réclamons et si nous souhaitons jeter nos semblables aux gémonies à chaque incartade morale, l’Homme de pouvoir n’aura pas grande hésitation à s’y résoudre, tant une promesse de gratitude est alléchante.
Lorsque nous rêvons de punitions ou de récompenses, c’est que nous ne brillons pas par notre volonté à changer, sinon que nos aspirations ne sont pas aussi vertueuses que nous le professons. Le mépris, la mesquinerie, ont plus d’impact que la soif de justice et souvent, cette dernière n’est qu’une excuse à l’assouvissement de nos plus basses convoitises. Il se fait des légions qui, chaque jour, vivent du fantasme de voir leurs collègues souffrir pour des « infractions » imaginaires.
Celui qui a assez de volonté pour prendre ses responsabilités durant sa vie ne craint pas ce qui est maléfique : il produit assez de bienfaisance pour son usage personnel. Seule la personne qui n’a pas de courage en la matière vit insatisfaite, perpétuellement tiraillé par un besoin dévorant de « bien », dont le prix reviendra aux supposés coupables de ses malheurs. La société est flexible, puisque fondée sur la confiance : retirez-là simplement des gens les plus méprisants et l’on pourrait alors observer qu’ils sont prompts à se corriger.
Ceux qui n’agissent pas ne peuvent que désirer : l’autorité est très attentive à cette catégorie spécifique de la population, particulièrement prolixe en matière de dédommagements, afin de lui offrir ce qu’elle demande. Si ce corps souhaite que les petits maux du quotidien soient châtiés à la hauteur d’un crime, alors le pouvoir réagira2. Tout d’abord, il lui faut la connaissance : c’est la surveillance d’état. Quelques années seulement suffisent pour la mise en place d’une police spécialisée dont la tâche consistera, pour l’essentiel, à déterminer une culpabilité purement morale. Enfin, la conclusion logique consiste à l’instauration d’une procédure de rétorsion contre les « coupables ».
Le pouvoir politique n’a rien de divin, il se manifeste par la seule action humaine. Ce que demandent les bruyantes petites voix doit être financé et s’appliquera au mépris de toutes autres considérations. Les résultats n’auront plus grand-chose à voir avec ce que désiraient tant ceux qui ont imploré de leurs vœux, avec insistance. Cette population qui rêvait déjà de châtiments pour les actions de ses frères sera rappelée à l’ordre, tous les jours, pour ce qu’elle-même commet à l’égard de ses semblables. Le « meilleur des mondes » s’est brutalement métamorphosé en « 1984 ». Car l’administration demeure cet appareil incapable d’appréhender le concept de vertu : aux yeux d’un État tout est aussi coupable qu’innocent.
Ce qui va constituer la morale « acceptable » peut changer en un coup de vent, du jour au lendemain. Les masses qui s’imaginèrent en idéals de pureté, deviendront rapidement l’incarnation du mal. Elles seront punies sur la base d’un système de valeur qu’elles rejettent, mis au banc selon une norme qui n’est pas la leur, pour avoir outrepassées quelque chose qui n’est en rien délictueux. Tout cela, dans le strict respect d’une législation qu’elles supposèrent incorruptible.
Avant la venue de ce jour, personne ne peut réellement estimer ce qu’implique un souhait de cette nature, prononcé auprès du plus dangereux de tous les génies : l’administration humaine. Nous sommes bien incapables de réaliser l’évidence d’un tel danger : tout ce que nous voulons pour autrui, d’autres espèrent aussi nous l’infliger. Car dès l’instant où nos désirs les plus coupables deviennent une doctrine du pouvoir, il en sera ainsi de celle des autres et qu’entre deux, la plus violente l’emporte toujours.
- La plupart des grandes figures historiques n’ont pas déployées une telle force de volonté dans le seul but de satisfaire à leur appétit matériel : pour se faire empereur, il faut un fanatisme allant de pair avec un idéal. ↩
- La société « en réseau » telle que nous la connaissons à l’ère d’Internet, fut déterminante dans l’acceptation populaire d’une police de la pensée. Après tout, nous passons chaque jour à désirer ardemment que les mauvaises paroles que nos semblables écrivent soient punies et, par là, nous acceptons bien plus aisément l’idée qu’elles puissent effectivement l’être. ↩




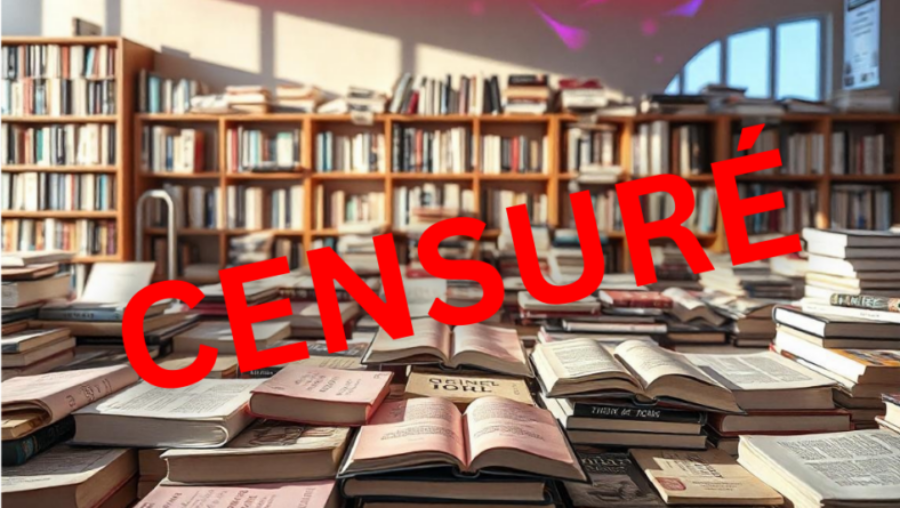
J’ai beaucoup apprécié ce chapitre :
“Celui qui a assez de volonté pour prendre ses responsabilités durant sa vie ne craint pas ce qui est maléfique : il produit assez de bienfaisance pour son usage personnel. Seule la personne qui n’a pas de courage en la matière vit insatisfaite, perpétuellement tiraillé par un besoin dévorant de « bien », dont le prix reviendra aux supposés coupables de ses malheurs. La société est flexible, puisque fondée sur la confiance : retirez-là simplement des gens les plus méprisants et l’on pourrait alors observer qu’ils sont prompts à se corriger.”