Par Gérard-Michel Thermeau.

Trois générations de Cavaignac ont joué un rôle lors des trois premières républiques françaises, illustrant ce paradoxe des dynasties républicaines dont se moquait Sacha Guitry. Un conventionnel n’avait-il pas déclaré le 15 février 1792 : « Toute hérédité politique est à la fois une violation de l’égalité naturelle et une institution absurde » ? Et pourtant Eugène Cavaignac (1802-1857) devait être élu député comme l’avait été son père et comme devait l’être son fils 1. « Il était républicain de naissance » notait à son propos Rémusat.
Si pour Alexis de Tocqueville, « c’est la seule grande figure qui se soit détachée sur le fond terne de la révolution de 1848 », même un biographe bienveillant, le général Ambert, devait reconnaître : « le général Cavaignac ne possédait pas une intelligence supérieure, brillante, forte et faite pour dominer. » D’ailleurs Tocqueville jugeait que son esprit « naturellement médiocre et obscur » n’était pas à la hauteur de son âme. Seules les circonstances ont fait, pour un temps, de ce militaire compétent mais terne le maitre de la république. « Mes héros, disait-il, sont Vauban et Desaix, deux modestes qui travaillent beaucoup et parlent peu. » On est loin de Napoléon Bonaparte avec ce pâle personnage, charismatique comme une huitre, et qui n’a guère inspiré de biographes.
Il était le fils d’un avocat jacobin : son père, Jean-Baptiste, avait siégé à la Convention puis aux Cinq Cent. Comme d’autres jacobins, il avait été anobli et fait préfet sous l’Empire. Mais être le fils d’un régicide avait rendu difficile pour le jeune Eugène l’entrée à Polytechnique. Il avait un oncle général, dont le nom figure d’ailleurs sur l’Arc de Triomphe, qui avait fait les campagnes de la Révolution et de l’Empire. Il fut élevé par sa mère, son père étant exilé à Bruxelles : Julie de Corancez, issue d’une famille de bonne bourgeoisie marquée par les Lumières, était à la fois ardente catholique et ardente républicaine. Elle devait utiliser ses réseaux pour lever les obstacles dressés devant son fils dont les opinions déplaisaient nécessairement au régime des Bourbons.
Sous la Restauration, cet ardent républicain entre dans la Charbonnerie, organisation d’extrême gauche, et dans la franc-maçonnerie. Sorti sous-lieutenant de l’école militaire de Metz, il fait ses premières armes en Grèce contre les Turcs (1828-1829).
Ses opinions républicaines ne sont pas davantage appréciées sous la Monarchie de Juillet : son frère Godefroy était même une figure importante du parti républicain. Son colonel lui ayant, à la suite de quelques questions écrites sur ses projets de conduite, adressé l’interpellation suivante : « Si le régiment avait à se battre contre les républicains, vous battriez-vous ? » Il répondit : « Non ». « Il est à regretter, observe un biographe, qu’en 1848, M. Cavaignac ait oublié la réponse faite à son colonel en 1830. »
Il est envoyé en Algérie pour s’en débarrasser : c’est dans le cadre de la « pacification » qu’il va démontrer ses qualités d’officier, passant du génie à l’infanterie. Il va participer à la lutte contre le farouche ennemi des Français, l’émir Abd-El-Kader. Il se distingue comme colonel des zouaves (1841) écrivant à sa mère : « Je ne te parle pas des détails ; les détails de la guerre n’ont rien de bien reposant pour la pensée ». Une phrase qui en dit long sur la sauvagerie des opérations menées. Le maréchal Bugeaud, qui pourtant ne l’apprécie guère, fournit cette note sur le compte de son subordonné : « Eugène Cavaignac est un officier instruit, ardent, susceptible d’un grand dévouement, qui, joint à sa haute capacité, le rend propre aux grandes choses et lui assure de l’avenir, si sa santé n’y met obstacle. »
Il est fait maréchal de camp, c’est à dire général de brigade, en 1844. Il est ensuite chargé de la surveillance de la frontière avec le Maroc. La révolution de février 1848 le promeut gouverneur général de l’Algérie mais sa position de général républicain en fait surtout le meilleur candidat pour le ministère de la Guerre qu’il avait refusé dans un premier temps (17 mai 1848).
Il avait écrit à Lamoricière : « Je ne puis pas vous dire que je me rallie à la République. Je n’ai à vrai dire jamais eu à souffrir ni à lutter pour elle, mais j’ai toujours pensé que son jour viendrait, et ce jour-là, il était convenu avec moi-même que je lui donnerai tout ce que je puis avoir à donner. Je ne me rallie pas à elle, je m’y dévoue bien sincèrement sans exaltation comme sans calcul. »
Il n’a aucun talent politique, contrairement à son frère Godefroy, prématurément disparu, et aucun rayonnement : il est sévère, triste et froid, prêt à obéir à la République en soldat habitué à faire son devoir. Il avait néanmoins été élu député du Lot à l’Assemblée constituante. Il déclare à la tribune le 10 juin : « Je voue à l’exécration publique quiconque osera jamais porter une main sacrilège sur la liberté du pays ! »
En ce mois de juin 1848, Paris est au bord de l’explosion. Le gouvernement, entre les mains d’une commission exécutive, est dépassé par les événements. Les ouvriers se sont armés pour résister à la fermeture des Ateliers nationaux, que le gouvernement provisoire avait ouvert pour occuper les chômeurs victimes de la crise économique.
Les républicains modérés du National et les conservateurs du comité de la rue de Poitiers s’entendent pour confier le pouvoir à Cavaignac, le mot d’ordre devenant : un homme, un sabre, Cavaignac. Le 24 juin, l’Assemblée, menacée par l’insurrection toute proche, vote l’état de siège et délègue le pouvoir exécutif au général.
Après avoir hésité, Cavaignac est désormais résolu à écraser l’insurrection. Il fait afficher une proclamation aux ouvriers : « On vous trompe, on vous trompe indignement. […] Il n’y a pas de gloire à cette guerre, il y aurait de la joie, de l’honneur à vous ramener au sein de la république que vous brisez par vos violences. » Dans son adresse aux soldats le 25 juin, il écrit : « C’est une terrible, une cruelle guerre que celle que vous faites aujourd’hui… cette fois du moins vous n’aurez pas été de tristes instruments de despotisme et de trahison. » Ainsi la répression pouvait se faire en toute bonne conscience.
Instruit par les expériences de juillet 1830 et de février 1848 où l’émeute avait triomphé de l’armée, il laisse l’insurrection se développer et se fixer sur les barricades où il sera plus facile de l’écraser plutôt que de se perdre et se disperser dans d’interminables combats de rues. Il fait donner l’assaut le 25 juin et, en une matinée, il rétablit l’ordre. 11 journaux sont suspendus, le cautionnement (qui permet de contrôler la presse) est rétabli, 25 000 arrestations sont opérées.
Il adresse un message à l’Assemblée : « Il n’y a plus de lutte dans Paris ». Il y a gagné un surnom : « prince du sang ». Si la plupart des intelligences de l’époque approuve le bain de sang, George Sand note : « Je ne crois plus à l’existence d’une république qui commence par tuer ses prolétaires. » La violence de la répression va contribuer à jeter les ouvriers dans les bras du socialisme. Tocqueville, témoin et acteur de cette guerre civile, a parlé « d’un combat de classe, d’une sorte de guerre servile. »
Cavaignac a la décence de refuser le bâton de maréchal de France que lui offre l’Assemblée : il est vrai qu’avoir massacré les ouvriers après avoir enfumé les arabes n’avait rien de très glorieux.
Le 28, tel Cincinnatus, repoussant les suggestions de ceux qui souhaitent qu’il prenne le pouvoir, il remet la dictature temporaire qui lui avait été confiée mais l’Assemblée lui confie aussitôt la présidence du conseil des ministres. Il s’installe pour six mois à l’Hôtel Matignon. Mais la peur des « rouges » a donné un poids considérable aux conservateurs de la rue de Poitiers, ces « légitimistes » et « orléanistes » vaguement repeints en « républicains du lendemain ». Si Rémusat voit dans le général « en frac noir » « quelque chose de Washington », il est bien le seul. Victor Hugo ne rate pas l’occasion de se moquer du gouvernant raide et médiocre : « Le mot favori de Cavaignac est ‘Je le répète’. Il le dit vingt fois par minute. Homme indécis qui sent toujours le besoin de la recommencer. »
Il est le candidat officiel, l’homme des modérés et des notables lors de l’élection présidentielle, soutenu par l’administration et la majorité des journaux. Il est aussi le seul candidat qui croit sincèrement aux institutions de la Seconde république. Se réclamant de son père et de son frère, il proclame qu’il est un « bon républicain » tout en prenant des mesures qui achèvent de dresser contre lui les ouvriers : rétablissement de la journée de 12 heures, obligation du passeport pour les ouvriers désirant changer de département.
Il vote contre l’amendement qui vise à écarter Louis-Napoléon de l’élection présidentielle, persuadé qu’il l’emportera facilement contre ce personnage qui paraît encore plus terne que lui. L’électorat populaire et paysan, méfiant à l’égard des notables traditionnels, préféra cependant voter en faveur de Louis-Napoléon : Cavaignac n’obtint que 1 448 107 voix contre 5 434 226 en faveur du neveu de l’Empereur. Il feint de se consoler de sa défaite en déclarant : « nous avons vu une victoire remportée par le principe de la souveraineté populaire. »
Il se fait ensuite élire à l’Assemblée législative, siégeant à gauche parmi les républicains modérés, constamment hostile au président de la République. Au moment du coup d’État du 2 décembre, il est arrêté : « Le général est exaspéré. À la surprise a succédé la fureur. Les personnes qui ont beaucoup fait arrêter ne comprennent pas qu’on les arrête. Ce retour de la fortune bouleverse leurs idées. Tant d’audace les confond. » note sarcastique Hippolyte Castille. Il est envoyé au fort de Ham où avait croupi Louis-Napoléon Bonaparte. Le duc de Morny intercède en sa faveur : il demande sa mise en retraite et se retire sur ses terres, en Sarthe. À 49 ans, il se marie avec la fille d’un banquier, qui avait 30 ans de moins que lui, tombée éperdument amoureuse du héros vieillissant et morose.
Élu au Corps législatif par la Seine en 1852, il refuse le serment imposé aux députés et se voit donc considéré comme démissionnaire. Il est de nouveau choisi en 1857 et refuse pareillement de prêter serment. Mais ce courage politique ne suffit pas à en faire un symbole. Peu de temps après, il est pris de malaise au cours d’une partie de chasse et succombe d’un arrêt cardiaque. Cette mort insignifiante était à l’image de son existence. Il devait vite être oublié.
Sources :
- Pierre Givaudon, Bulletin de la SABIX, 48, 2011, p. 73-78
- Inès Murat, La Deuxième république, Fayard 1987
- Robert et G. Cougny, Dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889, E. Bourloton, 1889-1891
Prochain épisode : Boulanger
- Lire aussi sur Contrepoints : Les généraux de la République (I) : Bonaparte
- Godefroy Cavaignac devait être député et ministre sous la IIIe république ↩




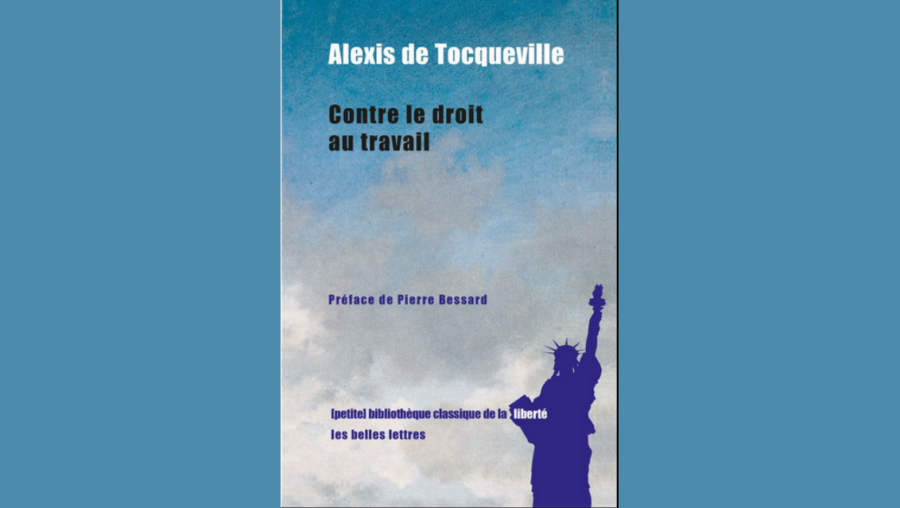
Typo dans le sous-titre : “Cavaillac”
Cavaignac, pas Cavaillac (dans le petit paragraphe introductif).
Cavaignac habillé pour l’hiver, et chaudement encore.
Merci!
Vote mon p’tit peuple !
Biographie convenue: “Cavaignac a la décence de refuser le bâton de maréchal de France que lui offre l’Assemblée : il est vrai qu’avoir massacré les ouvriers après avoir enfumé les arabes n’avait rien de très glorieux.”.
Les exploits militaires de Cavaignac en Algérie sont d’une autre réalité.
Il s’est toujours comporté en Homme d’Honneur, fidèle à son républicanisme,refusant les compromissions, ce qui n’est pas le cas de l’immense majorité de ses compagnons d’armes.
Et je vois qu’on va passer à Boulanger: pourquoi “sauter” Mac-Mahon, Président de la République?
Mac-Mahon n’a jamais eu la réputation d’un général républicain à la différence des autres.
La répression féroce de juin 1848 a fait dire à Louis-Philippe (je cite de mémoire) :
“La République a bien de la chance, qui a le droit de tirer sur le peuple !”