Par Jérôme Perrier.
 Pour ceux qui estiment que les sempiternelles ratiocinations de Michel Foucault, si courues dans les départements de philosophie et de science politique des universités du monde entier, n’épuisent pas la question du pouvoir, le livre de Moisés Naím, (The End of Power. From boardrooms to battlefield and hurches to states, why being in charge isn’t what it used to be, New York, Basic Books, 2013, 306 p.), devrait apparaître comme à la fois profondément iconoclaste, revigorant et roboratif.
Pour ceux qui estiment que les sempiternelles ratiocinations de Michel Foucault, si courues dans les départements de philosophie et de science politique des universités du monde entier, n’épuisent pas la question du pouvoir, le livre de Moisés Naím, (The End of Power. From boardrooms to battlefield and hurches to states, why being in charge isn’t what it used to be, New York, Basic Books, 2013, 306 p.), devrait apparaître comme à la fois profondément iconoclaste, revigorant et roboratif.
L’auteur, né en 1952 au Venezuela, est un économiste qui a occupé le poste de ministre du Commerce et de l’Industrie dans son pays natal à la fin des années 1980, avant de devenir l’un des directeurs exécutifs de la Banque mondiale. Il a aussi mené une carrière académique et une carrière de journaliste, en publiant dans de nombreux et prestigieux journaux du monde entier (El Pais, La Repubblica, The New York Times, The Washington Post, News Week, Time, etc.). En 1996, il est devenu rédacteur en chef du magazine Foreign Policy. Il est l’auteur de divers best-sellers qui lui ont valu plusieurs récompenses internationales (dont le « Prix Ortega y Gasset » en 2011) et qui lui ont aussi valu d’être classé à plusieurs reprises parmi les penseurs les plus influents de la planète1.
Son dernier livre, que nous présentons ici, a eu un écho considérable dans le monde entier. Il a été désigné par le Financial Times et le Washington Post comme l’un des meilleurs livres de l’année 2013, et il a été particulièrement remarqué par diverses personnalités mondialement connues, et surtout bien placées pour parler de la notion, au fond pas si évidente, de pouvoir. Ainsi, Bill Clinton a estimé que The End of Power « changera la façon dont vous lisez les journaux, dont vous pensez la politique et dont vous regardez le monde », tandis que Mark Zuckerberg a recommandé publiquement sa lecture en janvier 2015, renforçant ainsi l’écho déjà considérable que le livre avait acquis par ses propres mérites. Toutefois, mais nul ne s’en étonnera, ce titre, comme tous ceux de Moisés Naím, n’a pas été encore publié en français, et ne le sera vraisemblablement jamais ; ce qui témoigne une fois de plus du profond syndrome obsidional qui affecte la scène intellectuelle, et malheureusement trop souvent académique, française.
Il est vrai que l’ouvrage va à l’encontre de tous les poncifs qui saturent à longueur de journées les colonnes, les ondes et les écrans hexagonaux, par un perpétuel ressassement contre la mondialisation « qui corrompt, qui achète, qui écrase, qui tue, et qui pourrit jusqu’à la conscience des hommes » (pour reprendre la célèbre formule mitterrandienne, qui visait alors l’argent en général). D’abord, le livre de Moisés Naím fourmille littéralement d’exemples concrets et de chiffres puisés aux sources les plus fiables, qui tous ou presque vont à l’encontre de l’image manichéenne que l’on donne en France d’un phénomène aussi complexe, et donc forcément contrasté, que ce que les anglo-saxons appellent Globalization. Sans entrer dans les détails (on pourrait citer des centaines d’exemples égrainés au fil du livre), l’auteur de The End of Power rappelle ce que tout le monde sait, au moins en dehors de l’Hexagone ; à savoir que la mondialisation des trente dernières années a permis, comme jamais auparavant dans l’histoire, à des centaines de millions, voire des milliards d’individus de par le monde, de sortir de la pauvreté, d’être mieux soignés, de vivre plus longtemps, d’être plus éduqués, etc…. ce qu’il appelle la « Révolution du More ». L’auteur ne dit évidemment pas que la pauvreté a disparu de la planète, mais il rappelle que jamais dans l’histoire les progrès économiques, sanitaires et techniques n’ont touché une telle masse de gens, et si rapidement. Et pour ceux qui le soupçonneraient de vouloir donner une image idyllique et biaisée de la réalité, je précise que Naím ne néglige aucunement certains aspects de la mondialisation qui, en France, paraissent rédhibitoires, comme la croissance de certaines inégalités (aux États-Unis notamment). Mais là ne réside pas l’intérêt majeur du livre, et surtout son caractère novateur. En évoquant d’emblée ces aspects, finalement secondaires, du propos de l’économiste vénézuélien, nous tentions simplement d’indiquer l’une des raisons pour lesquelles son livre n’a à peu près aucune chance de séduire un vaste public français, inondé du matin au soir par le psittacisme anti-mondialisateur qui fait malheureusement trop souvent office de pensée dans la patrie de Descartes…
L’intérêt profond et la grande nouveauté du livre de Moisés Naím réside en réalité ailleurs. Il réside dans la thèse principale qui le structure : à savoir, que contrairement à ce que l’on pourrait penser, le pouvoir, sous toutes ses formes, après avoir atteint son apogée au XXème siècle, connaît aujourd’hui un déclin, aussi radical que sous-jacent, et qui n’est d’ailleurs pas dénué de tout danger. Un tel argument est toutefois suffisamment contre-intuitif pour mériter quelques plus amples explications. Moisés Naím part d’abord d’une définition du pouvoir qui est assez extensive :
« Le pouvoir, écrit-il, est la capacité de dicter ou d’empêcher les actions présentes ou futures d’autres groupes ou individus » (p. 16).
Dès lors, loin de se cantonner au pouvoir politique ou militaire, Naím s’intéresse aussi de très près au pouvoir économique et culturel. De même, l’auteur ne se cantonne pas à ce que les politologues ont naguère baptisé le « hard power » (le pouvoir de contrainte, dont la forme la plus pure est le pouvoir militaire), mais il considère aussi le « soft power » (le pouvoir d’influence), dont la mesure exacte est bien entendu beaucoup plus délicate. S’inspirant de travaux célèbres (M. Weber) ou moins connus (MacMillan), Moisés Naím distingue quatre vecteurs de pouvoir : ce qu’il appelle le « Muscle » (le pouvoir de coercition) ; le « Code » (l’autorité des valeurs morales, au sens large) ; « l’Argumentaire » (« The Pitch », ou pouvoir de persuasion, de séduction), et enfin la « Récompense » (« The Reward », ou pouvoir d’incitation). Il s’agit là, bien entendu, d’idéaux-types qui, dans la réalité, sont toujours mélangés, dans une combinaison d’influence, d’autorité et de coercition qui définissent les modalités constamment mouvantes du pouvoir.
Une fois posées ces définitions préalables, l’auteur de The End of Power développe sa thèse et l’applique aux différents champs de l’activité humaine : la guerre, la politique, l’économie, le monde de la culture et de la philanthropie, etc. Et Moisés Naím montre que dans chacun de ces domaines, le pouvoir devient de plus en plus facile à acquérir, mais aussi de plus en plus difficile à exercer et à conserver. Dans une sorte d’allégorie, il commence son livre en développant l’exemple du monde des échecs, où les mutations de la compétition internationale sont comme une métaphore du phénomène général qu’il entend mettre en valeur ; à savoir des champions venus d’horizons de plus en plus variés, sur le plan géographique comme sur le plan social, et conquérant des titres de plus en plus précaires. Ensuite, à l’aide d’une multitude d’exemples, parfois anecdotiques mais toujours extrêmement parlants, Moisés Naím montre qu’alors que le XXe siècle aura été le siècle du Big-is-beautiful-and-powerful (« la taille entraîne le pouvoir et vice versa », p. 38), le XXIe siècle voit au contraire l’émergence de micro-pouvoirs qui concurrencent de plus en plus les géants en place, les supplantant parfois, avant d’être eux-mêmes concurrencés par de nouveaux entrants. Au Big Government, au Big Business, ou au Big Labor (bref aux grandes bureaucraties qui ont connu leur heure de gloire au XXe), succèdent ainsi des structures plus légères, qui sont d’autant plus redoutables qu’elles sont précisément plus souples et plus adaptables.
Depuis les guerres asymétriques (où les plus puissantes armées du monde peuvent être mises en échec par des bandes de mercenaires qui les harcèlent tels des moustiques faisant fuir un éléphant), jusqu’aux start-ups (qui en quelques années peuvent dépasser, voire absorber, des entreprises géantes qui s’étaient endormies sur leurs lauriers), en passant par les États (où de petits acteurs brouillent le classique concert des grandes puissances qui régentaient depuis plusieurs siècles les relations internationales), un même phénomène est à l’œuvre, rendant le monde à la fois singulièrement plus complexe et plus instable. Ce phénomène, qui brouille l’image d’une réalité devenue de plus en plus insaisissable, c’est l’affaissement des barrières qui jusque-là protégeaient ce que l’auteur appelle les « incumbents » (c’est-à-dire les « titulaires », ou encore les insiders, qui possèdent le pouvoir dans le système présent et font tout pour le garder et fermer la porte derrière eux), face aux assauts des « candidates » (c’est-à-dire les outsiders, les aspirants, bien décidés à tenter leur chance et à se faire une place au soleil).
La grande idée de Moisés Naím, c’est que la mondialisation se traduit, dans toutes les sphères où les hommes interagissent, par une érosion des barrières que cherchent immanquablement à dresser les pouvoirs en place pour se protéger des assauts d’acteurs de plus en plus nombreux et de plus en plus habiles à contester toute prétention au monopole du pouvoir (depuis les membres du G8 désireux de régenter entre eux l’ordre mondial jusqu’aux grandes entreprises aspirant à contrôler un marché, pour le rendre captif). Le constat de l’échec croissant de ces insiders à bloquer les outsiders (un échec qui conduit à rendre le pouvoir à la fois plus facile à acquérir et plus difficile à exercer et à conserver) est vrai du monde économique, où aucune domination du marché n’est jamais acquise (une idée que les lecteurs familiers de Mises et des autrichiens trouveront familière), comme du monde politique, où les gouvernants ont de moins en moins de prise sur les événements, réduisant trop souvent la vie politique à une sorte de scène de théâtre où l’agitation frénétique des acteurs a toutes les peines du monde à masquer leur profonde impuissance à changer la réalité. Ici, le propos de Naím est d’autant plus intéressant qu’il sait concrètement de quoi il parle, ayant lui-même, dans ses diverses carrières, côtoyé de très près les acteurs globaux, qu’ils soient gouvernementaux ou appartenant au monde des grandes entreprises.
Bien entendu, l’auteur de The End of Power relie le phénomène qu’il décrit à des évolutions bien connues, à commencer par la révolution technologique, et notamment internet. Mais justement, l’intérêt du livre réside en ceci qu’il ne se focalise pas uniquement sur la révolution du net et ne se contente pas de reprendre des idées déjà abondamment développées par d’autres. Son propos est bien plus ambitieux et prend en compte des évolutions beaucoup plus générales, à commencer par ce que Naím appelle les trois révolutions et transformations « qui définissent notre temps » (p. 11) : la « Révolution du Plus » (« the More revolution », comme la croissance économique et la croissance démographique ») ; la « révolution de la Mobilité » (« the Mobility revolution », c’est-à-dire l’explosion des échanges affectant les marchandises, les hommes, les capitaux et les informations) ; et enfin la « révolution des Mentalités » (« the Mentality revolution », à savoir les bouleversements des valeurs engendrés par les deux révolutions précédentes. Pour mieux mesurer la pertinence et l’intérêt de cette fertile grille de lecture (il n’est pas un jour où l’actualité n’apporte une kyrielle d’illustrations nouvelles du propos de l’auteur), nous renvoyons au tableau synthétique que Naím dresse à la page 72 de son livre, et que nous traduisons à la fin de cet article.
Ces quelques lignes, bien entendu, n’épuisent pas l’immense richesse d’un livre, qui impressionne à la fois par la force de son idée maîtresse et par la diversité des exemples qu’il développe à l’appui de cette thèse iconoclaste. Sa lecture est donc urgente pour tous ceux qui tentent – forcément avec difficulté – d’y voir un peu plus clair dans une mondialisation complexe, porteuse d’opportunités évidentes, mais également d’incertitudes. Ainsi, l’auteur de The End of Power ne cache pas que le phénomène qu’il identifie n’est pas sans l’inquiéter, dans la mesure où il voit dans la dissolution du Pouvoir avec un grand P un authentique risque d’anarchie, notamment dans le domaine des relations interétatiques, où la notion d’ordre international semble de plus en plus précaire. D’autres, de tendance libertarienne, pourront au contraire s’en réjouir, ou tout au moins considérer qu’après le siècle des totalitarismes, l’érosion du Big Power est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est sûr en tous les cas, c’est que ce livre roboratif est une invitation à penser la complexité du monde, loin des jugements manichéens de trop nombreux intellectuels français, perdus dans les subtilités byzantines de l’exégèse foucaldienne, ou dans les diatribes démondialisatrices, qui ne sauraient mener beaucoup plus loin que la simple indignation. Le regretté Jean-François Revel avait coutume de dire qu’un bon cours de démographie apprenait plus de choses sur le monde que toutes les ratiocinations d’Heidegger. J’ai envie de dire que quelques pages de Naím vous apprendront plus sur le monde que bien des ratiocinations médiatico-académiques.
- Moisés Naím, The End of Power. From boardrooms to battlefield and hurches to states, why being in charge isn’t what it used to be, New York, Basic Books, 2013, 306 p.
—
- Ainsi, en 2013, le magazine britannique Prospect le considère « as one of the world’s leading thinkers », tandis qu’en 2013 l’Institut Gottlieb Duttweiler le range parmi le « top 100 influential global thought leaders ». ↩

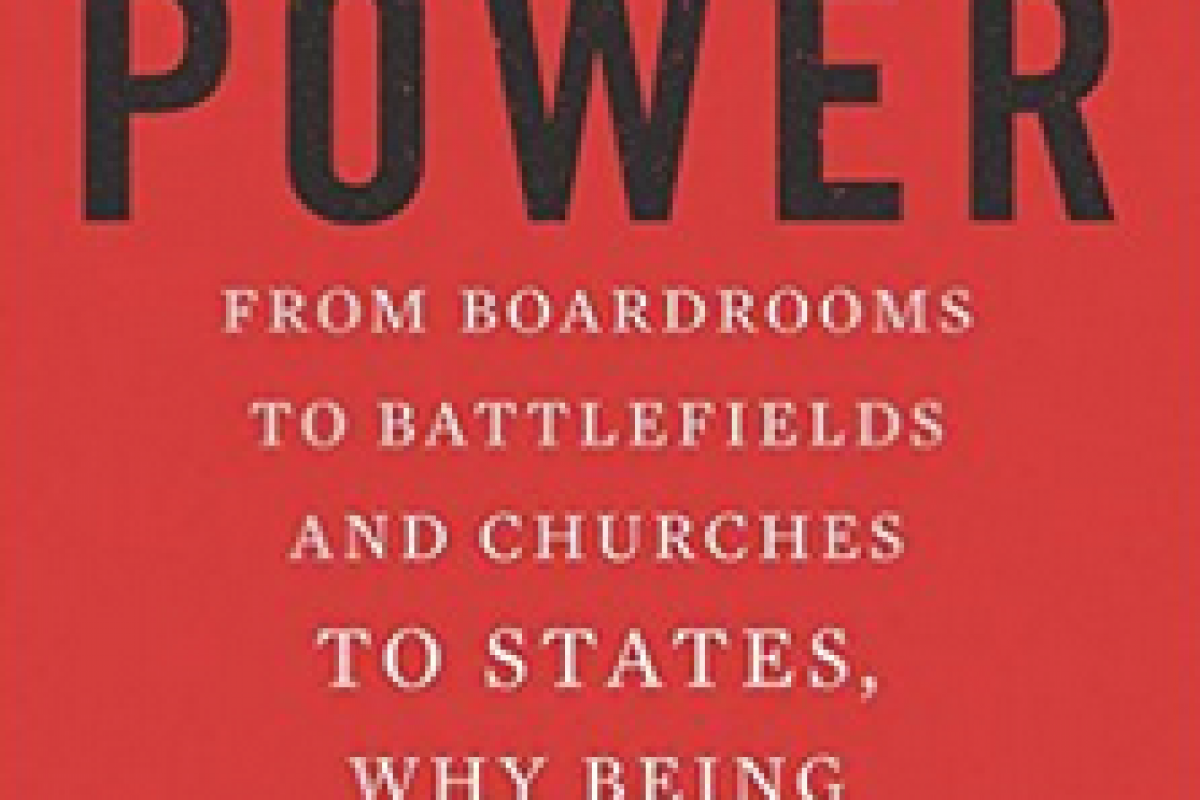


Thèse trèèèès intéressante ! Et qui s’inscrit dans la thématique de “Antifragile” développée par Nassim Taleb. Ce phénomène est une très bonne nouvelle, et je ne crois pas un seul instant que l’éclatement des grands pôles de pouvoir causerait “l’anarchie”, terme impropre qu’on devrait d’ailleurs remplacer par “chaos” ou “anomie” dans ce contexte.
Je pense au contraire que ce phénomène peut nous sauver de “révolutions”, de mouvements de révoltes et de guerres civiles face à des états, des grands groupes, ou de puissants lobbies qui cherchent à maintenir leur pouvoir en multipliant toujours plus les lois, coercitions et autres abus liberticides.
Ces “grands machins”, comme l’état français en est un des plus éminents exemples, multiplient les actions, les lois et règlements pour imposer leur domination, et deviennent comme des constructions toujours plus complexes, toujours plus rigides, qui offrent autant de points de fragilités, que des petits groupes d’individus déterminés peuvent exploiter pour s’y frayer une voie, et saper petit à petit l’ensemble de la structure.
Le 1er exemple concret qui me vient pour illustrer cela est le combat des libérés contre le RSI: le mammouth, puissant et massif, peut facilement écraser un individu isolé et non informé. Mais le combat de cette association d’individus déterminés est comme une nuée de guêpes qui se faufile dans toutes les incohérences et failles du code législatif qui le régit, et contre lequel il ne pourra rien. La guérilla a commencé, banzai!
Il est à craindre que la fin du pouvoir ne soit pas pour tout de suite en France: le livre et… la réalité!