Par Éric Verhaeghe.

Quelles sont les frontières technologiques que les entreprises françaises doivent atteindre ?
Comme le souligne l’excellent Guillaume Sarlat, la France s’est largement polarisée sur les frontières ouvertes par Uber et les plateformes collaboratives. Nombreux sont les managers, spécialement dans les grands groupes, qui rêvent « d’ubériser » leur marché et, pour y arriver, de transformer l’entreprise qu’ils dirigent en une startup qui repartirait d’une page blanche pour réinventer des produits.
Pour Guillaume Sarlat, l’enjeu des grandes entreprises serait moins de conquérir ce Graal que d’être capable, à l’instar de Free, d’injecter de l’innovation, créée ailleurs et le plus vite possible, dans les processus de production. Cette distinction entre le processus Uber et le processus Free illustre bien l’angoisse dont la France et ses grandes entreprises sont parcourues face à la distance qui les séparent des nouvelles frontières technologiques.
Uber, Free et la frontière technologique
De fait, Uber et Free incarnent bien deux distances très différentes face à la frontière technologique.
Uber a incontestablement modifié le visage traditionnel de la frontière technologique. Jusqu’ici, l’innovation technologique était matérielle. On inventait une locomotive à grande vitesse, un nouveau matériau, un nouvel avion, un nouveau processeur, un nouveau robot ménager. L’entreprise en déposait le brevet et pouvait l’exploiter comme elle l’entendait.
Avec Uber, l’innovation n’est plus matérielle mais immatérielle. Uber conçoit un nouveau marché, une nouvelle façon de vendre, et développe un code qui est la seule réalité matérielle d’une innovation dont l’essence est d’être immatérielle. Les lignes de code de l’application Uber sont la seule trace du patrimoine immatériel que l’entreprise disruptive crée pour bousculer son marché. Cette particularité souligne bien que la disruption se situe beaucoup moins, désormais, dans le produit lui-même que dans la conception du produit et dans la conception du marché qui permettra de l’exploiter.
Dans le secteur des télécommunications où a opéré Free, le processus de disruption fut, d’une certaine façon, du même ordre. Free a eu le pressentiment que les consommateurs étaient à la recherche d’une offre groupée entre la téléphonie classique, la téléphonie mobile, la télévision et Internet, si possible en low cost. Au lieu de segmenter les marchés, Free les a rassemblés et a cassé les prix, sans apporter de révolution technologique majeure.
De ce point de vue, la frontière technologique atteinte par Free est moins lointaine que celle atteinte par Uber. Si l’un et l’autre ont bien déconstruit la vision antérieure du marché pour imposer la leur, Uber a dégagé un patrimoine immatériel pour y parvenir, alors que Free a constitué un porte-feuille de clients sans pouvoir revendiquer une « appli » spécifique qui soit vraiment différenciante.
Les grandes entreprises et la frontière technologique
Pour les grandes entreprises, et tout spécialement en France, le défi de la disruption par le patrimoine immatériel est particulièrement lourd à relever.
Tout d’abord, des éléments de contexte s’y opposent, face auxquels une simple réponse nationale est complexe. Ni la France ni l’Europe n’ont, au premier chef, la maîtrise du Net ou la capacité à fabriquer le matériel nécessaire pour y accéder. La France ne fabrique ni téléphone portable ni ordinateur. L’Europe elle-même est absente ou quasi-absente de ces marchés. Cet obstacle n’empêche pas de créer des plate-formes collaboratives innovantes. En revanche, il rend forcément dépendant des grands magasins d’application que sont Apple ou Androïd. En soi, cette dépendance illustre les freins que l’ubérisation de nos grands groupes peuvent rencontrer.
Mais ce sont surtout les effets de taille et de maturité interne qui constituent le premier empêchement à l’atteinte des nouvelles frontières technologiques par les grands groupes européens. Tous les managers le savent : la culture dominante dans leur entreprise est tout sauf ubérisable. Même lorsque la chaîne hiérarchique se donne l’illusion d’avoir acquis la culture de la start-up, les temps de coordination et de décision internes sont tels que le grand groupe doit forcément surmonter d’importants handicaps pour accéder au nouveau marché.
Dans ces effets de taille, la réinvention de l’informatique existante (avec tout son vocabulaire qui en illustre la difficulté, comme l’urbanisation ou la refactorisation des codes) constitue probablement le nerf sur lequel bute toute tentative raisonnable d’ubérisation. Même avec la meilleure volonté du monde (qui n’est pas une donnée brute des services informatiques), la « start-upisation » de la grande entreprise se heurte à des problèmes effrayants de transformation de l’existant. Dans ce domaine, c’est un véritable palimpseste qu’il faut prendre le temps d’écrire, et ce temps peut devenir colossal.
Pour toutes ces raisons, l’imitation de Free semble un objectif plus utile et plus raisonnable que l’imitation d’Uber pour une grande entreprise. La reformulation d’une offre commerciale à partir d’innovations achetées ailleurs est plus réaliste que la réinvention des produits et des marchés eux-mêmes. Qui plus est, cette stratégie permet de défendre intelligemment son portefeuille plutôt que de se livrer à un périlleux changement brutal d’identité.
Renoncer à atteindre la frontière technologique ?
Faut-il pour autant que nos grandes entreprises se résolvent à ce challenge de « second niveau » qui serait la « freesation » plutôt que l’ubérisation ?
Cette extrapolation constituerait une incompréhension malheureuse du sujet, car on imagine mal l’économie française se satisfaire durablement de cette posture de second rang consistant à renoncer, pour ses mastodontes historiques, à atteindre le meilleur à cause de simples raisons d’empêchement de structure. En revanche, il est évident que l’accès aux frontières technologiques contemporaines, celles d’un patrimoine immatériel disruptif, suppose pour les grands groupes des stratégies de contournement.
Dans la pratique, il est acquis qu’un grand groupe peut difficilement réingénierer à la fois son marché et son propre fonctionnement. Il est donc contraint d’utiliser des facteurs et des acteurs externes à sa propre structure pour évoluer. Cette contrainte explique pourquoi les grands groupes adorent créer une direction de l’innovation dont la mission est d’investir dans des startups.
C’est particulièrement vrai en France où la start-up devient rapidement la direction recherche et innovation de la grande entreprise. Pour ce faire, elle possède de nombreux atouts. D’abord, elle permet d’externaliser de nombreux coûts. Ensuite, elle est rapide, agile et beaucoup plus innovante que ne le sera jamais une direction en propre de l’entreprise. Enfin, elle offre la perspective de dégager une forte rentabilité en cas de succès.
Freesation interne et ubérisation externe
Tel est l’étrange attelage qui dominera probablement la relation complexe de nos grands groupes avec l’innovation dans les années à venir. D’un côté, des partenariats externes avec des startups innovantes permettront de développer un patrimoine immatériel disruptif. D’un autre côté, une stratégie d’innovation visera à incrémenter dans l’entreprise et ses processus les innovations développées « in vitro ».
Ce modèle mérite deux réflexions majeures qui feront les politiques industrielles de demain.
Première réflexion : des startups européennes seront-elles capables, demain, d’imposer leur loi « mondiale » comme l’a fait Uber ? Rien ne l’exclut par principe, mais l’accès au capital rend l’exercice très compliqué. Faute d’un marché capitalistique liquide, et compte tenu des stratégies de prédation menées par les grands groupes détenteurs du capital en Europe, et singulièrement en France (l’exemple de Dailymotion l’a montré), la probabilité de transformer une startup en tycoon est de plus en plus faible. Sur ce point, une stratégie industrielle facilitant l’accès au capital dans la durée serait bienvenue.
Deuxième réflexion : si l’on admet l’hypothèse que la « transformation de l’essai » a vocation à se raréfier, il est utile de penser à une amélioration de la valorisation de startup en cas de cession à un acquéreur. Sur ce point, c’est une véritable réflexion fiscale qu’il faut entamer pour éviter qu’une partie de la valeur ne soit confisquée par la collectivité, alors que le startuper a pris les risques, les a assumés et les a dépassés pour fonder un patrimoine immatériel qu’il n’a pas forcément les moyens de développer face à la concurrence des « rentiers ».
Lire sur Contrepoints notre dossier économie collaborative
—




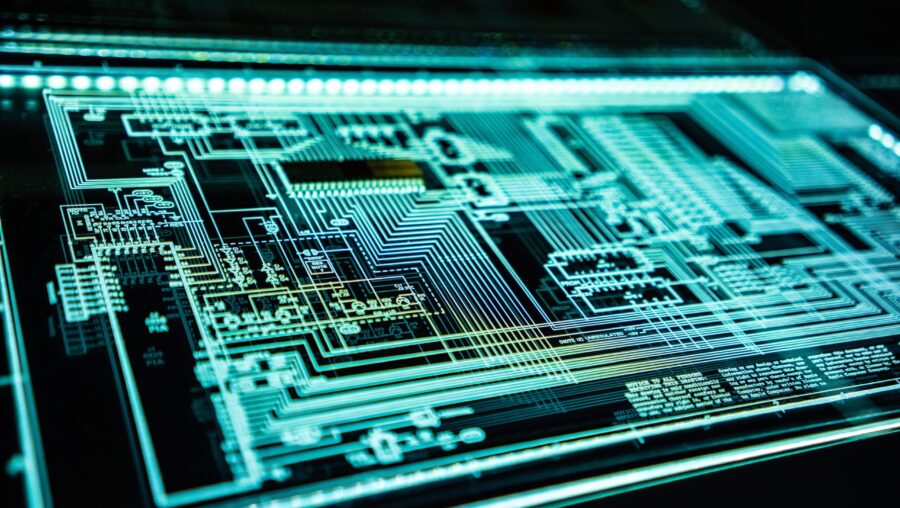
Merci pour le mot du jour : “palimpseste ” 😀
Ca rejoint un peu ce que dit Silberzahn dans ses chroniques ici même sur CP : une entreprise oeuvrant dans l’économie classique ne peut pas abriter une innovation disruptive.
“Comme souvent, l’entreprise faisant face à une rupture tente de forcer celle-ci pour qu’elle corresponde à son identité, plutôt qu’adapter l’identité à la rupture. Toujours convaincue par son histoire qu’une photo, c’est fait pour être imprimé, Kodak investira également énormément dans les imprimantes et les stands photos, sans grand résultat : aujourd’hui, très peu de photos sont imprimées, elles sont en majorité conservées et visionnées sous format numérique. Enfermée dans son identité d’imprimeur de photos, Kodak n’a pas pu admettre un tel bouleversement.”
Une bonne explication des raisons de l’échec est aussi ici :
http://www.contrepoints.org/2015/02/24/199019-qui-doit-piloter-votre-projet-de-rupture