Par Michel Albouy.

L’institut français des administrateurs (IFA) a récemment confié à Louis Gallois la présidence d’un groupe de travail sur le rôle du conseil d’administration dans la détermination de l’appétence pour le risque. Un rapport est sorti. Que faut-il en penser ?
Comme le rappelle le rapport, le risk appetite est la définition du type et du niveau des risques qu’une organisation est prête à accepter au regard de sa stratégie. Ce niveau de risque « voulu » est la balance entre les bénéfices potentiels de la prise de risque (une innovation, un investissement, etc.) et les menaces inhérentes à tout changement. Cette définition exclut donc les risques « non voulus » liés à la transgression des normes éthiques et légales. Si la démarche a tout pour plaire, tant elle paraît consensuelle – tout le monde est d’accord pour exclure les comportements non éthiques -, elle soulève cependant plusieurs questions.
Retrouver le goût du risque
Fondamentalement le rapport plaide pour la réhabilitation de la prise de risque dans l’entreprise en faisant un lien clair entre « opportunités et risques dans le cadre d’une stratégie clairement explicitée ». Pourquoi une telle démarche ? Parce qu’il semble aux auteurs du rapport que les entreprises et leur management seraient devenues frileuses et ne prendraient plus assez de risques ; d’où le niveau relativement bas de leurs investissements. Le niveau élevé des montants de trésorerie des entreprises plaide également en ce sens. Ceci étant, on peut aussi défendre l’idée que si le volume des investissements est faible, c’est peut-être parce que les opportunités d’investissements rentables – c’est-à-dire à valeur actuelle nette positive calculée avec un taux ajusté pour le risque – sont limitées compte tenu de la conjoncture.
Dans le cadre de la démarche du rapport, il faudrait que les administrateurs s’emparent de la question du risque et alignent leurs visions avec celle du management. Pourquoi pas ? L’échange entre le management et les membres du Conseil sur ces questions ne peut qu’être profitable. Mais en pratique, comment aller au-delà d’une aimable discussion ? Comment fixer le curseur de l’appétence pour le risque ? Le rapport reste mystérieux et renvoie sur la notion floue de « culture d’entreprise », un concept suffisamment vague pour satisfaire tout le monde.
Des prévisions souvent trop optimistes
Faisant référence aux travaux de la finance comportementale qui a mis en évidence les biais cognitifs des dirigeants, le rapport distingue les grands projets d’investissement de ceux de petite taille. Ils notent, à juste titre (mais ce n’est pas nouveau) que quand ils évaluent les projets les plus risqués, les dirigeants formulent la plupart du temps des prévisions exagérément optimistes. Effectivement, de nombreuses recherches académiques sur les fusions-acquisitions montrent que les prévisions qui sous-tendent la rentabilité du projet sont systématiquement optimistes (sur les revenus, les synergies, les coûts, etc…) ; d’où la déception et l’idée que 50 % de ces opérations sont des échecs.
Ce biais est bien connu, et il ne relève pas du hasard ou d’une myopie. Pour faire accepter un grand projet d’investissement ou un projet important de fusions-acquisition par les actionnaires, mieux vaut l’habiller de ses plus beaux habits. On n’hésitera du reste pas à raconter des histoires (au sens du story telling) aux actionnaires pour les convaincre d’apporter leur cash ou leurs titres. À titre d’illustration, aurait-on pu lever les fonds pour la construction du tunnel sous la manche si tous les risques avaient été mis sur la table ? On peut en douter.
Refonder le management interne
À partir de cette analyse, les auteurs concluent, un peu rapidement, que « la plupart des risques importants ne sont pris que parce que l’entreprise est convaincue de ne pas en prendre ! ». Précisons ici que ce n’est pas l’entreprise qui décide mais bien ses dirigeants plus ou moins bien contrôlés par leurs actionnaires. La nuance est de taille et renvoie à la théorie de l’agence.
Se voulant les promoteurs des projets de taille modeste et innovants au sein des entreprises, les auteurs estiment qu’il faudrait encourager les porteurs de ces projets, qui ont « tendance à s’autocensurer », à prendre davantage de risques. On ne peut que souscrire à une telle proposition. Mais il s’agit ici davantage d’un problème de management interne au sein de l’entreprise que d’une question relevant des relations entre dirigeants et actionnaires. Bien sûr, les administrateurs pourront, en travaillant avec les dirigeants, aligner leur vision sur ce sujet de la diffusion d’une culture du risque au sein de l’entreprise (droit à l’erreur, etc.), mais on ne pourra pas aller très loin concrètement.
Coup d’épée dans l’eau ?
Au total, que penser de ce rapport ? De notre point de vue, s’il ne fait pas de mal il ne change pas vraiment la donne de la gestion des risques de l’entreprise et de leur gouvernance. Même avec la mise en place du « Risk Appetite » dans la gouvernance des entreprises, on n’évitera pas les désillusions qui jalonnent malheureusement la vie des affaires. Face à des dirigeants armés des études réalisées par leurs experts, que ce soit pour de grands projets d’investissement ou de fusions-acquisitions, les administrateurs, même munis du « Risk Appetite », pèseront bien peu.
Comme chacun sait la vie des affaires est faite d’aléas souvent imprévisibles (comme par exemple la récente baisse du prix du baril de pétrole non anticipée ou une variation des taux de change, etc.). Dans la réussite ou l’échec d’un projet d’investissement ou d’acquisition d’entreprise, tous les risques se combinent. Difficile de faire à l’avance la part entre ceux que l’on contrôle plus ou moins bien et les autres. Rappelons que le risque est inhérent à l’activité économique et que c’est pour cette raison que les entreprises ont besoin d’actionnaires et de leurs capitaux à risques. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de protéger leurs droits et peut-être même de les renforcer comme certains chercheurs américains le proposent contrairement à certains économistes français.
Lire sur Contrepoints notre dossier Entreprise et management
—


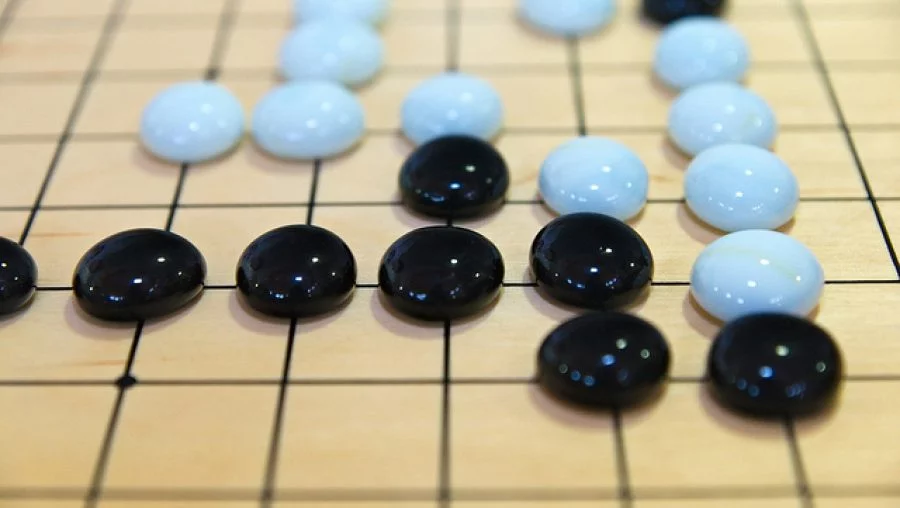


La question numéro un est d’abord : “les entreprises gagneraient-elles à être moins frileuses ?”
Et la réponse qui vient à l’esprit est “non, la position où s’établit l’équilibre entre espérance de gains et risque de pertes résulte de processus efficients ou presque, et toute tentative interventionniste pour déplacer cette position aura plus d’effets pervers que favorables.”
Si, comme le suggère l’article, la position d’équilibre est faussée par une perception erronée des risques et profits, il ne faut pas chercher à corriger cette perception, mais à offrir à ceux qui auraient une perception plus juste les occasions de la mettre à l’épreuve. Si ceux dont les projets innovants et pleins de potentiel pouvaient essaimer facilement et concurrencer leurs sociétés d’origine, nul doute que ces dernières s’intéresseraient un peu plus à développer leurs propositions. Mais on peut constater que la sécurité peut être obtenue à faible coût en empêchant tout développement qui risquerait un jour de concurrencer l’existant : licences, brevets, clauses de non-concurrence, … En revanche, tenter de modifier la perception du risque dans les directions d’entreprise, c’est vraiment jouer à l’apprenti-sorcier.
Le premier risque que prend un entrepreneur est vis à vis de l’état et cela fausse tout.Rien que la création , la gestion, l’innovation et l’investissement c’est déjà très prenant tant au niveau temps qu’au niveau de l’argent. Mais cela reste parfois insignifiant face aux lourdeurs administratives, aux erreurs étatiques, aux contraintes dont dépendent maintenant chaque entreprise.