Par Gérard-Michel Thermeau.

Il y a 110 ans, le 12 juillet 1906, Alfred Dreyfus était officiellement réhabilité et lavé de toutes les accusations portées contre lui par la cour de Cassation. C’était l’épilogue de l’Affaire Dreyfus (l’Affaire avec une majuscule !) qui avait divisé l’opinion publique selon une ligne de partage qui ne reflétait pas nécessairement les clivages politiques traditionnels.
Gauche et droite confondues ont longtemps préféré jeter un voile pudique sur ce fâcheux incident qui montrait de façon trop crue comment la machine étatique pouvait broyer un individu sous un régime républicain. François Mitterrand n’était-il pas hostile à l’idée de faire ériger une statue à Dreyfus ? En cet été 2016, Roman Polanski aurait dû commencer le tournage d’un film consacré à cette complexe histoire d’espionnage devenue affaire d’État. Finalement, le projet a été reporté et sera peut-être enterré comme tant d’autres films annoncés et jamais réalisés. L’occasion peut-être de revenir sur les adaptations cinématographiques et télévisuelles, relativement peu nombreuses, consacrées à l’événement.
L’Affaire et le cinéma
Le cinéma naît au moment de l’Affaire Dreyfus : aussi n’est-il pas étonnant de voir un opérateur tourner quelques scènes pendant le procès de Rennes, le second procès Dreyfus (1899). La même année, Georges Méliès, le second père du cinéma, réalise le premier film politique de l’histoire en reconstituant les moments clés de l’Affaire. L’œuvre est d’autant plus courageuse que celle-ci est loin d’être terminée, Dreyfus n’ayant été réhabilité qu’en 1906. Méliès s’est réservé le rôle de l’avocat Labori. Le film triomphe… dans les pays étrangers.
Encouragé par ce succès, en 1902 et 1908, deux films Pathé signés par Ferdinand Zecca, le réalisateur maison, présentent en une suite de tableaux les diverses péripéties : les transformations opérées sont significatives des mentalités du temps. Ainsi, la femme de ménage qui, dans la réalité, récupère dans la poubelle de l’ambassade allemande le fameux bordereau, devient un homme dans le film Pathé.
Et puis, ce sera tout pour le cinéma français, qui n’a jamais repris le sujet sous forme d’une fiction. Après l’avènement du cinéma parlant, l’Affaire Dreyfus sera traitée par des films britannique, allemand et américain qui n’auront guère le bonheur de plaire aux autorités françaises.
Ce n’est peut-être pas si étonnant. Au moment de l’Affaire Dreyfus, les journaux étrangers étaient tous favorables à l’innocence du capitaine.
Cette attitude des opinions publiques étrangères ne faisait que renforcer la conviction des anti-dreyfusards de l’existence d’un complot des étrangers et des Juifs pour discréditer l’armée française.
L’Affaire Dreyfus vue par les Allemands
 Dreyfus, tel est le titre du film de Richard Oswald (1930). Le film s’inscrit dans le contexte d’une république de Weimar en crise avec la montée en puissance des extrémismes et de l’antisémitisme.
Dreyfus, tel est le titre du film de Richard Oswald (1930). Le film s’inscrit dans le contexte d’une république de Weimar en crise avec la montée en puissance des extrémismes et de l’antisémitisme.
Comme la plupart des films des débuts du parlant, les séquences sont très théâtrales et statiques en raison de la lourdeur des nouvelles techniques encore balbutiantes. Le jeu des acteurs est parfois excessif. Un certain manque de moyens se fait sentir assez visiblement dans les deux séquences de dégradation puis de réhabilitation de Dreyfus tournées dans un cadre assez serré.
Le capitaine est incarné par Fritz Kortner qui devait, par la suite, jouer des personnages louches dans les films noirs hollywoodiens. Heinrich George campe un Zola pompeux qui débite de grands discours tandis que Paul Bildt, qui s’exprime peu et bouge encore moins, impose la silhouette de Clemenceau auquel il ressemble étonnamment. Clemenceau se lève néanmoins pendant le procès Zola pour désigner le tableau représentant le Christ comme exemple de la « chose jugée ». L’épisode devait être repris dans le film hollywoodien de Dieterle.
Si Oskar Homolka est un Estherazy crédible, Paul Basserman, largement sexagénaire, est un peu âgé pour le rôle de Picquart, « le plus jeune lieutenant-colonel de l’armée française ». Le film souffre avant tout d’une absence de point de vue : l’histoire est contée chronologiquement, faisant défiler tout à tour Estherazy, Dreyfus, Picquart, Zola, etc. C’est une chronique assez fidèle mais qui manque de fil directeur.
Seule grande originalité : on nous montre Zola, Clemenceau, Jaurès poussant Dreyfus à accepter la grâce et celui-ci la refusant d’abord et ne cédant qu’aux supplications de son épouse.
Peu après, un film britannique, que je n’ai jamais vu, adaptation d’une pièce de théâtre, s’attaque à son tour au sujet : Dreyfus The Case de F. W. Kremer et Milton Rosmer, deux noms qui n’ont guère marqué l’histoire du cinéma. Dreyfus est joué par un éminent comédien britannique, Cedric Hardwicke.
Un biopic à la sauce hollywoodienne
 La Vie d’Émile Zola de William Dieterle (1937) s’inscrit dans une série de grandes biographies historiques de la Warner (qui crée ainsi le Biopic) mettant en vedette Paul Muni. Il venait d’incarner Louis Pasteur, il endosse cette fois l’apparence du célèbre écrivain, y trouvant peut-être le rôle de sa vie.
La Vie d’Émile Zola de William Dieterle (1937) s’inscrit dans une série de grandes biographies historiques de la Warner (qui crée ainsi le Biopic) mettant en vedette Paul Muni. Il venait d’incarner Louis Pasteur, il endosse cette fois l’apparence du célèbre écrivain, y trouvant peut-être le rôle de sa vie.
Le contexte d’une montée des périls en Europe se reflète fidèlement dans ce film réalisé par un Allemand en exil : Zola déclare à son épouse : « des milliers d’enfants en train de dormir paisiblement ce soir sous les toits de Paris, Berlin, Londres, sont voués à une mort atroce sur quelque champ de bataille titanesque si rien n’est fait pour l’empêcher. Il faut conquérir le monde non par la force des armes mais par les idées qui libèrent. »
À la différence du film allemand, le nom de certains protagonistes a été modifié par prudence. En dépit de son titre, le film est essentiellement consacré à l’implication de Zola dans l’Affaire Dreyfus. Embourgeoisé, l’écrivain qui a réussi va être tiré de sa torpeur par l’Affaire. « Un artiste doit rester pauvre » lui dit son ami Cézanne. Lui qui a peur de s’enrhumer va tout risquer pour démontrer l’innocence de Dreyfus.
Le coup de génie est peut-être d’avoir donné le rôle du « faux traître » à Joseph Schildkraut, ancien jeune premier du muet voué avec le parlant aux rôles de personnages sournois et perfides (Pascal dans Viva Villa, Hérode dans Cléopâtre, Montferrat dans Croisades, en attendant le duc d’Orléans dans Marie-Antoinette).
L’aspect le plus étonnant de ce film, à la différence des autres, est l’absence totale de référence à l’antisémitisme : les frères Warner, Juifs comme la plupart des producteurs hollywoodiens, étaient soucieux de ne pas heurter le public, adoptant ainsi la même position que la communauté juive française pendant l’Affaire Dreyfus. Il semblerait que le réalisateur ait imposé le seul plan où l’on aperçoit fugitivement la mention juif dans le dossier de Dreyfus.
Par le luxe et l’éclat, la musique de Max Steiner, cette version hollywoodienne écrase les films précédents. Muni s’impose en Zola par un brillant plaidoyer à l’occasion du procès provoqué par son retentissant article J’accuse. Le film s’achève sur la mort de Zola et sa « résurrection », le panégyrique d’Anatole France.
Le gouvernement Daladier, outré de ce film, qui portait « atteinte à l’honneur de l’armée française » interdit son exploitation en France et obtient son retrait de la sélection du festival de Venise. Les spectateurs français devront attendre 1954 pour découvrir cette œuvre.
Dreyfus, héros malgré lui
 Quelques années plus tard (1958), l’acteur José Ferrer, Américain d’origine portoricaine, tourne en Grande-Bretagne le troisième film notable sur le sujet. Le scénario est signé Gore Vidal.
Quelques années plus tard (1958), l’acteur José Ferrer, Américain d’origine portoricaine, tourne en Grande-Bretagne le troisième film notable sur le sujet. Le scénario est signé Gore Vidal.
Le titre J’accuse (I accuse) du film est aussi trompeur que celui de La Vie d’Émile Zola. Ce n’est en rien un film centré sur Zola et son fameux article. Zola n’a qu’un rôle très secondaire. Néanmoins, le film met particulièrement l’accent sur le rôle de la presse dans l’Affaire Dreyfus : notamment de Drumont et de son fameux journal antisémite, La Libre parole (The Free Word : tous les titres des journaux français sont traduits en anglais, L’Aurore devenant The Morning Sun).
José Ferrer s’efforce de faire mentir un des lieux communs les plus souvent répétés sur la question : Dreyfus serait un personnage médiocre et sans intérêt. Le film adopte le point de vue du malheureux capitaine : la force ou la faiblesse du projet consiste à confier le rôle principal (incarné par le réalisateur) à ce personnage « falot », terne, conventionnel. José Ferrer joue un officier sérieux, respectable, bon époux et bon père de famille, incarnation des valeurs bourgeoises, qui se retrouve malgré lui pris dans une affaire qui va le dépasser. Le seul tort de Dreyfus est son origine juive.
Après les épreuves subies à l’île du Diable, il n’a qu’un désir : retrouver sa famille, refusant d’être le porte-drapeau d’une Cause mais souffrant d’être ensuite prisonnier chez lui, ayant perdu son honneur et ne pouvant plus porter l’uniforme si cher à son cœur. Le patriotisme du personnage est constamment affirmé : dans la séance de dégradation, très bien reconstituée, comme dans la séance de réhabilitation, son regard est fixé sur le drapeau tricolore tandis que des éclats de Marseillaise parcourent tout le film.
Si les enjeux de l’Affaire Dreyfus sont assez bien éclairés, le scénario dramatise habilement les faits en opposant à Dreyfus le commandant Estherazy, joué avec un charme vénéneux par Anton Walbrook : il est le Diabolus ex Machina provoquant par ses manœuvres et son goût de l’argent la chute, puis la réhabilitation de l’infortuné capitaine.
Il faudrait citer encore un téléfilm britannique de Ken Russell, Prisonner of Honor, qui raconte l’Affaire Dreyfus selon le point de vue de Picquart joué par Richard Dreyfus (!) : les images de la bande annonce rapprochent cette œuvre des autres films historiques de Ken Russell marqués par l’outrance et le grotesque.
La télévision française se réveille enfin
C’est la télévision française qui finira par lever le tabou français sur la représentation de l’Affaire Dreyfus. Émile Zola ou la conscience humaine (1978) de Stellio Lorenzi, inspiré d’Armand Lanoux, comme son titre l’indique, focalise l’attention sur l’écrivain, magnifiquement interprété par Jean Topart, le sous-titre faisant référence à une formule d’Anatole France prononcée sur la tombe de l’auteur de J’accuse. Son format en quatre parties de deux heures permettait, à la différence des autres adaptations, d’offrir un récit détaillé des péripéties de l’Affaire.
La fine fleur des acteurs de la télévision de l’époque (ah, nostalgie !) figurait dans la distribution : Pierre Vernier (Picquart), André Valmy (Clemenceau), François Chaumette (Labori), William Sabatier (Jaurès), Charles Millot (Estherazy) entre autres. La plupart des interprètes ressemblaient d’ailleurs physiquement à leur personnage, contribuant à la crédibilité de l’ensemble. Mais je n’ai pas eu l’occasion de revoir l’œuvre depuis. Elle semble d’ailleurs invisible pour d’obscures raisons de droit d’auteur.
En 1995, Yves Boisset s’y attelle à son tour. Une coproduction internationale réunit France 2, Arte, la RAI, la RTBF et la télévision tchèque. Picquart, très idéalisé, joué par l’acteur allemand Christian Brendel est le véritable héros de l’histoire : il suit d’abord comme témoin les événements avant d’y jouer un rôle décisif. Arditi campe mollement Estherazy, et Thierry Frémont un Dreyfus raide comme un mannequin. Si le film met l’accent sur les trois figures contrastées d’officier : l’innocent, le traître et le paladin, c’est cependant Bernard-Pierre Donnadieu, dans le rôle du commandant Henry, qui s’impose dans la distribution.
Même s’il s’inspire de l’ouvrage de Jean-Denis Bredin, la relecture des événements est très contestable : Léon Blum est très présent comme s’il avait joué un rôle décisif alors que Zola joue les figurants de luxe (Jean-Claude Drouot est assez fade), le jeune Proust est largement mis en valeur alors même que la figure de Clemenceau est purement et simplement gommée. Il fallait le faire : Jorge Semprun l’a fait.
Il est vrai qu’aux yeux de Yves Boisset, Dreyfus était un « sale con antisémite ». Tous les officiers portent des uniformes flottants, on a vraiment l’impression qu’ils nagent dedans, impression curieuse. Comme l’eau a coulé sous les ponts, l’antisémitisme est largement souligné (mais les socialistes en sont mystérieusement exemptés) : le téléfilm s’ouvre sur des duels opposant des officiers juifs à des antisémites, dont Drumont. Autre signe des temps, la dégradation est filmée sur les lieux mêmes, avec la bénédiction du ministère de la Défense.
Le téléfilm est en deux parties : la première mettant l’accent sur les circonstances qui conduisent Dreyfus à l’île du Diable, et la seconde sur l’Affaire proprement dite dans sa dimension politique mais s’arrêtant avant le procès de Rennes. Comme dans les films d’Oswald et Ferrer, la scène de réhabilitation dans la cour de l’École militaire sert de conclusion à cette terne reconstitution visiblement conçue pour être utilisée dans les salles de classe.
Quelques leçons à tirer
Quelques leçons peuvent être tirées de ces diverses adaptations. D’abord, les méchants sont avant tout les hauts gradés de l’armée qui se partagent en deux catégories : les malhonnêtes et les imbéciles. Cependant, dans tous les films ou téléfilms, quelques officiers incarnent l’image idéalisée du militaire : Picquart avant tout, mais pas seulement.
En revanche, les politiques sont davantage épargnés. Dans le film allemand de 1930, Cavaignac est même montré comme le ministre qui innocente Dreyfus, ce qui est prendre quelques libertés avec les faits, même si le personnage a contribué, malgré lui, à faire s’effondrer le mythe du dossier secret. Dans le film britannique de 1958, les ministres finissent par obliger les généraux à reconnaître leurs torts. Chez Yves Boisset, les séances à la Chambre des députés visent surtout à opposer les bons politiques (la gauche socialiste au grand cœur) des mauvais (les affreux réactionnaires de droite).
Seul le film hollywoodien de 1937 est plus critique, Zola dans son plaidoyer évoquant les pressions du président du conseil Méline pour inciter le jury populaire à condamner l’écrivain. L’Affaire Dreyfus est en effet embarrassante : elle se déroule sous le régime politique le plus libre que la France ait connu et les gouvernants soucieux de ne pas savoir étaient tous des républicains irréprochables. Cavaignac n’était-il pas le petit-fils d’un Conventionnel et le fils du chef de gouvernement de la IIe République ?
Malheureusement, l’état d’esprit des antidreyfusards s’est parfois transmis aux bien-pensants actuels. Un maître de conférences à l’ENA n’a-t-il pas écrit : « l’innocence de Dreyfus a été prouvée et proclamée par la Cour de cassation au nom du peuple français, décision qui s’impose à toutes les institutions et à tous les citoyens en France. Il ne s’agit pas d’une vérité d’État (sic). »1
- Duclert Vincent, « La mémoire et le service de l’État, l’affaire Dreyfus », Pouvoirs 2/2006 n° 117, p. 145-155 ↩




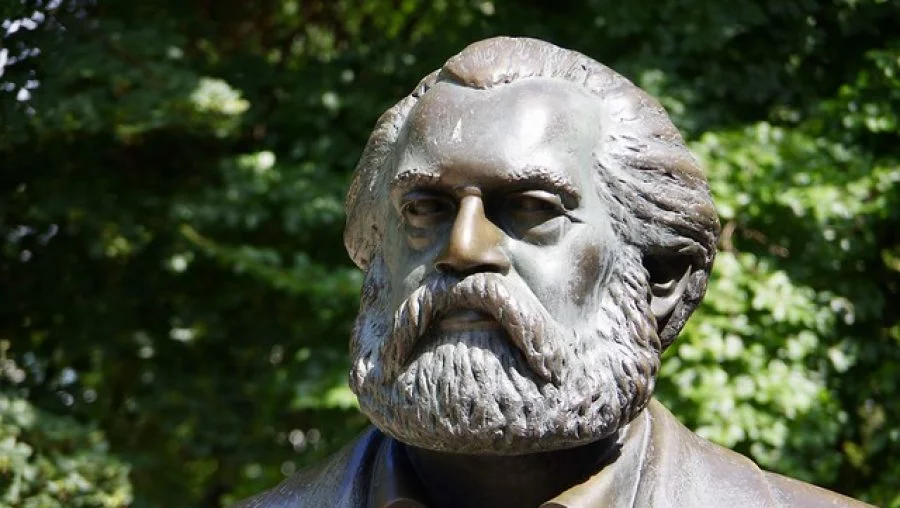
On oublie trop souvent que la question antisémite n’était pas centrale à l’origine dans l’affaire Dreyfus. C’était en réalité celle de la raison d’Etat, laquelle était la plus clivante. Autrement dit, il était essentiel de ne pas remettre en cause ce qui avait été jugé, au risque de déstabiliser la France.
La question antisémite a sur-infecté le débat, puis est devenue aujourd’hui essentielle.