Par Cécile Philippe.
Un article de l’Institut économique Molinari

Déjà en 2009, la Banque centrale suédoise brisait un tabou en maintenant un de ses taux d’intérêt en terrain négatif. Quelques années plus tard (2015), on découvrait que Nestlé pouvait gagner de l’argent en empruntant à des taux négatifs de l’ordre de -0,008%. Depuis le 16 février 2016, le taux de dépôt à la Banque du Japon est de -0,1% et la France continue d’emprunter sur les marchés à des taux d’intérêt négatifs pour rembourser sa dette.
Ces taux d’intérêt négatifs suscitent l’étonnement. À raison puisque nous comprenons tous intuitivement que le taux d’intérêt est un prix pour le risque pris à prêter son argent pendant un certain temps. Récompenser l’emprunteur, c’est un peu comme marcher sur la tête. C’est rendre compliquées les stratégies d’épargne des particuliers pour les grands risques (accident, santé, retraite, etc.), c’est pousser les États à continuer à s’endetter, c’est dérégler la boussole des taux qui n’indiquent plus leur risque réel. Bref, comment expliquer ce phénomène et quels sont les risques ?
Pourquoi des taux négatifs ?
Les taux négatifs reflètent une appétence particulière des acteurs économiques pour des actifs sûrs comme peuvent l’être les obligations souveraines. Au fur et à mesure que la demande pour ces obligations augmente, le rendement fixe de celles-ci diminue au point d’entrer dans les zones négatives.
Qu’à cela ne tienne, cela ne décourage pas pour autant les investisseurs qui continuent de préférer ces actifs à d’autres plus risqués. Les banques sont, en effet, obligées de les acheter pour avoir éventuellement du collatéral disponible. Les spéculateurs sur les marchés monétaires les achètent, car ils espèrent y gagner en les revendant plus cher dès lors que les taux continuent à baisser. Les compagnies d’assurance quant à elles ont l’obligation d’en détenir.
Tel n’est pourtant pas l’objectif des banques centrales qui partout dans le monde s’évertuent à trouver des moyens de plus en plus ingénieux de pousser les banques à prêter et les entreprises à investir en empruntant. À travers ce qu’il est maintenant coutume d’appeler les politiques monétaires on conventionnelles ou assouplissement quantitatif, leurs annonces sont de plus en plus attendues et leurs effets de durée toujours plus courte.
Comment expliquer cette situation ? Par le fait qu’il n’y a globalement pas sur les marchés d’appétence pour la prise de risque et donc une faible demande pour l’endettement de la part des entreprises. Pourquoi les entreprises se montrent-elles si frileuses ?
Les perspectives de profit dans nos économies sont très faibles du fait de rigidités institutionnelles trop nombreuses. Ensuite et surtout, il faut se rappeler que la crise de 2008 a fortement dévalué les actifs d’entreprises qui ont d’énormes dettes à rembourser. Par conséquent, conscientes du poids de celui-ci, elles veulent réduire leur prise de risque et diminuer leur endettement.
En gros, les entreprises préfèrent se désendetter progressivement plutôt que de prendre de nouveaux risques en recourant au crédit. Elles préfèrent assainir leur bilan et n’investissent de nouveau que lorsqu’elles disposent de suffisamment de capitaux propres ou quand l’évaluation de leurs actifs est suffisamment solide pour garantir un endettement supplémentaire. Depuis 2008, nombre d’entreprises ont découvert qu’elles ne remplissaient ni l’une ni l’autre de ces conditions. La faiblesse du crédit signale une faiblesse de la demande, résultant de la réticence des entreprises à investir dans le contexte actuel.
La récession par les bilans
C’est ainsi que la zone euro est globalement en phase de désendettement sous le poids de pays comme l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, la Hongrie. En France, si la tendance se confirme, le pays pourrait passer en phase de désendettement en 2017. Le Royaume-Uni est pourrait-on dire en phase de thésaurisation, les États-Unis sont très proches du désendettement net et le Japon se désendette maintenant depuis 25 ans.
C’est ce que l’économiste Richard C. Koo appelle la récession par les bilans ou balance sheet recession. Cet économiste américain-taïwanais résidant au Japon a essayé de comprendre la crise au Japon qui perdure depuis plusieurs décennies. Il a constaté qu’une récession pouvait avoir lieu lorsque nombre d’entreprises du fait de l’éclatement d’une bulle voyaient leurs actifs dévalués et leurs profits diminués, mais se révélaient encore suffisamment rentables pour pouvoir continuer à opérer.
Elles sont assez rentables pour survivre, mais pas pour s’endetter de nouveau. Il y a tout simplement trop de risque à le faire. Dans ce cas, la récession peut se révéler beaucoup plus longue puisque les entreprises vont se battre avant tout pour pouvoir rembourser leurs dettes excessives (ce qui a un effet déflationniste).
Dans une crise classique, les dettes chutent rapidement sous le coup des faillites et on assiste à une restructuration rapide des actifs au fur et à mesure que les entreprises et les particuliers relancent l’économie. Dans le type de crise décrit par Koo, les entreprises ne réduisent leurs dettes que très lentement et ne restructurent leurs actifs qu’au fur et à mesure qu’ils sont en mesure de faire face à leurs obligations.
Dans ce type de crise, les entreprises font des surplus (à l’inverse de ce qu’elles font dans un contexte normal), les excédents des particuliers s’amoindrissent et les États prennent le relais des entreprises et génèrent des déficits de plus en plus importants pour maintenir l’économie à flot. Pendant ce temps, l’économie stagne. C’est ce qui est arrivé au Japon après la crise, à la fin des années 1980. C’est ce qui guette aujourd’hui l’économie européenne et américaine.
La relance du crédit par les banques centrales
Les banques centrales n’ont de cesse depuis la crise de 2008 de chercher à relancer le crédit dans nos économies, voir les dernières décisions de Mario Draghi qui ont dépassé les attentes du marché. La fixation du taux d’intérêt de la facilité de dépôts à – 0,4% et le renforcement du programme d’achat étaient attendus (80 milliards au lieu de 60). Par contre, la baisse du taux directeur à 0% et le lancement de 4 opérations de LTRO l’étaient beaucoup moins.
Cette intensification dans l’utilisation de politiques monétaires de moins en moins conventionnelles vient de ce qu’en dépit d’avoir inondé le marché de liquidités, celui-ci refuse obstinément de repartir à l’aventure. Les liquidités aujourd’hui servent moins à sauver un secteur bancaire en crise (comme il pouvait l’être en 2008) qu’à sans doute maintenir la valeur des actifs des entreprises dans l’espoir que ses dirigeants – plus confiants – relancent le crédit plutôt que de continuer à se désendetter.
Les financiers ne sont cependant pas dupes de la situation. Ils se rendent certainement compte que la valeur de leurs actifs est portée à bout de bras par une politique monétaire qui les surévalue. Une aubaine qui leur donne le temps de remettre les choses en ordre, mais à la vitesse de l’escargot. Face à cette situation, les banques centrales rendent coûteux pour les banques de garder les vastes liquidités qu’elles mettent à leur disposition et les pousse donc à investir.
Ayant peu de projets intéressants à financer, elles se tournent donc vers les obligations souveraines (ce qui entretient la demande pour ce type d’actif et explique en partie les taux négatifs) et vers les marchés d’actions qui restent très florissants en dépit d’une croissance économique très faible.
Il y a des opportunités à investir dans les obligations du marché secondaire. Avec des taux qui baissent, le prix des obligations augmentent. Si on s’attend à que le taux diminue encore dans le future, les banques et autres investisseurs en obligations vont les acheter maintenant, pour pouvoir les revendre lors de la baisse des taux.
Que peut la politique monétaire ?
La politique monétaire a-t-elle des chances de parvenir à ses fins ? Il est peu probable que la politique monétaire puisse parvenir à convaincre les entreprises de se relancer dans de nouveaux projets si, par ailleurs, nos pays restent engoncés dans des rigidités institutionnelles excessives rendant les perspectives de rentabilité extrêmement faibles. D’un côté, les réglementations tatillonnes augmentent le coût des projets et de l’autre, la fiscalité excessive des entreprises comme des particuliers diminue le bénéfice attendu des projets.
Les entreprises et les investisseurs français sont en train de s’adapter au fardeau fiscal dans sa nouvelle version, après le choc fiscal de 2012 qu’ils n’ont pas pu éviter. La mise en oeuvre du CICE n’évite pas ce choc parce qu’il ne porte que sur des entreprises qui augmentent activement leur main-d’oeuvre, autrement dit des entreprises en croissance. Une entreprise en difficulté ne peut se permettre de créer des emplois, mais doit acquitter ses cotisations sociales à taux plein.
De plus, entre 2011 et 2015, les entreprises ont dû supporter une contribution exceptionnelle de 10,7% venant s’ajouter à leur impôt sur les sociétés. En pratique, cela peut faire passer le taux d’imposition de 33,3% à près de 37%. Pour rester dans la course, la France devrait ramener son fardeau fiscal et sa complexité réglementaire au même niveau que le reste du monde. Une telle harmonisation implique une baisse de plus de 20% de la fiscalité globale pesant sur les entreprises.
Il y a donc plus à attendre des réformes structurelles pour changer la donne que des réformes monétaires. Les premières sont cependant extrêmement difficiles à faire passer, tandis que les secondes ne peuvent sans doute plus reculer au risque de provoquer ce qu’elles cherchent à tout prix à éviter depuis le début : des faillites en cascade. Pour conclure, il faut bien comprendre la situation dans laquelle on est pour pouvoir à défaut de la changer, s’y adapter.
Il faut prendre la mesure des risques que nous font courir ces politiques monétaires non conventionnelles. Il sera très difficile de sortir d’une politique de taux extrêmement bas voire négatifs ; l’aplatissement/déformation de la courbe des taux rend illisible le risque lié à l’investissement pour les entreprises ; l’accoutumance à l’endettement public reporte le problème vers le futur avec des entreprises qui dépendent de plus en plus du soutien public et s’éloignent du serve rendu aux consommateurs dans le cadre d’un calcul économique sain ; les taux faibles rendent très fragiles des industries spécialisées dans la protection contre les aléas de la vie, en particulier, les assureurs. C’est la japonisation de nos économies.
—



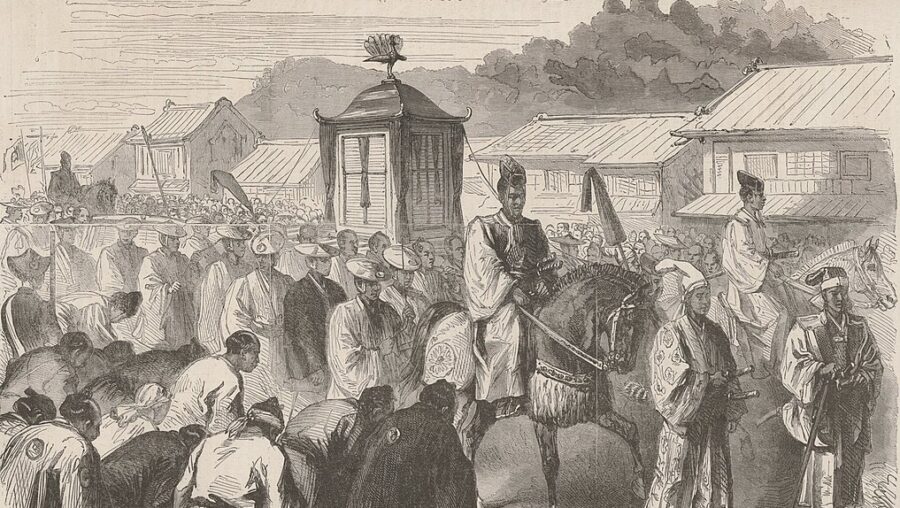

Pourquoi (pour quoi) cette fuite en avant? Ça ne marche pas, donc on continue et même, on accentue la même politique…
Ce n’est pas une fuite en avant : imaginez que vous êtes dans une montée, le pied au plancher sur l’accélérateur : vous avancez, mais vous n’accellerez pas, voir vous ralentissez.
En fait la politique monétaire n’a aucun effet positif sur l’économie, elle a au mieux un effet nul, au pire des effets négatifs.
C’est un sophisme de politicien de dire que l’Etat peut relancer l’économie ou inverser les courbes, une politique monétaire peut juguler une inflation ou une déflation, mais son modèle final est bien ce que nous avons actuellement : des taux de monnaie de référence nul. Pour revenir au début de l’article : une banque centrale ne prend aucun risque à prêter de l’argent, vu qu’elle ne le prête pas : elle l’emet.
@ Stéphane Boulots
« En fait la politique monétaire n’a aucun effet positif sur l’économie, elle a au mieux un effet nul, au pire des effets négatifs. »
D’accord, la monnaie ne peut pas tout surtout quand ces banques commerciales, devenues inutiles, se font un plaisir de refuser excessivement facilement les prêts aux privés ou aux sociétés pour raison de risque excessif!
La France, sans l’€, aurait déjà dévalué le franc français une ou deux fois, ce qui n’est qu’une solution provisoire et bonne pour les exportateurs, pas les autres! C’est arrivé si souvent!
Non, depuis 1993, la France a refusé obstinément de se mettre en conformité avec les critères de convergences (et de « bonne gestion ») : elle en paie le prix, maintenant, gardant ses 57,5 % de PIB bouffés par l’état, son déficit budgétaire et sa dette, après … 23 ans. Je ne dis pas que la conjoncture est excellente mais bien des pays européens renouent avec une croissance.
Cela ne veut dire en rien que je fais confiance à M.Draghi à la BCE.
@miky stouffs :
Les banques « commerciales » en France … Humm …
BNP Paribas 3° plus grande entreprise Française – Directeur X-Mines – Actionnaires : investisseurs institutionnels 81% du capital
Société Général 4° plus grande entreprise – Directeur Enarque promo 87
Crédit Agricole : 6° plus grande entreprise – Actionnaires : investisseurs institutionnels 86% du capital
Banque Populaire Caisse d’Epargne : 11° plus grande entreprise – Directeur Enarque promo 90 nommé par l’Etat
Les banques « commerciales » en France, ca n’existe pas, ce ne sont que des extensions de l’Etat ayant comme rôle majeur de faire tourner la machine à déficit. La « finance » c’est un épouvantail pour piliers de bistrot : ca n’existe pas, ca s’appelle l’Etat (et ses petits copains)
La croissance économique est tirée par le profit. Il faut donc que la politique économique favorise le profit: moins de prélèvements, moins de règlements, bref moins d’Etat. Les banques centrales n’ont pas à s’en mêler. La création monétaire ne crée pas la croissance.